printemps 1996
Pour une version anglaise cliquez ici
Le capitalisme de cette fin de siècle, quoi qu’en pensent les adorateurs de la démocratie néolibérale, est aux antipodes de l’image qu’ils en donnent. Derrière le masque de l’humanitaire apparaît l’inhumanité de l’exploitation et de la domination, toujours plus implacables. La capitalisation aggravée de la vie génère des horreurs sans fin, y compris dans les pays les plus civilisés, qu’il est désormais difficile de considérer comme contingentes et passagères.
Dans l’esprit des maîtres du monde, dont la Banque mondiale est le gestionnaire attitré, bien des choses restent encore à faire pour écraser leurs esclaves et donner libre cours à leur ambition dévorante : ravager la planète et déchaîner la puissance domesticatrice du capital. Pour les équipes au pouvoir en France, il faut en finir et vite. Elles y sont incitées par les échéances de l’intégration européenne et, de façon générale, par les impératifs du marché mondial dont elles ne sont, en dernière analyse, que les mandataires. Mais il a suffi que des salariés de l’Etat commencent à faire preuve d’insoumission pour que la belle mécanique mise en point par les gestionnaires en place soit quelque peu grippée.
Pour les directions syndicales, toujours hostiles aux initiatives individuelles et collectives qui risquent de leur échapper, la décision d’entrer en grève est le résultat d’épuisantes consultations sur le terrain, menées avec toute la pédanterie et le cérémonial propres à la démocratie, dans l’objectif d’obtenir la caution du personnel concerné. Mais les individus qui ne manquaient pas d’esprit de décision savaient déjà par expérience que l’unanimité formelle ainsi réalisée ne signifie rien en elle-même. Sans attendre d’avoir l’accord de l’ensemble de leurs camarades encore hésitants, non seulement ils arrêtèrent de travailler mais aussi commencèrent à investir les postes de contrôle du trafic.
De telles initiatives furent dénoncées par la direction de la SNCF comme des actes d’irresponsables qui “ mettaient en danger la sécurité des installations et des réseaux ” alors qu’elle a la responsabilité de multiples catastrophes ferroviaires sur les lignes peu rentables qu’elle laisse crever. En réalité, de tels actes révélaient la fragilité du réseau de transport, de plus en plus centralisé et informatisé. La généralisation de la technologie de pointe est à la fois source de force et de faiblesse pour le système. Elle est l’arme du capital pour domestiquer les humains et rendre de plus en plus leur présence obsolète. En même temps, il a suffi que des poignées d’individus déterminés occupent les centres de contrôle et les postes d’aiguillage, effectuent quelques actes de sabotage élémentaires, comme vider la mémoire des ordinateurs, pour commencer à paralyser l’ensemble du trafic.
Les directions syndicales regardèrent avec suspicion les premiers débrayages spontanés qui démarraient sans leur aval et qui pouvaient être gros de conséquences imprévisibles. Pour les comptables de la force de travail, le travail est la vie même et la grève n’est que l’un des moyens douloureux que les ilotes de la survie sont parfois obligés d’employer pour faire aboutir leurs desiderata. Elles ne comprennent pas qu’arrêter le travail, même de façon momentanée, fait partie des plaisirs de la vie bien que l’on y consume beaucoup de vitalité et que l’on y perde parfois de l’argent.
Pour bien des grévistes, la grève, de moyen était en train de devenir but en soi, activité en rupture avec le quotidien. Elle permettait de relever la tête, de rompre avec la résignation, de briser quelque peu les séparations professionnelles, de parler, de faire la fête, de descendre dans la rue et, pourquoi pas, de festoyer avec les gens du quartier, d’ailleurs bien plus en banlieue que dans le centre de Paris désormais transformé en musée et en centre commercial de luxe.
Les détenteurs du pouvoir d’Etat, apologistes du darwinisme social, ont stigmatisé de telles réticences comme du “ corporatisme de salariés privilégiés ”, bref comme le réflexe de survie d’espèces antédiluviennes incapables d’adaptation. Le discours n’a rien de bien neuf. Il date de plus de quinze ans, lorsque les ouvriers de l’industrie traditionnelle résistaient, parfois de façon très violente, à leur disparition, condition primordiale pour mater les rétifs et permettre la reconversion du capital.
Les salariés des entreprises d’Etat comme la SNCF sont, par tradition, marqués par le corporatisme, assis sur la fierté professionnelle. Mais, lorsque les initiateurs des premières grèves affirmèrent qu’ils “ combattaient pour eux-mêmes mais aussi pour tous les prolétaires, salariés et non salariés ”, ils révélaient qu’ils surmontaient leur esprit de boutique habituel qui leur causa beaucoup de tort au cours des précédentes grèves, en particulier au cours de l’hiver 1986.
La teneur des premières discussions passionnées, tenues d’ailleurs bien plus dans les cafés que dans les assemblées, montrait qu’il y avait eu maturation souterraine bien avant le déclenchement de la grève. La majorité était certes préoccupée en priorité par les diverses questions relatives à la remise en cause du statut de salarié de l’Etat. Mais la minorité, elle, plus consciente et plus déterminée, allait plus loin et tentait d’aborder l’ensemble des problèmes de la survie quotidienne. Les réponses étaient parfois très confuses, marquées par l’idéologie et le langage de la démocratie pure, mais on sentait la réflexion critique, la recherche réelle de perspectives qui permettraient de “ replacer l’humain au centre contre la dictature des marchés ”, au-delà des catégories inhumaines du capital, des séparations et des rôles qui l’accompagnent.
Ainsi, des grévistes de la SNCF, des TELECOM, de la RATP et même d’EDF acceptèrent que des étrangers aux entreprises d’Etat assistent aux assemblées générales, organisèrent des soupes populaires pour les miséreux et rétablirent en partie l’électricité à des foyers nécessiteux, germes d’entraide qui rompaient avec l’idéologie de l’appartenance à l’entreprise et l’égoïsme forcené propre au capital contemporain.
Le ridicule ne tue plus : les misérables tentatives du pouvoir d’Etat de dresser la population contre les grévistes échouèrent. Après le fiasco de la première démonstration des “ usagers en colère, otages des grévistes ”, il décida d’annuler les suivantes. Malgré la généralisation de la pagaille dans les transports urbains, la population manifesta pas mal de sympathie pour les grévistes, attitude qui tranchait avec l’hostilité latente lors des précédentes grèves à la SNCF, en particulier au cours de l’hiver 1986. La sympathie fut en général passive, parfois active : constitution de caisse de solidarité aux grévistes, hébergement de ceux qui occupaient les dépôts du centre de Paris et habitaient trop loin à la périphérie pour rentrer tous les soirs chez eux, etc.
Il y eut des moments où l’on a pensé que les choses iraient plus loin. Mais la dynamique initiale a patiné, puis a été brisée, sans même que les demandes qui l’avaient précipitée n’aient été satisfaites malgré l’amertume générale lors de la reprise du travail et le maintien de poches de résistance particulières.
La répression a été modérée, sauf dans les secteurs ultrasensibles pour le fonctionnement du capital, comme EDF, et elle a visé des irréductibles isolés. Le besoin d’argent, la peur d’en manquer et d’être licencié ont été des facteurs du maintien de l’inertie générale, en particulier dans les secteurs les plus restructurés du capital, où le repli sur soi, la guerre de tous contre tous et de chacun contre soi-même sont désormais de règle. Mais les grévistes eux-mêmes étaient moins tenaillés par le manque d’argent, du moins dans l’immédiat. D’ailleurs, les plus déterminés d’entre eux, lorsque des gens leur proposaient de faire des collectes d’argent, leur répondaient : “ Nous en avons assez de faire la grève par procuration. Faites plutôt la grève vous-mêmes. ”
La critique de “ la grève par délégation ” était pertinente. Elle mettait en relief le comportement plutôt amorphe de la masse des simples citoyens, habitués à déléguer la résolution de leurs problèmes au travail, et ailleurs, à leurs mandataires, officieux et officiels, et donc peu aptes à faire preuve d’esprit d’initiative. D’ailleurs, ils continuaient en général à travailler bon gré, mal gré et, au mieux, défilaient derrière les directions syndicales aux côtés, parfois, d’exclus du travail. Même la masse des grévistes était de moins en moins mobilisée. Elle en restait à la simple reconduction de la grève dans les assemblées générales, à la participation aux manifestations et aux fêtes organisées sur les lieux de travail.
Contre la passivité ambiante, les grévistes les plus combattifs appelaient à “ la généralisation de la grève ”. La formule était ambiguë : elle signifiait qu’ils considéraient leur propre activité, la grève telle qu’ils l’avaient entamée, comme la référence obligée pour tous les révoltés potentiels.
Le déblocage de la situation ne pouvait pas venir de la simple multiplication des grèves. L’extension était subordonnée en partie à la radicalisation, au dépassement du caractère borné des objectifs initiaux qui avaient mis en branle la masse des protestataires. La contradiction entre l’ampleur de la protestation et l’absence quasi générale de perspectives de subversion était évidente, pour ceux qui n’avaient pas perdu leur lucidité. Malgré leur combattivité, les protestataires ont achoppé sur deux questions essentielles, celle de la fonction du travail et celle, concomitante, du rôle de l’Etat, en particulier de l’Etat Providence.
Les grévistes salariés de l’Etat refusaient la dévalorisation de leur situation. Mais ils l’assimilaient à l’atteinte à leur prétendue mission, “ être au service de tous les citoyens ”. Ils valorisaient ce qui fondait leur survie : leur travail. Ils le dotaient de vertus uniques alors que, là comme ailleurs, il est déjà devenu quelque chose de très fonctionnel, sans sens précis pour les travailleurs, sinon celui de leur permettre d’avoir de l’argent et d’être reconnus comme citoyens. Leur seule particularité est d’être partie intégrante du système de communication de l’Etat.
De plus, eux qui avaient su parfois profiter de la fragilité des technologies de pointe sur leurs lieux de travail, n’avaient pas compris les modifications qu’elles avaient déjà induit dans le reste de la société. Ils espéraient que leur grève paralyserait l’ensemble de l’économie et donc forcerait l’Etat a céder sur l’essentiel. Il n’en a rien été.
En région parisienne, le blocage des transports en commun a été total, bien plus important qu’au cours de l’hiver 1986, mais l’impact a été moindre. L’industrie a presque disparu au bénéfice de la finance, de la presse, etc. Là, l’informatisation du processus de travail prédomine. Les entreprises ont été capables, beaucoup plus qu’autrefois, de maintenir l’essentiel de leur activité grâce à la modulation des horaires de travail et à l’utilisation du télétravail. Des managers ont hésité à mettre en œuvre de pareilles mesures car ils doutaient de l’ardeur du personnel et préfèraient l’avoir sous la main pour le contrôler. De plus, la nature du travail ne le permettait pas toujours, en particulier dans le commerce. Mais le ton est donné.
La notion de réseau de communication recouvre de moins en moins celle de réseau de transport. Pour accroître la pression, il aurait été nécessaire que les grévistes bloquent d’autres réseaux, chose difficile à réaliser sans la complicité d’employés des TELECOM, d’EDF, etc. La grève à EDF aurait eu beaucoup plus d’impact dans la mesure où les réseaux de communication ne peuvent fonctionner sans électricité. Mais les directions syndicales, conscientes du danger, ont brisé les quelques grèves qui ont eu lieu à EDF et mis en garde les excités contre “ les actes dangereux pour la sécurité des centrales et des réseaux ”.
Derrière la fixation sur le maintien des avantages acquis apparaissaient en même temps les ambiguïtés envers l’Etat Providence. En témoigne les appels pour garantir l’emploi, voire le revenu sans emploi.
Le système de protection du travail, mis en place au lendemain de la Libération, était indispensable pour reconstruire les bases de l’Etat, prélude à la reprise ultérieure de l’accumulation forcenée de capital au cours des Trente Glorieuses. Les forces de travail étaient alors considérées comme le capital le plus précieux. Les mutations récentes du capital, en particulier les mutations technologiques, ont remis en cause leur centralité et, par suite, l’Etat les traite comme des marchandises dépréciées, à l’entretien coûteux et bonnes à être jetées au panier.
De plus, la domination de l’Etat Providence va de pair avec la mentalité d’assisté. Elle a habitué les citoyens à voir leurs problèmes de survie pris en charge et tranchés par l’autorité suprême, de manière quasi automatique sans qu’ils aient besoin d’intervenir eux-mêmes. Le renoncement a été le revers de la protection. En particulier, elle n’a pas été pour rien dans l’atomisation et l’asthénie relative des rétifs qui, par haine du travail, fuyaient les entreprises pour tenter quelque peu de vivre. Malgré la remise en cause partielle de l’Etat Providence, le besoin d’assistance perdure et favorise la neutralisation partielle des énergies qui, sinon, deviendraient dangereuses pour la société.
Le néolibéralisme est certes inhumain. Mais il ne fait que révéler l’essence intime du capital : pour lui, l’humain ne présente d’intérêt que dans la mesure où il est capitalisable. Désormais, il est plus que jamais de trop. Lorsque le pouvoir d’Etat fait l’apologie du travail, ce n’est pas parce qu’il pense que l’emploi de tous les travailleurs potentiels demeure la condition primordiale de la mise en valeur du capital mais pour tenter de combler à moindre frais le vide de l’inactivité, source de révoltes. L’Etat a horreur du vide. Pour le maintien de l’ordre, mieux vaut n’importe quelle activité que pas d’activité, tel est le credo du néolibéralisme qu’il a d’ailleurs repris des apologistes de l’Etat Providence. Le travail reste la meilleure des polices bien que le mode de fonctionnement du capital contemporain rende presque impossible d’employer tous les humains disponibles, même au rabais.
Il peut paraître paradoxal que des protestataires indifférents à la politique aient pu accorder tant d’importance à la notion de démocratie : face à l’autoritarisme du pouvoir d’Etat, la défense de la citoyenneté leur apparaît indispensable.
En France, le mythe de la souveraineté du peuple a toujours eu beaucoup d’importance dans l’esprit des simples citoyens. Ils y voyaient le moyen d’anéantir le despotisme bien que, sans cesse, il resurgisse de la représentation qu’ils avaient eux-mêmes choisie. Mais jamais le mythe n’aurait pu avoir pareille emprise sur eux si l’Etat ne leur était pas apparu aussi comme leur protecteur, avec la mise sur pied de l’Etat Providence. Non seulement il assimilait, en dernière analyse, les citoyens aux travailleurs mais encore, comme travailleurs, il les protégeait quelque peu, eux et leurs familles, contre les aléas et les risques inhérents à la condition de salariés au service du capital. En France, l’Etat Providence réalisa ainsi jusqu’au bout la démocratisation de l’Etat.
Désormais, les transformations du capital font apparaître la citoyenneté comme pure forme politique sans contenu social effectif. C’est pourquoi la réduction du rôle protecteur de l’Etat est assimilée à la remise en cause partielle, et même totale pour les exclus, du statut de citoyen. Là aussi, le néolibéralisme joue le rôle de révélateur. La démocratie apparaît pour ce qu’elle a toujours été, même de façon plus débonnaire : la domination du capital.
La crise de l’hiver a révélé aussi les paradoxes de la contestation du syndicalisme officiel. Les protestataires ont, en masse, exprimé, bon gré, mal gré, leur refus du néolibéralisme derrière les responsables syndicaux dans la mesure où, à l’exception de ceux de la CFDT, ils faisaient mine de les mobiliser.
Il est pourtant notoire que, au fil des ans, la désaffection envers le syndicalisme a beaucoup progressé en France. A condition de faire abstraction de la période de radicalisation postérieure à Mai 1968, elle n’a pas exprimé le dépassement de la camisole de force syndicale. Elle a plutôt sanctionné l’atomisation, la dissolution des communautés de combat antérieures et la soumission aux impératifs de la restructuration du capital.
Mais la principale particularité de l’Etat Providence, en France, est d’avoir intégré les syndicalistes, qui conservaient parfois leur façade contestataire, aux organes de protection du travail. Le paritarisme donnait l’impression aux troupes syndicales, et leur donne encore en partie malgré la désyndicalisation, d’avoir prise par l’intermédiaire de leurs chefs sur la gestion de l’Etat lui-même.
De leur côté, la plupart des chefs syndicaux redoutaient que la réduction de la fonction contractuelle de l’Etat leur fasse perdre des postes et des sinécures, même si la tendance à participer au mode de gestion néolibéral est forte en leur sein, et pas seulement à la CFDT. De plus, ils savaient que leur reconnaissance par le pouvoir d’Etat, comme partenaires, dépendait de leur représentativité, de leur capacité à encadrer et à dévoyer les combats dans les entreprises, en particulier à attirer et à digérer les individus les plus combattifs qui y apparaissent.
Depuis quelques années déjà, l’heure n’était plus à l’exclusion, sauf à la CFDT, mais à la récupération pour tenter d’élargir la base de la pyramide dont le sommet, hypertrophié, menaçait de ruine. Le parcours des délégués d’entreprise est désormais très différent de celui de la génération précédente. Les plus vieux ont souvent participé aux associations contestataires surgies au lendemain de Mai 1968 hors du contrôle des centrales, en particulier aux comités d’atelier. La faillite de la prétendue politique révolutionnaire les a amenés à consacrer l’essentiel de leur énergie au syndicalisme de base même lorsque, parfois, ils sont membres des groupes trotskystes, anarchistes, etc. Les plus jeunes sont issus des coordinations de l’hiver 1986. Ils sont assez indifférents aux étiquettes syndicales : il n’est pas rare qu’ils adhèrent en même temps à plusieurs structures, y compris la CNT. Leur combattivité est parfois réelle. Mais dans la mesure où ils évoluent dans les limites du syndicalisme tel qu’il est sanctionné par l’Etat, ils sont tolérés par leurs directions comme des éléments nécessaires à leur survie et au maintien de leur influence sur les gens crédules qui, faute de mieux, leur accordent quelque crédit pour tenter de limiter la casse.
Les directions ont bien joué la manche. Le double langage était la base de leur subtil sabotage. Elles ont en partie fait passer au second plan leurs querelles de boutique et tenté de consolider, pour le moment du moins, la branche sur laquelle elles sont assises et qu’elles avaient contribué à scier. De là, les appels démagogiques à “ l’action unitaire et interprofessionnelle par la généralisation à travers le pays des grèves et des manifestations pour le retrait du plan Juppé ”. En réalité, elles refusèrent d’étendre les grèves, en particulier à EDF, monopolisèrent la parole et la communication dans les assemblées de grévistes, encadrèrent les manifestations et les firent dégénérer en défilés inoffensifs et répétitifs afin d’épuiser les énergies et d’empêcher les plus radicaux d’investir les locaux et les rues à leur façon.
La crise de l’hiver confirme la percée du syndicalisme de base rénové, recomposé hors des confédérations traditionnelles et qui inquiète beaucoup leurs directions, en particulier celle de la CFDT. Le modèle en est désormais SUD.
Les références fréquentes des fondateurs de SUD aux sources du syndicalisme révolutionnaire, voire de l’anarcho-syndicalisme pour ceux qui sont aussi membres de la CNT, aux Bourses du travail et aux premières associations qui avaient comme objectif l’émancipation des travailleurs, peuvent faire illusion. De même que leur hostilité au corporatisme le plus borné.
Mais leur démarche est plus le résultat de l’exclusion imposée par la direction de la CFDT que de la réflexion critique. En réalité, ils participent à la rénovation du syndicalisme, rénovation basée à la fois sur la reprise du thème de l’autogestion et sur la prise en compte du phénomène de l’exclusion jusqu’alors négligé par les centrales. Ils combinent la défense traditionnelle du statut des travailleurs de l’Etat à la défense des sans-travail, des sans-logis et des sans-papiers, participent à la création d’associations caritatives et multiplient les relations avec celles, laïques et religieuses, qui prennent le relais de l’Etat en matière d’assistance.
SUD est déjà partie intégrante du mouvement associatif tel qu’en rêvent les purs démocrates de notre époque, champions de “ la défense de la société civile contre les attaques du pouvoir d’Etat ”. Mais le mouvement associatif rénové est déjà pourri avant même d’avoir fleuri : il est issu de la décomposition de l’ancien syndicalisme professionnel, basé sur l’identification des individus à la classe du travail, et de l’émergence des nouvelles associations réformistes, fondées dans le but d’intégrer au travail tous ceux qui en sont exclus afin qu’ils deviennent des citoyens à part entière. Malgré la bonne volonté de nombre de membres de SUD, le syndicalisme atypique qu’ils appellent de leurs vœux n’a rien de révolutionnaire.
L’ironie sur le bureaucratisme des centrales ne les empêche pas de participer aux mécanismes institutionnels dans les entreprises d’Etat, en particulier les élections professionnelles, qui permettent d’être reconnu par l’Etat comme représentants officiels du personnel. L’idée de ne pas abandonner le terrain des institutions paritaires, des comités d’entreprise aux conseils d’administration, aux gestionnaires est archi-éculée. Le terrain est piégé : les délégués y sont admis comme cogestionnaires des forces de travail.
Face à l’institutionnalisation de SUD, des contestataires proposent de limiter le temps de participation des délégués aux organismes de cogestion et même d’élire et de révoquer, au gré des décisions prises dans les assemblées générales, les comités de grève. Mais aucune procédure formelle n’a jamais entravé l’apparition de la hiérarchie au sein des institutions, même lorsque leur base est considérée comme souveraine. Tant que les individus éprouvent le besoin d’être représentés, ils sont toujours confrontés au fait que la représentation qu’ils choisissent échappe à leur contrôle.
En France, il est dans les habitudes des contestataires de tenter d’échapper aux obstacles rencontrés dans les luttes concrètes par le recours aux recettes abstraites. Face à l’incapacité à comprendre ce qui entrave le développement du contenu, des contenus des mouvements en cours, on en revient à l’apologie des formes bien connues. Mais, détachées du contexte qui leur donnait sens et vie, elles ne sont plus que des formules creuses et mortes, des fantômes qui ne font même plus peur aux détenteurs du pouvoir d’Etat et à leurs acolytes, les responsables syndicaux. Parce que les syndicalistes, par crainte de mettre de l’huile sur le feu, ont évité l’emploi du terme de grève générale, des contestataires ont cru y voir la solution miracle. Mais, quelles que soient leurs bonnes intentions, ils n’ont fait que de la surenchère.
La grève générale de Mai 1968 constitue leur valeur refuge par excellence. Là, ils ne font même plus preuve d’esprit critique. Pourtant, le mouvement de masse radical qui éclata à l’époque dépassait le cadre déjà très limité de la grève générale. Il commença à remettre en cause le travail et bien d’autres aspects de la survie quotidienne : la famille, l’école, l’urbanisme, etc. L’occupation des entreprises tourna vite, sous le contrôle des syndicalistes, à l’enfermement et parfois à l’hostilité envers ce qui n’était pas lutte professionnelle. Laissons donc les spectres tranquilles. La page est tournée. Désormais, la structure de la société est transformée en profondeur, avec la marchandisation de l’ensemble des relations et la dissolution presque intégrale des communautés de classe qui, malgré leur corporatisme, résistaient au capital. En France, il est devenu impossible d’identifier les ilotes modernes du capitalisme contemporain, travailleurs et non-travailleurs, aux anciens ouvriers du capitalisme industriel, qui constituait alors le cœur de l’économie, sauf en partie dans les entreprises d’Etat et dans ce qui reste des entreprises industrielles classiques.
Faire grève n’en demeure pas moins important car le travail, comme phénomène de domestication des individus, demeure la base du fonctionnement de la société. Mais le blocage général du processus de travail à l’échelle du pays est moins que jamais le modèle de combat pour tous les révoltés potentiels. L’ensemble des rôles et des camisoles de force qui nous étouffent débordent le cadre du travail. Désormais, le blocage n’est que l’un des moments des mouvements d’insubordination contre le pouvoir d’Etat, contre la société contemporaine. En témoigne déjà les émeutes urbaines endémiques dans les mégapoles des pays les plus avancés qui, malgré le caractère limité de leurs objectifs, n’en sont pas moins aussi très caractéristiques des manifestations de révolte de notre époque.
Il est impossible de dire aujourd’hui de quoi sera fait demain. Rien n’est joué à l’avance pour ce qui est des suites du mouvement de l’hiver. Par rapport à ceux du proche passé, il a réalisé quelques avancées mais, en même temps, a révélé l’existence d’énormes blocages. Bien entendu, ils ne sont pas a priori insurmontables et ne doivent pas devenir le prétexte pour courber l’échine. Rien n’est fatal et comme le rappelle la formule célèbre : “ La force des maîtres repose aussi sur la faiblesse de leurs esclaves ”.
Mais il n’en reste pas moins vrai que les conditions historiques sont modifiées. Le plan Juppé, en particulier, n’est pas que le fruit des lubies néolibérales des technocrates en délire, aujourd’hui au pouvoir en France. Dans ce cas, les grèves de masse de l’hiver auraient suffi pour le faire retirer. Mais, derrière eux, apparaît l’ombre menaçante du véritable ennemi dont ils ne sont que des gestionnaires. L’ennemi est le capitalisme global qui a décidé, à l’échelle planétaire, de porter le coup de grâce à ceux qu’il n’a pas encore matés. D’où la capacité d’encaisser les coups de la fine équipe Juppé.
De plus, les sacrifiés du néolibéralisme sont coincés. D’une part, les plus vieux ne sont guère enthousiasmés par les programmes de transformation de la société issus de la période révolue, programmes en général réformistes. D’autre part, les jeunes ont grandi à l’ombre de la crise dans l’ambiance de nihilisme généralisé qui caractérise le capital contemporain.
Même lorsque la détermination d’en découdre est réelle, l’absence de perspectives globales de dépassement de la survie dans laquelle ils baignent les condamne à des explosions de colère, amples mais sans suite, au moment même où la simple résistance aux empiétements du capital est très ardue à réaliser. Le capital a toujours repris le lendemain ce qu’il avait accordé la veille et l’on ne peut apprécier le mouvement de l’hiver en termes de bilan comptable. Mais la non-satisfaction d’exigences élémentaires participe à la sensation d’impuissance. Nous ne vivons pas que pour les satisfactions de la chair mais lorsqu’elles viennent à manquer, celles de l’esprit sont de piètres consolations.
L’absence de grands buts ne pousse pas à employer des grands moyens, sauf dans des situations très particulières. Le pouvoir l’a compris. Malgré la peur que lui inspiraient les arrêts de travail massifs dans les entreprises d’Etat, il joua beaucoup plus le pourrissement probable que sur la répression sauvage et lâcha du lest sur les revendications catégorielles pour accélérer la décomposition.
Pour lutter contre le défaitisme et le retour de l’atomisation, au lendemain de la reprise du travail, des poignées d’irréductibles ont décidé de continuer à penser et à agir, de façon coordonnée, en prévision de l’hypothétique reprise, à Paris et en province. L’initiative ne manque pas d’intérêt. Mais il est essentiel de comprendre qu’il ne peut être question de reconstituer les comités de lutte, tels qu’ils ont pu exister dans la période de radicalisation ouverte par Mai 1968. Et encore moins les coordinations, à l’image de celles qui ont surgi lors des précédentes grèves, et qui voulaient être les représentantes des diverses catégories socioprofessionnelles en lutte. Sans négliger l’échange d’informations et le reste, il est plus que jamais nécessaire de faire le bilan critique du mouvement d’insubordination auquel nous avons participé. La possibilité de convergence entre les individus qui n’acceptent pas la résignation en dépend. En particulier, la critique du syndicalisme, même atypique, est nécessaire. Elle est difficile car elle peut provoquer l’éloignement, non seulement à l’égard des directions syndicales mais aussi à l’égard des amis, encore plein d’illusions sur le rôle du syndicalisme de base, qui ne la comprendraient et pourraient l’assimiler à la rupture des relations tissées au cours de la grève. Mais c’est aujourd’hui l’une des conditions pour agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes.
ANDRE
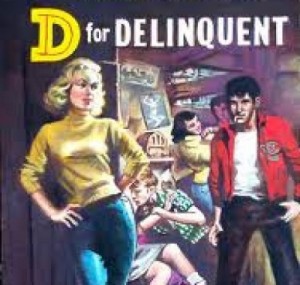
Leave a Reply