“Like a Summer with a Thousand Julys”
Sur les émeutes de 1981 au Royaume-Uni, avec une critique de l’époque.
Ce texte n’a pas été écrit par moi, mais j’ai aidé à la traduction. Le texte original (“Like a summer with a thousand julys”) en anglais est disponible ici.
Chagrin de nouveau-né
« Ma mère gémit ! Mon père pleura,
Dans ce monde dangereux je surgis :
Impuissant, nu, avec des cris aigus:
Comme un démon, caché dans un nuage. »
(d’après les réflexions d’un émeutier de Moss Side, Manchester, vers 1981)[1]
Introduction
Le reste du monde a longtemps considéré la Grande-Bretagne (sauf l’Irlande du Nord) comme l’un des pays les plus libéraux du monde. Cette conception, qui jusqu’à aujourd’hui relevait du réflexe, a pris longtemps à disparaître.
Malgré quelques exemples où le parlementarisme a dévoilé son ambiguïté intrinsèque, en décrétant plusieurs états d’urgence comme lors des courtes périodes de gouvernement national dus à la guerre ou à la récession des années 1930, la mère des démocraties s’est toujours montrée apte à servir la classe dominante. C’est ainsi que, depuis le protectorat de Cromwell, qui a suivi la guerre civile de 1640-1645, le régime n’a plus jamais eu recours à la dictature ouverte.
Beaucoup d’illusions concernant la tradition libérale britannique ont même été engendrées par des gens qui auraient dû mieux la connaître. Le sens général de leurs propos (même si l’on ne s’en est pas souvenu mot par mot) est passée dans les mémoires, d’une génération à l’autre, ce qui a eu pour effet de gêner l’émergence d’une critique radicale.
Marx et Engels (particulièrement ce dernier, qui avait beaucoup d’illusions sur la social-démocratie allemande) allèrent jusqu’à spéculer sur les possibilités de réaliser la révolution sociale en Grande-Bretagne par voie législative. Dans un discours prononcé à Amsterdam en 1872, Marx déclara : « Il y a certains pays comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne où les travailleurs peuvent espérer arriver à leurs fins par des moyens pacifiques. » Ce jugement erroné, qui est beaucoup influencé par le libéralisme anglais, persiste jusqu’à aujourd’hui. Il caractérise le parlementarisme gauchiste, et des petits groupes comme le Socialist Party of Great Britain[2], les trotskistes, les ultra-staliniens de New Communist Party[3], jusqu’aux les groupes qui faisent des campagnes sur un thème donné, des groupes qui sont presque tous orientés vers le parlement (par exemple, l’écologie et l’idéologie de plus en plus professionaliste du mouvement des femmes).
Mais en remontant aux origines de cette autre frange du mouvement ouvrier qui refuse le parlementarisme et la politique en général, nous trouvons les jugements inappropriés de Bakounine sur la Grande-Bretagne ; il exagère dans le sens opposé. Dans Etatisme et Anarchie, Bakounine écrit : « En Grande-Bretagne, la révolution sociale est beaucoup plus proche qu’on ne le pense généralement et nulle part ailleurs elle n’aura un caractère aussi terrible parce que nulle part elle ne rencontrera une résistance aussi désespérée et aussi organisée. » Marx est naïvement pragmatique, quant à Bakounine, c’est l’apocalypse. Il surestime la détermination de la classe dirigeante à résister à tout prix à la révolution libertaire. Tous les deux sont à côté de la réalité, ce qui montre à quel point il est difficile de comprendre cette société déconcertante. L’analyse a tendance à s’embourber dans une sorte de marécage métaphorique et le sang des insurgés morts commence, après quelque temps, à apparaître comme du ketchup pendant que le bourbier enveloppe les partisans. Ou peut-être on saute par-dessus le marécage, escomptant le dépasser pour arriver sur « l’autre rive ». Mais dans l’intervalle le bord a disparu dans l’air comme le chat Cheshire de Lewis Carrol, et on tombe, tombe, tombe. C’est un pays de sous-entendus, d’énigmes, de secrets et de labyrinthes sans fin qui attirent les voyageurs naïfs hors des sentiers battus.
Vers la fin du XXe siècle, la Grande-Bretagne est, pour les bureaucrates de l’Union europien qui siègent à Bruxelles, « l’homme malade de l’Europe ». Les symptômes de « la maladie anglaise » sont nombreux, en y incluant le record sismique de grèves. Contrairement au capitalisme français, qui a un caractère technologique et moderne, le capital fixe de Grande Bretagne est vieillot. La désindustrialisation rapide – et les acres de terre en friche sur lesquelles, quelques années auparavant, il existait des grandes structures industrielles -, semble se combiner harmonieusement à la tradition féodale toujours vivante, dont l’image est exportée dans le monde entier pour attirer les touristes. Un paysage médiéval coexiste, dans une dissociation schizoïde, avec quelques-unes des productions spectaculaires les plus modernes du capital : mode, pop music, annonces publicitaires pleines de blagues, techniques d’exploration du psychisme humain à des fins commerciales (ces techniques inspirées de l’avant-garde artistique des années 1920 et 1930 dépassent de loin la banalité psychanalytique de la « Persuasion Clandestine »[4]).
La Grande-Bretagne, cette société « ouverte » est paradoxalement très « fermée » : elle est gouvernée par une élite patricienne, pénétrée d’un populisme condescendant et rompue à toutes les ruses, à toutes les fourberies, des experts de la récupération de tous les gens situés en-dessous d’eux qui relève la tête en signe de protestation. Dans le même temps, cette élite se démerde toujours pour les traiter comme les membres d’une autre espèce. De presque tous les côtés, on se heurte à la répression quasi totalitaire de la vie quotidienne, issue en dernière analyse de la tradition puritaine et contraire à la tendance du capitalisme moderne. Dans Le Crépuscule des idoles, Nietzsche écrit : « En Angleterre, pour répondre à la moindre tentative d’émancipation de la théologie, ils doivent rétablir leur emprise par la crainte, comme des fanatiques moraux. »
Cette observation combattante est malheureusement gâchée par l’incapacité de Nietzsche à donner une explication de cet état de chose. En grande partie, la force historique du fanatisme moral en Grande-Bretagne résulte de la nécessité de maintenir la classe ouvrière soumise. Surtout dans la première moitié du XIXe siècle, le capitalisme anglais possédait dans sa camelote religieuse un attirail remarquablement efficace d’épreuves mortifiantes, de soulagements abjects et de représentations horribles d’une sexualité mutilée. Tout cela était censé porter secours à la personne humaine, mais contribué en réalité à maintenir la discipline du travail aux fins très profanes d’accroissement du profit.
Ces pratiques religieuses ont disparu, mais les immenses ravages à la façon du Docteur Jekyll & Mister Hyde qu’elles ont infligés dans les esprits subsistent encore. Cette permanence tend à engendrer une sorte d’euphorie malsaine ancrée dans l’esprit de servitude. En fait, cette tradition, vieille de bien plus qu’un siècle et demi, de bêtes de somme élevées dans le respect du labeur et de l’économie, et le mépris du loisir et des oisifs, a suffi pour assurer à Maggie Thatcher une victoire électorale écrasante.
A l’inverse, le refus persistant du travail, que le thatchérisme n’a que partiellement enrayé, prolifère toujours. Mais les vacances plus longues, les arrêts pour raison de « maladie », l’absentéisme payé visent rarement plus haut qu’à passer du bon temps, peinard dans un fauteuil, conformément au principe capitaliste des loisirs. Les congés de Noël, par exemple, spécifiques à la Grande-Bretagne, qui s’étendent jusqu’au Nouvel An, sont vécus par bien des gens comme une épreuve d’endurance d’un vide accablant.
Les loisirs en Grande-Bretagne sont encore organisés autour du maintien de la discipline au travail, bien au-delà de ce qui est nécessaire, même du point de vue de l’aliénation capitaliste. Le monétarisme en tant que philosophie morale est l’héritier d’une longue tradition qui a institutionnalisé le mépris du plaisir. Cette tendance a dû plus ou moins hiberner pendant le boom économique, des années 1950 aux années 1970. Les travailleurs ne furent naturellement pas écartés de faire ces folles dépenses, qui aurait été une absurdité en termes économiques. Mais ils furent traités comme des mômes gâtés, susceptibles, si on leur en donnait l’occasion, de remplir de charbon les baignoires de leurs nouvelles maisons de poupées. Bien que l’économie donnât les clés de l’armoire à jouets, la mansuétude patricienne (par exemple, Macmillan[5]), fixait les règles du jeu de la consommation, de la même façon, essentiellement, qu’on ne laissait pas les travailleurs organiser eux-mêmes leur travail. (Les travailleurs qualifiés qui émigrent, particulièrement ceux qui vont en Hollande, sont stupéfaits de voir la relative absence de surveillance au travail, en comparaison de ce qui se passe en Grande-Bretagne, et par les facilités d’accès au crédit – les gens semblent être traités en adultes; par contraste, le patronat britannique est enlisé dans des attitudes dignes des premiers stades du capitalisme). Résultat : les loisirs en Grande-Bretagne sont vécus de façon frénétique, et chaque seconde se dépense comme s’il s’agissait de la dernière. Contrairement au mythe, la Grande-Bretagne est une société très violente.
Il n’y a pas de place pour les loisirs dans cette société, sauf comme moyen de régénérer les énergies dépensées dans le travail. Les sociétés latines se débrouillent pour conserver un semblant de bonne vie, mais le vin, la bonne chère, les bons repas bien arrosés, le plaisir de la causette ont longtemps été un signe d’appartenance de classe dans ce pays. D’où la tentative d’imposer des règles strictement utilitaristes de la vie sociale, qui pèsent particulièrement sur les chômeurs, lesquels sont parqués, souvent encasernés dans des cellules asexués, menant une existence aliené presque au- delà de l’alienation. Ils mènent une vie ballottée dans le vide, souvent sans le moindre contact social. Leur isolement est encore aggravé par une structure familiale dont la décomposition n’est surpassée qu’aux Etats-Unis.
Mais au cours des dix dernières années, la Grande-Bretagne a connu une agitation sociale profonde. Le pays a vécu dans un état de rébellion pas claire, mêlée au désespoir apparement sans fin de la drogue, drogue, drogue et de la boisson, boission, boisson.
Il y a un chemin qui mène au-delà de ces terrains vagues et, pendant l’été 1981 les chômeurs ont commencé à le parcourir tout seuls. La totalité de la misère et du désespoir produit son opposé. Les nuits étaient jeunnnnes et bien que les pubs fussent fermés, l’eau de feu circulait librement.
En l’espace de dix jours, début juillet 1981, l’Angleterre fut transformée. Rien ne sera plus jamais comme avant. Toutes les grandes villes, et même des petites, basculèrent dans l’émeute de la jeunesse. Des jeunes de 8 à 80 ans, qui s’emmerdaient, s’apprêtaient avec excitation à passer des nuits d’incendies et de pillages. Même des recrues de l’armée en permission les rejoignirent. Si les gosses foutaient le souk, leurs mamies les aidaient en faisant leurs courses gratuitement. A Manchester, une fillette de 8 ans fut arrêtée pour avoir mis le feu à un magasin de vélos et, à Bristol, un retraité paraplégique fut obligeamment amené au supermarché afin de pouvoir prendre part également au pillage.
Commencées à Londres, les émeutes s’étendirent au nord à Liverpool, suivie par d’autres grandes villes du Nord et des Midlands. Jusqu’à maintenant, les gens ont été maintenus dans l’ignorance de leur extension réelle. On a dit et redit que les médias avaient attisé les émeutes (le fameux effet «d’imitation»[6]). A la fin de la semaine d’émeutes-vacances, il était cependant devenu clair que les médias réduisaient l’importance de ce qui se passait dans les villes. La situation était incontrôlable et le chef de la police de Liverpool, Oxford, a fort justement dit que peu de gens réalisèrent combien ses troupes avaient été près de perdre la bataille de Liverpool. L’Écosse et le Pays de Galles (moins touchés il est vrai) furent presque totalement oubliés par les médias. Car reconnaître qu’il y avait eu des troubles là-bas, c’était porter le coup de grâce à ce non-sens sociologique qui prétend que toutes les émeutes furent causées par la jeunesse noire « inadaptée ». Apparemment, il y eut plus de baston la nuit du samedi soir à Glasgow que lors des affrontements habituels au moment de la fermeture des pubs les jours fériés et les anars de Paisley furent bouclés par la police.
Pendant cette glorieuse semaine, la police reçut la déculottée de sa vie. Plusieurs commissariats furent assiégés à Bristol, Southall, Birmingham (Handsworth), Manchester (à Moss Side où des jeunes incendièrent douze véhicules dans la cour du commissariat), Sheffied (un commissariat sans hommes attaqué par des skins) et à Derby, où une antenne de la police de la circulation fut incendiée. La colère de classe de la jeunesse explosait aux quatre coins de l’Angleterre, en attendant de s’étendre à toute la Grande-Bretagne. Il y aura des reculs, mais on espère que l’élan contagieux ne pourra être réfréné et déferlera sur d’autres secteurs de la société aliénée.
Le soulèvement volcanique de tout un pays et touchant l’ensemble de la population dans chaque, cette vision solitaire et à moitié délirante des années 1960 est en passe de se réaliser. A travers les média stupéfaits, les nouvelles tombaient : des émeutes brèves et furieuses frappaient soudainement les villes somnolentes, le Jardin parfumé des Roses de l’Angleterre rêvant, des villes telles que Cirencester, Market Harborough, Dunstable, la station thermale fossilisante de Knaresboro et celle ultra-chic de Southport, où la bourgeoisie du Nord se retire en attendant la mort avec ses pensions confortables. L’ombre des vieux chênes et les sentiers moussus aux vieux noms évocateurs ne furent pas épargnés par ce tourbillon potentiellement révolutionnaire. Il s’est passé la même chose dans les ‘Cremlingtons on the Bumps’[7] rurales qu’à Halifax, cette ville industrielle du XIXe siècle conservée presque intacte. Dans ce musée vivant d’archéologie industrielle, parmi les usines inertes et les cheminées sans feu, décaper à la sableuse pour ressembler un peu à Canterbury, les cocktails Molotov allaient siffler dans l’air redevenu sain. Les services des Monuments historiques pouvaient bien élever les premiers temps de l’industrialisation au même rang que le passé le plus antique, les héritiers de Robin des Bois et de ses joyeux compagnons allaient s’assurer qu’aucune de ces mesures ne se prendrait à leurs dépens. Les villes nouvelles, héritières des cités-jardins socialistes (que Lénine aimait tant et qu’il fit reproduire dans la mère Russie), disposées et surveillées comme de vieilles citadelles, reçurent leur dû. Ce ne fut pas Letchworth, où Lénine vécut un court moment, qui s’enflamma, mais Harlow, une ville voisine.
Le monde avait les yeux fixés sur la Grande-Bretagne et ses habitants furent en passe pendant un moment de s’aligner aux côtés des Chiliens et des Irlandais sur la liste des nationalités opprimées. Il y eut des banderoles dans des manifs au Canada, dont les mots d’ordre soutenaient l’héroïque lutte du peuple anglais contre la tyrannie fasciste de Thatcher ! Cette surenchère gauchiste de verbiage populiste et gonflée à propos de l’Angleterre aurait été tout simplement inconcevable huit ans plus tôt. Même un ayatollah iranien de Qom, rompu à la rhétorique anti-impérialiste, priait Allah pour les émeutiers noirs (mais pas pour les émeutiers blancs).
Pendant la récré, les combattants font du lèche-vitrines radical
A la surprise générale, ce furent les jeunes qui semèrent le plus la merde. Les adolescents entraînaient les gamins ou l’inverse, nul ne peut le dire avec certitude. Bien que l’on ait dit communément que les émeutes furent la conséquence du chômage de masse, les autorités supérieures ont refusé de reconnaître le chômage comme cause des émeutes, parce que beaucoup d’enfants y étaient impliqués. Les autorités ont raison sur ce point précis, mais les gamins savent intuitivement, bien plus profondément que n’importe quel gros bonnet, qu’il n’y a pas d’avenir pour eux dans le vieux monde du travail. Whitelaw[8] a dit : « Beaucoup de voyous avaient entre 10 et 11 ans, et même moins, donc le chômage ne peut être la cause des émeutes. » Les enfants ont, en particulier, joué un rôle déterminant dans la bataille de Liverpool du 8 juillet. Sur les 67 personnes arrêtées durant l’émeute de Park Raad, 21 étaient des jeunes âgés de 8 à 11 ans. Les conservateurs essaient de rejeter la responsabilité des troubles sur le laxisme des parents et la dislocation de la famille. Les relations familiales ont beau se relâcher, la distance entre les parents et les enfants, qui existe même dans les familles ouvrières très unies, n’a pas empêché les premiers de soutenir les seconds.
…On attendait que la nuit tombe…sans savoir ce qui allait se passer. Un gamin qui se casse de l’école en fin d’après-midi et qui crie en direction d’autres gamins : était-ce le signal de l’émeute qui commence ? Qui pouvait le dire? Les adultes le pensaient, mais ils ne le savaient pas vraiment. « Hé, fiston, qu’est-ce qui va se passer cette nuit ? » « A Kilburn ! », telle fut la réponse. Et cinq heures plus tard, la police se préparait pour la bataille de Kilburn, qui n’eut jamais lieu…quelques vitrines brisées, quelques magasins de vêtements pillés, mais le Sinn Fein, aveugle, a continué de vendre sa camelote dans les bars.
Galvanisés, beaucoup de gens plus âgés se joignirent avec entrain à l’émeute, plus particulièrement dans les villes du Nord. S’ils se faisaient pincer, ils ne pouvaient s’attendre à aucune pitié de la justice, et plusieurs écopèrent de peines de prison gratinées. Mais ce fut sur des bases plus quotidiennes que les effets des émeutes se firent le plus ressentir, forçant les gens à relever la tête et à ouvrir les yeux.
Durant les précédents soulèvements prolétariens, la Semaine de Trois Jours[9], l’Hiver du Mécontentement 1979-1980, etc., la vie de ceux qui n’étaient pas directement impliqués avait été suffisamment perturbée pour qu’ils commencent à se demander pourquoi. Mais, cette fois, ils étaient directement atteints dans leurs tripes. Soudain, il y avait une infinité de choses à discuter. Ces événements inouïs et déconcertants étouffaient pour un temps les préjugés et les réactions superficielles. Partout, les batailles de rue dessillaient les esprits fermés, frivoles, dans le vent ou désespérés. Apparaissait un nouveau niveau de réalité, que l’on n’est pas près d’oublier, et le rêve d’utopies lointaines devenait brusquement possible.
Dans les pubs, il y avait un seul sujet de conversation. L’insignifiant tournoi de Wimbledon, le prochain· mariage royal… étaient tout juste mentionnés, alors que la parole avait sa place dans la rue. Est-ce que quelqu’un voulait vraiment voir un film d’évasion, les mensonges et les demi-vérités des documentaires télévisés, ou écouter de la musique ? Rank était sur le point de fermer treize salles de cinoche à Londres, parce qu’elles ne faisaient plus de profit – tout le monde s’en foutait!
Les yeux et les oreilles étaient collés aux nouvelles. Cependant, la version évidemment tronquée des événements présentée par les médias ne signifiait pas que ceux-ci contrôlaient les esprits. On lisait et on recensait entre les lignes les faits frappants. Malgré la presse, la télé et le battage de la radio, les gens montrèrent relativement peu d’animosité envers les émeutiers, du moins dans les grandes villes, sauf la police bien entendu. Quelques sections de la classe ouvrière et de la toute petite bourgeoisie [« lower middle class » signifie pas ‘petit bourgeoisie’ mais le ‘plus bas classe moyenne’; il n’a pas un sens pejorative comme « petit bourgeois »] ont pu être désorientées, mais elles n’ont jamais pensé à tomber sur les émeutiers. En fait, plus d’un spectateur fut inspiré par leur exemple, quand les espoirs et les espérances ensevelis furent déterrés. La violence dans la rue extériorisait la violence réprimée intérieurement, quand la fausse paix de classe annoncée par Thatcher s’effondra dramatiquement et sans prévenir.
“We shall overcome!”[10] (Nous vaincrons !)
(Maggie Thatcher, le vendredi soir de cette semaine d’émeutes)
Les jeunes Noirs furent les principaux protagonistes des émeutes, mais seulement dans le sens où ils ouvrirent la brèche à travers laquelle s’engouffrèrent les Asiatiques, les Anglo-Saxons, les Celtes, les Turcs, les Grecs, les Chypriotes, les Eskimos… Si toutefois ces catégories ont encore le moindre sens. Alors – chantez si vous êtes heureux d’être albino![11]En vérité, la Grande-Bretagne était en passe de devenir l’une des premières sociétés multi-raciales pré-révolutionnaires. Les émeutes n’eurent aucun caractère racial, comme la presse et les politiciens durent l’admettre (sauf Enoch Powell[12], à une émission de radio de la BBC du 7 juillet 1981 ; ici aussi, nous ne parlons pas des fafs comme Charles Parker, du ‘Nouveau Front National’ qui déclare que les émeutes étaient juste l’avant-première d’une guerre généralisée). Mais partout ailleurs dans le monde, l’exactitude fit défaut. L’un des journalistes du Corriere della Sera, probablement accro à quelque idéologie anti-impérialiste des British racistes, écrivit mensongèrement qu’il y avait eu des combats entre jeunes noirs et jeunes blancs à Liverpool. Et, au début, la presse allemande parla elle aussi du caractère racial des émeutes. Ils changèrent de ton les jours suivants. La presse américaine, qui s’aligne sur le New York Times (qui fit lui-même l’erreur de décrire la première nuit d’émeute de Brixton en avril 1981 comme raciste), a opté depuis pour un semblant d’exactitude. Soulignant le facteur de classe, elle note justement que Londres n’a rien vu de comparable depuis les journées d’émeutes de Gordon, en 1780 (The International Herald Tribune). Quoique 400 insurgés aient été fusillés dans les rues de Londres en 1780, il est vrai que les émeutes furent sinon les plus violentes, du moins les plus étendues depuis la Guerre Civile. Et Ned et Lady Ludd peuvent pleurer de joie dans leur fosse anonyme sur quelque lande sauvage du Yorkshire devant l’audace splendide de leurs successeurs.
‘La seule race est la race des rats[13]‘
Bombage de Notting Hill Gate, 1968
Le racisme existe bien sûr en Grande-Bretagne, mais les émeutes dépassèrent les séparations raciales pour les reléguer au second plan. Dans l’appareil d’Etat, certains groupes influents auraient aimé qu’il en fût autrement, et ils ont tenté de provoquer des confrontations à caractère racial. A Derby, la police a refoulé vers les ghettos de Normanton Road et de Peartree des jeunes Blancs qui foutaient le souk dans le coquet centre-ville. Heureusement, cette tactique a échoué, car le baston qui s’ensuivit incluaient des jeunes Blancs, des jeunes Noirs et des Asiatiques, qui, plus ou moins, combattirent ensemble les flics. Etait-ce la simple manifestation du racisme non déguisé de ces derniers, ou le fruit de quelque calcul tortueux pour rompre l’unité de classe ? Il est clair que l’importance accordée à la question raciale était l’un des moyens d’encourager l’hostilité. Mais cette tactique était secondaire par rapport à l’autre systématiquement utilisée, à savoir monter en épingle des actes qui, sortis de leur contexte, paraissaient l’œuvre de bêtes sauvages.
Parmi les pages et les pages de papier-cul écrites sur les émeutes, la plupart ont souligné les différences ethniques et raciales plutôt que les facteurs de classe. Le cadeau de Southall[14] mises à part, tout le monde, sauf la police naturellement, a dû admettre que les confrontations raciales furent alors quasiment absentes. Mais comment tant d’écrivains qui ont fini par dénicher des boulots bien payés, planqués et prestigieux dans des universités ou au Bureau des relations inter-raciales en sont-ils venus à choisir presque instinctivement l’explication raciale plutôt que classiste ? Est-ce parce que la « race » est l’un de ces concepts indispensables à la perpétuation de l’Etat-nation ? C’est sûr que les universitaires dans le vent comme ceux qui font carrière sur le terrain des relations inter-raciales aimeraient voir le statu quo bouleversé. Mais seulement à l’intérieur des limites propres à l’Etat-Nation, en rapprochant, par exemple, le vertueux Etat britannique du modèle du « l’Etat du peuple tout entier » (mesures anti-discriminatoires, etc.). Au mieux, ils ne feraient qu’aménager le racisme sans jamais totalement l’abolir. Il faudrait pour cela l’extension internationale de la révolution prolétarienne, balayant tous les territoires nationaux et tous les Etats. Et ils gardent finalement en réserve tout leur venin et tout leur mépris pour s’y opposer.
En fait, il n’y a pas grand-chose de plus crispant que les réprimandes désaprobatrices de ces différents spécialistes des relations entre les races contre les plaisanteries « racistes ». Ils sont totalement de faire des distinctions en la matière, inconscients qu’ils sont du fait que ces blagues désamorcent plus le problème qu’elles ne l’attisent. Ils semblent n’avoir aucune expérience de situations où les choses se sont passées ainsi. Il est très probable que le Bureau des relations inter-raciales tempère dans l’avenir son attitude, en regard des spectacles en toute sincérité merdiques (Tiswas, OTT[15]) où les minorités raciales commencent à donner autant qu’elles reçoivent. Ce qui reflète une situation très ouverte et beaucoup plus amusante de la part de ceux qui sont situés en bas de l’échelle, là où il y a plus de volonté que jamais d’échapper aux enfermements ethniques, régionalistes ou nationalistes. Etre capable de rire de soi-même est l’un des aspects de ce processus.
Les médias ont semblé à première vue ne pas avoir de préjugés. Mais un fond d’allusions racistes émergeait cependant, en particulier dans les reportages de presse. Dans ces circonstances, c’était prévisible: la bourgeoisie britannique, quand elle est acculée, discrédite plus ses opposants par l’insinuation que par la franche calomnie. Par exemple, il est particulièrement puant d’utiliser le terme « immigré » pour désigner les Noirs dans des quartiers comme celui de Liverpool 8 où vit depuis près de cent ans une importante communauté noire.
Pendant la semaine-congés d’émeutes, la radio et la télé étaient saturées d’interviews prêts à consommer de psycho-sociologues rassis attachés aux universités les plus cotées. Ils finissaient toujours leurs homélies (comment appeler cela autrement !) par la nécessité d’accroître les effectifs de police. Mais c’était du cinéma ! On nous gavera probablement prochainement d’enregistrements et de littérature qui se proposeront d’interpréter ces événements. C’est sûrement le Centre de communication de masse de l’université de Leicester qui publiera quelque rapport sur l’influence des médias sur les émeutes, et non l’inverse, évidemment. Et il évitera toujours à ce que soit soulevée cette embarrassante seconde question !
A Brixton, des émeutiers attaquèrent des photographes du Daily Star, brûlèrent les camions de la société cinématographique ITN et, à Toxteth, ils s’en prirent au reporter du Guardian, qui prétendait être un clochard pour avoir son scoop. Mais c’est triste à dire, les émeutiers négligèrent trop l’infiltration des médias, et beaucoup de pauvres mecs se firent choper par les flics après avoir été identifiés sur des photos. Il y a eu des rumeurs disant que la télé avait remis aux flics des films sur les émeutes. De toute façon, la police enregistrait sur ses vidéos les reportages de la télé.
Les nouvelles à la télé ont dû avoir de l’impact, surtout le premier soir, mais il n’est pas facile de l’évaluer. L’Unité de recherche de l’Institut du film britannique, fondé par la BBC et l’IBA, a déclaré dans une enquête sociologique publiée en 1982 que l’effet « d’imitation » avait été énormément exagéré. Peut-être. Dans une certaine mesure, les gamins ont imité ce qu’ils avaient vu à la télé. Par exemple, des jeunes rassemblés dans la grand rue de Wood Green, au nord de Londres, le matin suivant l’émeute qui eut lieu là-bas, repassaient bruyamment les enregistrements des actualités, juste pour emmerder les flics. Chris, un jeune grec-chypriote de 17 ans, a dit : « J’espère que ça va passer dans les canards. J’espère que ça sera considéré comme une grosse émeute, comme celle de Liverpool. »
D’un autre côté, les jeunes regardent la télé beaucoup moins que toutes les autres generations depuis qu’elle est devenue une partie de la consommation de masse. Les apologistes de l’existant excusent le déclin de l’alphabétisation en expliquant que c’est la télévision qui a provoqué cette évolution historique. Le relatif manque d’intérêt des jeunes pour la télé suggère donc un changement d’attitude fondamental envers les médias en général. Lesquels, on espère, sont en perte d’influence. Les huiles de la télé, selon un article du Daily Telegraph, sont profondement inquiets. Cet article, du 13 juillet 1981 (date de la fin des émeutes), montre comment ce soulèvement violent fait ressortir point par point les craintes concentrées de la bourgeoisie. Les huiles de la télé ne vont peut-être pas seulement se faire virer. Quand l’intérêt pour la téloche décline, elles ont évidemment à craindre pire que le licenciement.
En fait, les flics ont pensé que le téléphone arabe avait été de loin le moyen le plus efficace pour communiquer le message qui explosa simultanément dans tous les coins du pays. De toute la semaine, ce fut leur seule prévision qui s’avéra exacte.
Les sociologues déviants
Les émeutes auront au moins été une source lucrative pour ce tas de débris graisseux que sont les sociologues de la déviance.
L’une de ces célébrités éminentes, l’infect Jock Young, en collaboration avec un certain John Dea, a écrit dans un torchon gauchiste,The Chartist, un article sur les émeutes. C’est un classique du genre, qui finit par accepter avec indulgence ce qu’il venait de dénoncer comme une solution de compromis. Il sait que le Labour Party et les syndicats sont des entraves pour les travailleurs, les empêchant d’acquérir une conscience révolutionnaire. Et maintenant, il propose que les syndicats sortent de leur torpeur et deviennent « des canaux pour l’organisation politique des jeunes qui ont peu de contact avec le travail ». Cela ne peut que conduire aux solutions de compromis qu’il vient de condamner. Cet exemple de pur cynisme révèle la base de son existence : une sinécure à vie, s’entourer de lèche-cul qu’il mènerait à sa guise.
Young ne mentionne pas le nom de « Labour Party reconstruit »[16], mais c’est bien ce qu’il a dans la tronche quand il fait allusion à « l’extension de la démocratie au niveau local » pour « neutraliser » les institutions supérieures. La démocratie de masse que Young prétend vouloir instaurer localement a existé çà et là à la fin des émeutes quand les gens se sont rassemblés spontanément pour discuter des événements. On le montrera clairement par la suite, ces meetings n’étaient pas du tout politiques, et la présence de partis politiques a sérieusement indisposé ceux qui y participaient. Bien que cela n’ait jamais été dit clairement, ces meetings ont été l’ébauche de nouvelles formes de pouvoir contenant en germe la dissolution du pouvoir de l’Etat. Il est donc absurde d’écrire : « Nous assistons au retour des émeutes comme forme d’expression politique pour tous ceux qui n’ont pas d’autre moyen d’activité politique. »
Le parallèle qu’il établit entre ces émeutes et celles de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, quand le prolétariat industriel était en formation, est vraiment tiré par les cheveux. Les illusions régnaient alors sur les miracles de la démocratie parlementaire. Quand la foule incendia le château de Nottingham au début du XIXe siècle, elle protestait contre le retard du vote de la Grande Réforme de 1832. Un bon siècle et demi après, on a bu les réformes politiques jusqu’à la lie. Young en est bien conscient, si on peut tant soit peu se fier à ses propos sur l’Amérique dans le même article, et quand bien même la Grande-Bretagne aurait beaucoup à apprendre des Etats-Unis en ce qui concerne l’assimilation des immigrés. Pourtant, ce fin renard continue ligne après ligne de prétendre qu’il existe des solutions alors qu’il sait aussi bien que personne qu’en dehors de la révolution il n’y en a pas. Bien entendu, l’article se termine par l’appel à la « démarginalisation politique » des centres-villes, au « contrôle plus étroit de la police par les autorités municipales » et à la dépénalisation des drogues « douces », dont la répression est cause de plus d’un baston entre les jeunes Noirs et les flics (par exemple à Notting Hill en avril 1982).
Tout au long des affrontements, les sociologues de la déviance ont eu peur de l’évidence. Dans le passé, ils ont joué à la révolution seulement pour gagner beaucoup d’argent et en même temps se donner des allures radicales et pour avoir des atouts sur le marché de la baise. Mais le rôle de martyrs de la cause perdue du trotskysme ne suffit plus à leurs goûts modés. Ils n’ont pas disparu sous l’horizon en quittant le SWP[17], tout comme le soleil qui s’est finalement levé sur la version bolchevique du pouvoir d’Etat. Ils se tournent maintenant vers le « Labour Party reconstruit »: à titre d’option plus réaliste, qui leur offre un espoir d’argent solide au lieu de leurs vieux rêves tragi-comiques de commissaires du peuple.
L’un de leurs trucs favoris : les envolées de belles phrases radicales, récupérées un peu plus tard à des fins démocratiques bourgeoises. Dans son article sur les émeutes, Young à la langue fourchue prend un ton vraiment enthousiaste. Mais ne vous laissez pas avoir. Un autre d’entre eux, Stan Cohen, dans un article sur les prisons écrit il y a quelques années, disait : « La prison est un point d’ancrage secondaire (et pas nécessairement permanent) d’un processus beaucoup plus vaste de bouleversement social. » (New Society, décembre 1974) Bien fait pour ta gueule si t’es assez bouché pour avoir cru une seconde, comme certains d’entre nous, qu’il s’agissait là d’un fervent appel à l’abolition des prisons. Cette remarque était strictement réformatrice, dans le cadre d’un plaidoyer pour le développement de peines de substitution. Au vu de l’obsession répressive de la justice anglaise, voilà qui pourrait joliment rénover le vernis radical des sociologues de la déviance. Mais le bluff ne marche plus comme avant.
Au cours des dix dernières années, la sociologie de la déviance s’est occupée de la désintégration sociale causée par le capitalisme moderne. Dispersée dans des essais discrets, des livres et des articles, elle a parlé du sabotage, de la survie dans les prisons de haute sécurité, des drogues dures, de la pornographie, du suicide, de la violence des supporters de football, des attentats des Weathermen-Women (applaudis sans réservé, depuis l’abri de la touche sans aucune risque, par cette crapule de Paul Walton).
Influencés au début par l’école de Chicago, ils pillèrent après Mai 68 les théories plus radicales venant de France, en particulier celle des situationnistes, les vidant de tout leur contenu radical. Le but de ces agents de renseignement de l’Etat, qui brûlent un peu les orteils figés des fonctionnaires[18] étatiques, est aujourd’hui comme hier de promouvoir des réformes. Comme pour ces larves de journalistes de rue[19], les fosses où ils se préparent à sombrer ne sont pas encore sondées. Ce gonflé de Jock Young, par exemple, avant d’être effrayé par les révolutionnaires, s’apprêtait à tirer la sonnette d’alarme sur l’économie parallèle. Qu’est-ce que ça peut lui foutre si, par voie de conséquence, la vie de millions de personnes est rendue plus insupportable ?
Enfin, pour mémoire, ces gens sont irrésistiblement attirés par les grands criminels professionnels (comme John McVicar), y voyant sans doute le reflet déformé de leur propre carriérisme de haut vol. Si fort qu’ils puissent protester du contraire, pour eux la petite délinquance est pour les nuls – elle va tout à fait à l’encontre de leur brin d’esprit de réussite. Ayant rejeté le prolétariat, ils sont amenés à rejeter tout ce qu’il y a de prolétarien dans la petite délinquance. Ils ne connaissent ainsi que très peu, et ne soutiennent pas vraiment, la résolution consciente de ne pas voler aux autres prolétaires, que prennent beaucoup de petits délinquants. Jock Young, par exemple, défend l’idée selon laquelle « la plupart des délits de la classe ouvrière ont pour victimes des ouvriers ». Tant pis pour les voleurs à la tire, les manipulateurs des agences de l’Etat bénévole et les autres…
Il n’y a pas si longtemps, Phil Cohen n’avait rien à dire de bien sur les sociologues de la déviance. Il a maintenant sauvé les meubles et fait équipe avec eux. Et comment! Ayant rejeté la « société sans salaires » comme rêve utopique, il doit pour finir s’en prendre à toute autre conception révolutionnaire. Le chemin de la révolution à la réforme est pavé d’une extrême malice : nous n’avons pas été les seuls à rester abasourdis en apprenant qu’il donnait des conférences au collège de police de Hendon.
En conclusion de son expérience là-bas, il propose de créer l’Unité spéciale d’éducation de la police, « composée à parts égales de policiers de formation universitaire et d’universitaires ayant connaissance et compréhension des problèmes relatifs au maintien de l’ordre » (City Limits), cela sous le contrôle du Comité de police du GLC[20]. Ces propositions différent à peine de celles de Shirley Williams, du Parti Social·Démocrate[21], qui, dans le discours prononcé le 6 avril 1982 devant le centre d’entraînement de la police à Hutton (Lancashire) insistait sur la nécessité pour les futurs policiers « d’en apprendre davantage sur l’arrière-plan politique, social et économique du pays et de leur zone d’affectation ». Elle prenait soin, évidemment, de ne pas soutenir les Comités de police à dominante de gauche, mais sur tous les autres points ses suggestions étaient les mêmes que celles de Phil Cohen.
Le caractère social plus que racial des émeutes a éliminé des Collèges de police tout programme de formation strictement ethnique, à l’américaine. Phil Cohen l’a compris mais il n’a pu que taper sur les doigts des apprentis flics sur la question raciale en examinant d’abord les ramifications sensibles du système de classes au sein des forces de police. Ce même dualisme, reconnaissant les classes afin de déprécier leur importance au profit d’un point de vue modéré non révolutionnaire, petit-bourgeois, saute aux yeux dans Knuckle Sandwich, livre qu’il a écrit avec Dave Robins (ancien directeur de Ink, journal underground de la fin des années 1960). Dans ce bouquin, écrit en 1978, des détails empiriques intéressants, comme l’analyse du caractère hétéroclite des supporters hooligans de l’équipe de foot de Manchester, sont entièrement gâchés par la conclusion ridicule : « Le racisme est à l’ordre du jour, pas la révolution. » Les émeutes l’ont proprement démenti, mais pour l’élite libérale, parler de racisme a pour avantage d’éviter le problème plus épineux posé par une guerre de classe toujours plus profonde avec le capital. Et Cohen n’aime pas que le prolétariat, gagnant en indépendance d’esprit, néglige de lui prêter cette allégeance dont il abuse si souvent.
Cohen comme Robins sont des experts pour pomper du fric des organismes de charité, mais l’argent n’est jamais détourné à des fins révolutionnaires. Ce sont plutôt des subventions, par exemple pour le Leverhume Trust, qui servent à installer une autre de ces escroqueries de travail social (comme Street Aid à Soho et Covent Garden). Mais il faut reconnait qu’il a fait des bons choses parce que pendant « The London Street Commune » (la Commune des rues à Londres), en 1969, Cohen a fait preuve de qualités dont les parasites et froussards sociologues de la déviance ont toujours manqué. Même alors, hélas ! il souhaita imposer à ce squat audacieu[22] un projet d’unité de recherche sous-culturelle et archi-subventionné, ensevelissant tout potentiel radical sous un appel au fric d’allure respectable.
Le racisme organisé et la résistance inter-raciale
Le seul gros incident raciste qui eut lieu avant la semaine d’émeutes vient du National Front, qui a orchestré l’invasion skinhead de la communauté asiatique de Southall. La bataille qui s’ensuivit, quand les jeunes Asiatiques vidèrent les fafs des rues et sabotèrent leur concert à Hamborough Tavern, n’est pas, heureusement, représentative de ce qui allait venir. En gros, les attaques racistes, contrairement à l’invasion orchestrée à Southall, tendent à être moins bien organisées et plus individuelles.
Indéniablement, ces dernières années, il y a eu une série d’actes horribles commis par des racistes blancs contre des Noirs et des Asiatiques. Le plus connu s’est passé à Deptford en janvier 1981, quand treize jeunes Noirs furent brûlés à mort après une fiesta qui dura toute la nuit. Le coroner a rendu un verdict de non-lieu, mais à la fin on n’était plus sûr que d’une chose, c’était de la collusion entre les flics, les fafs et les plus hautes instances de l’Etat. De même, à la fin de la semaine d’émeutes, lors des obsèques de madame Khan et de ses trois enfants, une émeute de jeunes Asiatiques a éclaté à Walthamstow, à l’est de Londres. Tous les quatre étaient morts dans l’incendie de leur maison, à la suite d’une attaque aux cocktails Molotov. Dans les deux cas, les flics, ajoutant les insultes au désarroi, mirent en garde à vue les amis et les parents des victimes et les cuisinèrent en espérant pouvoir rejeter les responsabilités du crime sur eux. Monsieur Khan, qui était déjà un homme brisé et se remettait de ses brûlures à l’hosto, fut doublement accablé en l’apprenant.
Ces attaques isolées sont atroces, mais elles ne doivent pas cacher que des Noirs et des Blancs se sont spontanément unis pour combattre les racistes blancs en dehors de toute orchestration gauchiste artificielle. Il y eut la bataille mémorable de Chippenham (dans le Wiltshire), le 30 mai 1981, où, dans un trou de campagne de merde, des Blancs et des Noirs combattirent des Blancs xénophobes après un incident dans une boîte de nuit. Vient aussi à l’esprit l’histoire de ce jeune Noir désespéré, tué à coups de poignard par des skins dans un fish and ships de Peckham, le 20 juin 1981. Plus tôt dans la soirée, il avait été attaqué par les mêmes skins qui allaient le tuer, et des Blancs et des Noirs l’avaient défendu. Mais tous les jeunes qui meurent assassinés ne sont pas nécessairement victimes des racistes. Pendant la semaine d’émeutes, au concert de Black Uhuru à Finsbury Park, un gamin noir fut poignardé par un autre gamin noir, à propos d’un différent quant au partage de leur butin. Pour les Noirs comme pour les Blancs, si la violence ne peut pas s’exprimer lucidement en détruisant les marchandises, elle s’enferme dans la folie. Le racisme fait partie finalement de cette folie.
« Debout dans un coin, balançant une chaîne, V’là un flic qui s’amène, me d’mande mon nom, J’prends mon rasoir et lui fends la gorge, Plein d’sang sur mon blouson de teddy boy. »
(Chanson psychobilly Ted de la rue, des années 1950, County Durham et W. Yorkshire)
C’est un processus très compliqué. Jusqu’a maintenant, il n’y a pas de démarcation nette entre un comportement pathologique et un assaut révolutionnaire imminent contre le vieux monde. Souvent les jeunes brûlent de se baster, par n’importe quel moyen. Après tout, la société est organisée de manière hiérarchique, et ceux du bas de l’échelle savent que tout le monde les méprise. Ils infléchissent les valeurs générales de la société en instaurant leur propre ordre, dont les valeurs vont à l’encontre de celles de la société respectable. Ceux qui ont du prestige sont ceux qui sont dans la bagarre, ceux qui vont le plus au baston. Leur université, c’est du claquage de tronche. Les jeunes, sans cesse traités comme de la merde, trouvent là leur statut et la reconnaissance d’eux-mêmes. Cela s’est fait sentir dans les émeutes, en même temps que ça se transformait en expérience de classe. L’un des jeunes, arrêtés à Manchester pour avoir lancé des Molotov sur des cars de flics, l’a franchement admis à son procès : « J’ai fait ça pour me faire un nom. »
Johnny, t’es trop con d’attendre dans ton coin le raz de marée prolétarien
La jeunesse noire connaît un taux de chômage plus fort que n’importe quel autre secteur de la société. Manquant d’argent pour consommer, son ressentiment a souvent pris la forme d’une agression indiscriminée. Pas étonnant alors que les jeunes Noirs fassent dans l’attaque à main armée[23]. Trop souvent, les victimes de ces attaques sont de pauvres Blancs qui vivent dans les mêmes conditions qu’eux, les gens les moins responsables de leur situation.
Etre noir n’implique cependant pas l’immunité. Pendant le festival antillais de 1977 à Notting Hill, des Noirs comme des Blancs furent attaqués. Pendant le carnaval à Hammersmith, une bande de jeunes Noirs envahit la salle de danse, attaquant et frappant sauvagement les gens. Cet incident fut mentionné par des Noirs plus âgés pour souligner combien ils se sentaient éloignés de leurs propres rejetons. Le mythe de l’identité raciale en prend un coup, quand on entend ces jeunes dénoncés par leurs aînés en des termes que ne renierait pas la police raciste et les magistrats.
Mais ayant exposé la solidarité raciale pour ce qu’elle est, ces jeunes chient sur la solidarité de classe. Quelquefois, ils paraissent traiter tous les autres comme de la merde. Leur fierté tout à fait justifiée d’avoir joué un tel rôle dans les émeutes peut facilement se transformer en abus de pouvoir. Ils sont parfois ivres de leur succès.
Et puis, il y a aussi les complications familiales. Les parents des jeunes Noirs tendent à regarder n’importe quel signe de rébellion ou de fierté avec crainte et suspicion. La rupture des relations entre les jeunes et les vieux Noirs est profonde. L’aggravation de celle entre parents et enfants ne leur est pas spécifique, mais elle est bien plus prononcée dans la « communauté » noire.
C’est un héritage du colonialisme du XIXe siècle. Dans le Jamaïcan Gleaner, quelqu’un a écrit que l’esclavage et les moyens de soumettre les Noirs étaient bien connus. « Mais ce qui en général ne l’est pas, c’est la manière dont nos esprits sont colonisés. » On a imposé aux Noirs les normes de la société victorienne, et ces attitudes ont persisté chez eux longtemps après leurs disparitions dans la puissance coloniale. De nombreux parents antillais et africains sont très autoritaires et prennent des attitudes figées et victoriennes dès qu’il s’agit de discipline.
Bien des Noirs ont livré une bataille perdue d’avance pour maintenir les vieilles traditions, face à une société permissive. Les gamins se rebellent, et beaucoup s’enfuient de chez eux. Certains sont même jetés par leurs parents quand ils les bravent trop ; on retrouve là cette phrase typique des mélodrames victoriens: « Ne remets plus les pieds chez moi! »
Après un an d’existence, l’hôtel pour enfants sans domicile à Waltham Forest comptait 64 jeunes Noirs pour 11 Blancs. Cela rend bien compte de l’intensité respective de la crise de la famille chez les Noirs et chez les Blancs. Dans certains cas, la cause en est la misère, contre laquelle ni les enfants ni leurs parents ne peuvent grand-chose. Mais dans la plupart des autres, ce sont des conflits entre les enfants et leurs parents, sur les dreadlocks, sur l’autoritarisme patriarcal qui conduit des pères à interdire à leurs fils de 17 ans d’avoir des copines, etc., qui posent problème. A Islington, des parents avaient tellement peur que leur fils ait des ennuis, qu’ils le bouclaient tous les soirs. Il s’est enfui à 14 ans. Il s’est finalement fait piquer par les flics avec une bande d’autres gamins, et passa en procès pour attaque à main armée. L’angoisse de ces parents avait entraîné ce qu’ils redoutaient le plus. La discipline que les parents antillais veulent inculquer à leurs enfants est excessivement sévère, et a été critiquée par certains travailleurs sociaux noirs, avec pour effet malheureux que les gamins leur ont accordé leur confiance comme controleurs sociaux au lieu de leur dire de se casser au plus vite. Ce qui a pu arriver à l’occasion. Nous connaissons certains Noirs sans domicile fixe qui ont squatté à Notting Hill Gate et vidé avec perte et fracas le travailleur social rasta du coin, envoyé comme arme secrète para-étatique pour leur faire quitter les lieux.
Certains parents ont exprimé leur hostilité envers la Sécurité sociale et les services sociaux. Il s’agit plutôt d’un point de vue autoritaire que d’une attitude révolutionnaire. Comme l’a dit un Noir à la télé : « Comment puis-je discipliner mon fils quand il peut quitter la maison quand il veut et recevoir de l’argent de la Sécu ? ». Il était aussi hostile à l’intervention des travailleurs sociaux parce qu’ils fournissaient aux gamins Noirs toutes les bases nécessaires pour quitter la maison. Les parents noirs voient ce qu’ils croient d’être une société trop permissive et les services sociaux conspirent à l’effondrement de leur autorité de parentale, et à la destruction de leurs efforts pour bien élever leurs enfants. Une femme noire, dans une lettre adressée au Times dit que les parents sont critiqués pour leur laxisme. « Les parents ont peur d’être trop sévères, par crainte de voir les assistantes sociales débarquer. Celles-ci meurent d’envie d’embarquer les gamins et de les foutre chez de gentils oncles et tantes blancs, où ils pourront recevoir amour et affection. » Ces bêtises méprisantes résument la bonté de l’Etat ; elles rendent même un peu sympathiques ces parents noirs répressifs et neurotiques (fucked up).
Chômage…
Les émeutes qui se déroulèrent pendant le carnaval de Notting Hill, de 1976 à 1979, furent presque exclusivement dues aux Noirs. L’été 1981, tout le monde y a participé. Le chômage, qui avait alors au moins doublé, a contribué aux émeutes, même si tout cela n’a rien à voir avec le mythe austère du « droit au travail » pour les masses opprimées, affamées de travail à n’importe quel prix.
Une étude de l’université de Liverpool portant sur les jeunes de 20 ans qui vivent dans les centres-villes prolétaires a réservé quelques surprises aux cadres guindés des banlieues résidentielles. Pour ce qui vit dans les quartiers du « centre ville»[24] les faits étaient archi-connus, déjà vieux comme les infos d’hier, encore plus de preuve que les universités sont coincées dans leur machine du temps, en train de reveiller à ce qu’est évident. Les résultats furent publiés en août 1980. L’enquête montrait que les jeunes chômeurs n’étaient pas sans travail uniquement parce qu’ils n’avaient pu en trouver ou qu’ils avaient été licenciés. Certains avaient volontairement quitté leur boulot. Pour cause d’ennui principalement. Ensuite, par haine des chefs, par incapacité à supporter leurs collègues de travail et, en dernier lieu, parce qu’ils n’étaient pas contents de leur paie. Les plus jeunes prenaient des travaux manuels mal payés, ne pouvaient s’y résigner, et allaient donc s’inscrire au bureau de chômage. Après un certain temps, l’ennui et la pauvreté de la vie de chômeur leur devenaient insupportables, et ils réessayaient donc de bosser. Ils ne pouvaient supporter ni le travail, ni le chômage. Avec la crise, il n’y avait pas assez de travail pour les employer tout le temps, mais comme les gamins ne voulaient pas travailler en permanence, il y avait suffisamment de boulot quand il leur en venait l’envie. Cet équilibre précaire empêchait tout juste la situation de déborder. Mais, depuis l’enquête, cette situation a dramatiquement empiré, tandis que pour nous l’espoir d’un nouveau monde s’est formidablement ravivé. Pendant les émeutes de Toxteth, il n’y avait que douze offres d’emploi pour ceux qui quittaient l’école. Il n’y avait littéralement rien pour eux qu’ils puissent même accepter.
Ces attitudes différents notablement de celles de leurs parents et grands-parents qui, venant des Antilles dans les années 1950 étaient prêts à prendre n’importe quoi. Les jeunes Noirs nés en Grande-Bretagne espèrent « quelque chose de mieux ». Peut-être plus que leurs jeunes collègues blancs, ils cultivent une image brillante, oscillant entre l’idôlatrie de la musique, de la danse, de la mode et du théâtre, et l’agression facilement provoquée. L’esclavage a beau être aboli, il reste encore bien présent à l’esprit des jeunes Antillais, et certains refusent tout boulot qui en revêt la moindre trace. Une jeune Noire, par exemple, désirait travailler dans le secteur de la mode. Après bien des difficultés, elle s’était démerdée pour trouver un poste de réceptionniste mannequin dans une boîte de vêtements du West End. La nana était enchantée jusqu’au jour où elle découvrit que l’une de ses attributions consistait à faire le thé pour les autres. Elle quitta rapidement le boulot.
… Et criminalité
L’énorme augmentation du chômage a indéniablement provoqué celle de la criminalité. Comme l’a dit un jeune chômeur blanc : « Bien sûr on vole: quand t’es en fin de droits, ce qui arrive rapidement, il faut faire quelque chose pour vivre. Chacun ici le fait. » Certains ont les boules rien qu’en faisant la queue pour toucher l’argent du chômage. Pendant la semaine d’émeutes, des jeunes Noirs ont menacé une longue queue de chômeurs blancs et noirs qui attendaient de toucher leurs allocs à la poste de Hammersmith, poussant tout le monde pour être servis en premier. La police montée, énervée, stationnait aux abords de la poste pour faire face à des troubles éventuels, et ces jeunes Noirs guettaient la moindre occase de provoquer l’affrontement. Mais leur action stupide ne servit qu’à monter les gens contre eux dans le bureau sans air et bondé. Même ainsi, les flics eurent peur d’intervenir.
Le rock des turbans
Nous commençons à assister à la fin du racisme (les émeutes en furent la preuve). Même une crevure libérale comme Raj Nayal, chargé des relations communautaires du Conseil de Leicester, l’a remarqué : « Je pense que nous assistons au mouvement embryonnaire des gamins blancs pauvres d’origine ouvrière qui s’allient avec des gamins noirs pauvres. » (Daily Telegraph, 15 juillet 1981). Et comme un skin chômeur de l’Est de Londres le dit de la bourgeoisie : « Ils sont terrifiés à l’idée que les Blancs et les Noirs puissent se soulever ensemble et prendre d’assaut les banlieues. C’est pas à Moss Side qu’il faut aller faire des émeutes, mais à Finchley et à Richmond. (2) » (Guardian, 10 juillet 1981). Et les Asiatiques, jadis dociles, eurent également leur part dans les émeutes. Leurs gamins rompent avec les valeurs traditionnelles musulmanes, hindoues ou sikhs qui les étouffent. Les aînés de la communauté asiatique rabâchaient aux jeunes de rester tranquilles et de respecter la légalité, mais en vain. Si on veut voir la révolte de l’Islam, c’est en Grande-Bretagne qu’il faut aller : la révolte contre l’Islam ! Les gamins asiatiques ont plus de saloperies à affronter que les autres. Les filles qui ne peuvent sortir qu’avec leur chaperon, les mariages arrangés, les femmes enfermées, toute une culture de résignation passive à votre déstin. Ils rompent à présent de façon décisive avec le cauchemar du passé, en interaction avec les jeunes Noirs et Blancs, dont le respect pour la famille est le plus bas que jamais. Les vieilles valeurs asiatiques s’effondrent rapidement. Malgré ça, la longue tradition de combat des Sikhs a été fort utile à Southall. Les skins racistes s’imaginaient pouvoir foutre facilement la panique dans la communauté locale où les Sikhs prédominent. Ils ont pris une bonne raclée et devront revoir leurs notions d’ethnologie. Les Sikhs ne sont pas soumis comme les Bengalis de l’East End ; au demeurant, même ces derniers commencent à résister avec succès aux provocations racistes. L’estime dont ils jouissaient autour de Bricklane, dans East End, depuis qu’ils ont commencé à affronter sans aide les voyous racistes est montée soudain d’un cran. A Southall, il y a eu une explosion de rage contre la police. Pendant la dernière phase des émeutes, des Asiatiques vivant dans d’autres endroits, en particulier à Bradford, s’y mirent aussi. Là, les flics ont plus tard monté des accusations de toutes pièces contre certains d’entre eux, et leur ont arraché des aveux en les tabassant. Durant les audiences préliminaires (3), il y avait un grand nombre de Blancs parmi les gens qui se tenaient aux abords du palais de justice.
Bien que les flics ne les harcèlent pas autant que les jeunes Noirs, les Asiatiques se plaignent constamment de l’indifférence de la police envers les attaques racistes et de son incapacité à les protéger. En dépit des illusions sur la démocratie inhérentes à ce genre de raisonnement, ça représente au moins un pas dans la direction d’une autodéfense organisée.
Un incident qui a particulièrement mis les boules aux jeunes Asiatiques de Southall, c’est lorsque trois racistes blancs gravèrent une croix gammée sur l’estomac d’un des leurs. Les flics ne le crurent pas et l’accusèrent de leur faire perdre leur temps. Beaucoup de jeunes Asiatiques en veulent à leurs aînés qu’ils accusent de passivité envers les attaques racistes et l’indifférence de la police. A Southall, en réponse, des jeunes militants se sont eux-mêmes organisés en Mouvement des jeunes de Southall, pour se défendre, préférant ne pas se fier aux organisations établies, dominées par les anciens. Pas mal d’anciens sont des petits commerçants, sous-directeurs de supermarchés ou propriétaires de restaurants, qui ont un intérêt direct à protéger leur capital. L’Organisation des travailleurs indiens, au nom bien trompeur, est dominée par cette clique. Les divers comités de défense appellent aussi les Asiatiques à baisser les bras. Le comité contre le racisme de Coventry, par exemple, composé de conseillers municipaux et de représentants des syndicats, n’est qu’un salon gauchiste. Son but principal est maintenant de dissuader les jeunes Asiatiques de s’organiser contre la police et les fafs. Et ce comité désigne sans honte et probablement en toute conscience ce mode d’auto-organisation par le terme de « vigilance », utilisé aux Etats-Unis avec une connotation fascisante.
La fracture qui se développe donc dans la communauté asiatique correspond jusqu’à un certain point à celle qui divise la communauté noire. Il y a diverses raisons à cela, qui ne font pas toutes partie clairement d’un progrès de classe. Mais l’important, c’est que les comportements réactionnaires, et néfastes à la lutte de classes, en particulier la religion et le statut des femmes chez les Asiatiques, soient en même temps largués.
L’attitude des Blancs a également rapidement changé. Le respect des travailleurs blancs pour les travailleurs asiatiques a sérieusement augmenté depuis que ces derniers ont commencé à lutter. La longue lutte, menée par des dactylos en majorité asiatiques à l’imprimerie impériale de Leicester, en 1973, même si elle fut orchestrée par les syndicats et a véhiculé des illusions en pagaille, a néanmoins forcé l’admiration des travailleurs blancs du coin, qui avaient souvent auparavant formulé des sentiments racistes dégueullasse à leur égard. Se révolter contre les patrons, ne pas se permettre de plier devant les flics ou autres autorités, c’est le plus sûr moyen d’enrayer les attitudes racistes des prolos blancs, qui sont dans la même situation. Ils deviennent alors alliés dans la lutte pour la révolution libertaire. Pendant l’émeute de Luton, du samedi 11 juillet 1981, des Blancs et des Asiatiques se déchaînèrent ensemble. Il y avait eu un méchant battage raciste dans la ville auparavant, mais cette révolte « multi-raciale » fut un brillant exemple d’unification de l’émeute. Une fois déchaînée, il n’y eut aucun moyen de stopper la foule, et les commerces des « frères » noirs et ceux de la communauté asiatique à Moss Side, Brixton et Liverpool ne furent pas à l’abri de l’attaque bien plus fondamentale contre les relations marchandisées.
On doit aussi avoir en tête qu’il y a eu pas mal de grèves « multi-raciales ». Le facteur classe importe plus que celui de race dans le travail, en Grande-Bretagne. Au travail, quelle que soit la couleur de la peau, les gens sont traités pareils. C’est-à-dire comme de la merde ! La politique de diviser pour régner, dont la vague d’immigration d’après-guerre a fait les frais, a explosé à la gueule de ses instigateurs. Que ce soit pour de bonnes raisons ou non, les syndicats s’en sont rendus compte.
De toute façon, il est ironique de constater que les salaires des travailleurs anglais sont souvent inférieurs à ceux des travailleurs émigrés dans bien des pays de la CEE. Les ouvriers blancs, qui sont la force de travail majoritaire, acceptent de se soumettre à des conditions normalement réservées aux émigrés dans la plupart des usines de construction automobile sur le continent européen. Plutôt par chance que par gestion intelligente, l’Etat britannique n’a pas réussi à créer une couche de travailleurs blancs privilégiés, qui se comporteraient en contremaîtres des « immigrés » moins privilégiés. Il va donc rencontrer de nombreux obstacles s’il essaie délibérément de réorganiser les travailleurs blancs autour de la question raciale.
Les skins sont-ils mal dans leur peau ? [25]
L’affrontement transforme les attitudes avant de transformer la réalité. Des skins commencèrent après la bataille de Southall à se départir de leurs mauvaises habitudes. De fait, beaucoup d’entre eux en venaient même à s’excuser. Comme l’un d’eux l’a dit dans une fiesta à Peckham, immédiatement après Southall : « Pourquoi est-ce qu’ils pensent que tous les skins sont des nazis ? C’est pas parce que je suis blanc et prolo que je suis forcément raciste. » Plus tôt dans l’année, un skin cité par le Guardian du 23 mai 1981 a souligné que les adolescents rejoignaient les groupes de droite « juste pour le baston » et « qu’il haïssait aussi les flics ». Malheureusement, le gars larguait les valeurs les plus extrêmes du capitalisme pour des valeurs opposées, plus attrayantes, mais pas moins pourries : celle de la Ligue anti-nazie. Les skins sont la version survoltée des hordes cosaques, ils veulent par-dessus tout de l’activité et de la vie, mais toujours, ou presque toujours, par le biais de provocations. Pendant la semaine d’émeute, certains d’entre eux se joignirent souvent aux Noirs, à Brixton, Croydon et Upton Park, au nord de Londres. Plus au Nord, à Leeds, un fort contingent de skins venus de tous les coins de la ville se joignit à la jeunesse noire de Chapeltown. Il y a aussi quelques skins juifs qui provoquent sans cesse les juifs réactionnaires hassidiques.
Dans certains coins, il y a des relations plus permanentes entre les skins et les Noirs. C’est pas pour rien que les skins de Notting Hill à Londres se font traiter de « skins bolchos » par les autres membres de la confrérie maudite ; cela ne signifie pas qu’ils se font infiltrer par le PC local ou par les trotskystes, ni même qu’ils sont tombés dans l’ambiance libérale de gauche du coin. Ils ne sont pas, bien sûr, complètement imperméables à cette dernière. Mais ils sont pratiquement les seuls skins à défendre clairement leur point de vue. Ils ont été calomniés en 1979 et accusés d’être un bataillon du National Front, quand certains de leurs membres se virent refuser l’entrée à un « Rock Against Racism » à Acklam Hall. Ils rendirent violemment coup pour coup et détruisirent, entre autres choses, deux camions transportant la sono. L’un des responsables du concert les a décrits comme des voyous racistes, mais à l’extérieur d’Acklam Hall, il n’y avait pas de démarcation nette. Quand les skins, les punks, les rude boys et les rastas se mirent à se baster, la plupart des Noirs plus âgés, rassemblés sur les marches du garage où était installée la sono, regardaient le grabuge sans s’émouvoir, et n’exprimaient aucune préférence. Les skins de Notting Hill Gate en eurent tellement marre des articles parus dans la presse musicale, qu’ils écrivirent une lettre collective au New Musical Express, refusant toute implication avec des groupes racistes. En vain. Le consensus libéral de gauche a dit qu’ils avaient joué les hommes de main du National Front dans la prétendue attaque d’Acklam Hall, dans le film Breaking Glass, dont la vedette est l’immonde Hazel O’Connor. Tout ce que cette imbécile sait faire, c’est utiliser ses relations du showbiz pour endosser le rôle de rebelle punk superstar.
Les skins possèdent toutes les qualités et les défauts des barbares et des vandales des temps modernes. En une semaine, en mai 1981, ils incendièrent à coups de Molotov des clubs indiens et du Commonwealth et un temple d’Hare Krishna à Coventry. Qu’est-ce qu’ils avaient en tête ? Le dépassement de la religion ? Et même si de tels actes sont inutilement barbares, ça peut passer. Ils ont après tout saccagé des églises méthodistes made in England, sans avoir eu la même publicité. A l’inverse, pendant les émeutes à Derby, on a vu un groupe d’Asiatiques porter une grande croix à travers les rues. La croix fut récupérée par la suite mais Notre Sauveur a été volé. On l’avait fauché. Ce n’était pas une protestation islamique contre la mise en représentation, mais probablement une saine réaction contre une bande de jeunes catholiques qui défilaient avec la grâce d’un troupeau d’éléphants dans Derby, quasiment un ghetto, en chantant « We shall overcome. »
Néanmoins, les actions contre les symboles religieux à Coventry furent interprétées comme des actes racistes par les Asiatiques, et c’est une accusation que l’on ne peut facilement écarter. Les skins frappent souvent le bon ennemi, mais leur cruauté indiscriminée (ils se sont attaqués à des retraités âgés, etc.), comme celle des Noirs qui attaquent les passants, fournit aux journaux le matériel rêvé pour faire des manchettes sensationnelles. Les titres à sensation sont bourrés de nouvelles sur les guerres en cours, mais l’information qu’ils aident à véhiculer est une psychose d’anarchie meurtrière. Cela a pour avantage de maintenir le prolétariat craintivement calfeutré dans les petites cases de l’existence routinière. Les skins peuvent parfois extirper les riches de leurs voitures de luxe à Chelsea, balancer insolemment une poignée de biffetons de cinq livres à la gueule de Sir Alex Douglas Home, ancien Premier ministre, et s’évanouir dans la nuit. A d’autres moments, ils succombent à une rage folle, dénuée de tout contenu de classe.
Emeute skin à Sheffield
Quelques semaines avant les grandes émeutes, il y eut un exemple éclatant de la conscience de classe skin. Un samedi, des skins et une poignée de Noirs et de punks (c’était déjà une rupture des séparations) organisèrent eux-mêmes une manif à Sheffield contre le harcèlement policier. Les skins gueulèrent à la foule des slogans improvisés, avant d’aller dévaster le centre-ville. En route, ils causèrent des milliers de livres de dégâts au Crucible Theater qui, avec ses cent mille livres de subvention accordées par le conseil municipal de Sheffield, avait déjà été envahi cinq fois dans les dix-huit derniers mois, par les mods, les supporters de foot et les skins. Ces mecs et ces nanas ont du goût, parce que le Crucible Theater, temple du théâtre « éclairé » gauchiste, a donné asile à toutes les nuances de la mauvaise conscience de gauche, jusqu’aux Saddista Sisters et à Red Ladder (ou, comme il est maintenant connu localement, Gets Sadder, « Devient plus triste »). S’il y a quelque chose qui fait voir rouge aux skins, c’est ce mélange de culpabilité cessante et de supériorité, typique du public qui fréquente le Crucible Theater. Un skin et sa petite amie le trouvèrent hostile parce qu’on les décrit toujours dans les scénarii comme des barbares, qu’on leur cherche des crosses en les prenant comme exemple de tout ce qui est malsain. La culpabilité est un luxe qu’ils ne peuvent s’offrir. En refusant cet aspect de la culture, ils faisaient de leur action une protestation de classe. Comment Bruce Burchall, un organisateur culturel de la région, s’est-il senti après ces événements ? Parions gros qu’il a opportunément oublié avoir jadis appelé à une attaque totale de la culture !
Deux travailleurs sociaux avaient implanté dans les têtes skins l’idée d’une manif, quand ils leur suggérèrent d’appeler à un meeting de protestation. Le Labour Party de Sheffield avait ensuite participé à l’événement, ainsi que le député européen du coin, présence encore plus grotesquement déplacée ! Après, comme d’habitude, un membre du Labour Party, David Morgan, rejeta la responsabilité des troubles sur une minorité de vandales. Mais, comme le montre très précisément le Sheffield Telegraph du 22 juin 1981, on a estimé en gros à cent cinquante les éléments qui ont détruit le Crucible Theater, et la marche ne comptait que deux cents participants !
Bien que le Labour Party local ait été tenu pour coupable de s’être associé à une telle entreprise, les principaux accusés sont les travailleurs sociaux, selon le commissaire de police, Brownlow. Comme tant d’autres dans l’appareil d’Etat ultra-répressif, Brownlow ne peut pas blairer les flics « cools ». Pour des raisons inconnues, il n’existe aucune reconnaissance du parallélisme de leurs fonctions respectives. Après tout, les travailleurs sociaux n’ont jamais approuvé le pillage du Crucible Theater. [26]
A Sheffied, les skins furent au mieux de leur forme. Pendant la semaine d’émeutes, 2500 flics ont été en état d’alerte, plus en fait qu’en janvier-mars 1980, pendant la grève de la sidérurgie, quand les sidérurgistes et les mineurs essayèrent d’interdire l’usine de Hadfields aux jaunes.
L’enfer à Hull…
Hull se trouve à 80 kilomètres au nord-est de Sheffied. Pendant la semaine d’émeutes, il s’y est joué une histoire bien différente et qui résume certains des pires aspects de l’activité skin. Après avoir saccagé le centre-ville, des bandes rivales de skins, de punks, etc., se sont tombées dessus. Des symboles de la richesse, comme la Société du bâtiment de Leeds, et bon nombre de grands magasins comme Binns furent pillés. Mais excepté des slogans anti-flics (un gars fut enchristé pour avoir gueulé « Mort aux vaches ! »), la conscience de classe ne s’est généralement pas élevée bien haut.
En gueulant des slogans de foot, certains émeutiers firent une tête à des gens qui attendaient le bus. Un jeune lança un bloc de béton à travers la vitre d’un bus, alors que des passagers étaient encore dedans.
Pas étonnant que cette réponse incohérente ait créé une sympathie passagère pour la police chez certains travailleurs des transports de Hull. Les représentants locaux de la TGWU, avec l’appui des syndiqués, fermèrent la station de bus Ferensway, qui était au centre des émeutes, en accord avec les flics et la Direction des Transports. Le Daily Mail de Hull s’est bien frotté les mains quand les travailleurs, les flics et la direction se sont entendus pendant cette semaine d’émeutes prolétariennes dans ce trou de province.
Au cours des dix dernières années, la classe ouvrière de Hull a fait montre d’une radicalité notable y compris lors de l’Hiver du Mécontentement, ce qui rend cette réaction doublement triste. Ils ne sont pas par nature hostiles à la violence de classe et au sabotage. Par exemple, pendant la grève des dockers de 1972, des dockers de Hull coupèrent les amarres des bateaux ancrés aux quais à containers. Mais ils n’allèrent pas jusqu’à vider d’innocents membres d’équipage pour leur administrer une raclée, comme les skins locaux auraient pu le faire, si l’on en juge par leurs performances pendant la semaine d’émeutes.
Personne ne peut savoir à l’avance si les skins vont virer à droite ou à gauche, ou s’ils vont foncer droit contre un mur de briques. Il y a des bruits qui courent comme quoi des orgas fafs gavent les skins d’alcool, de drogue et de bobards racistes avant de les envoyer exécuter des sales boulots.
Certains skins pourront à l’avenir être recrutés par des orgas paramilitaires telles que la Colonne 88, la Leaderguards ou la Ligue de Saint-Georges. Cette dernière est réputée pour ses liens avec le cœur du plus secret des appareil de l’Etat. Le terrorisme manipulé gagne en importance dans le monde entier (par exemple en Italie – les Brigades Rouges -, en Espagne – le GRAPO -, ainsi qu’en plusieurs cas vérifiés en France, au Brésil et sur une moindre échelle au Chili) et il n’y a aucune raison de penser qu’il ne pourrait pas faire partie en Grande-Bretagne aussi d’une stratégie contre-révolutionnaire.
Les armées coloniales de l’Empire britannique ont utilisé les atrocités terroristes et, aussi récemment que sous le gouvernement Heath, des agents provocateurs (les Littlejohn Brothers) furent utilisés pour infiltrer l’IRA et s’acquitter de coups de main en République d’Irlande. Les noms de leurs patrons sonnent comme un extrait du Who’s Who : Lord Carrington, Secrétaire à la Défense, Geoffrey Johnson Smith et enfin l’amie des Littlejohn Lady Pamela Onslow, une ancienne assistante sociale. Ils n’ont jamais réfuté les accusations portées contre eux par les Littlejohn Brothers[27].
Les groupes fascistes ont fatalement gagné des membres après et avant les émeutes, mais les médias étaient obsédés par les « preuves » démontrant l’infiltration de l’IRA et des gauchistes. La face cachée du mouvement· ne pouvait être qu’une des deux. The News of the World, du 19 juillet 1981 rapporta avec frénésie que des leaders du Black Power avaient établi un premier contact avec deux responsables de l’IRA Provisoire à Chapeltown (Leeds). Porter des passe-montagnes suffisait pour prouver à la presse l’engagement de l’IRA. En fait, les passe-montagnes servaient à protéger la face cachée de l’émeute vis-à-vis de ces vampires de photographes.
Finalement, la Special Branch, se raccrochant à n’importe quoi, mit la main sur un couple suspect de terrorisme. J. Weir et son amie italienne furent arrêtés pour avoir prétendument lancé un Molotov durant les émeutes de Brixton en avril 1981. Bractach Dubh, l’organisation à laquelle Weir appartient, avait fait un éloge critique des Brigades rouges dans une brochure intitulée La lutte armée en Italie. Un refus de condamner le terrorisme manipulé d’Etat rend le travail de la presse un peu trop facile, quand elle suggère que la violence de la rue est manipulée par des mains invisibles.
Le Soupir de l’Oppresseur oppressé
Travailleurs sociaux et animateurs culturels
Ces douze nuits, début juillet 1981, furent un point de rupture. La possibilité d’une révolution reste à la fois réelle et éloignée. Les jeunes ont combattu vaillamment les flics, mais quand il s’agit de se heurter à d’autres corps intermédiaires de l’Etat – le travail social,les alternatifs, la culture – ils se laissèrent facilement détourner. Bien que les arguments spécieux des travailleurs sociaux aient été largement ignorés durant la semaine d’émeutes, les clubs de jeunes n’étaient pas encore attaqué consciemment. Quoiqu’il y ait souvent de la casse en douce, un seul club de jeunes a été ouvertement attaqué. C’était pendant une petite émeute à Leicester, l’été 1980, quand une majorité de jeunes Noirs attaquèrent un club de jeunes. Cet incident ne fut pas rapporté par la presse nationale.
En ces temps difficiles, les clubs de jeunes doivent accueillir un nombre croissant de jeunes chômeurs. Ils sont donc pleins à craquer et les animateurs, débordés, commencent aussi de craquer. Comme ils ne peuvent pas recruter plus de personnel compétent, le préchi-précha de ces animateurs est limité par les compressions de personnel et la vétuste de l’équipement [« réductions de l’aide de l’état » est plus correcte, je pense]. Résultat : les gamins sont un peu plus libérés de l’effet paralysant du « travail social ».
Physiquement, les travailleurs sociaux qui s’occupent des jeunes sont souvent des poids plumes qui doivent combattre des poids lourds. Ils sont extrêmement réticents à appeler les flics, encore qu’ils aient souvent besoin de protection pour eux-mêmes. Ils prennent en tremblant une des nombreuses clés de leur trousseau, et ferment consciencieusement la porte derrière eux pour protéger le club de ces mains qui ne ratent jamais une occase pour chiper quelque chose. Au plus profond d’eux-mêmes, combien ne rêvent pas d’être un James Cagney, plus fort que ces parvenus pas tellement angéliques[28] à ce jeu.
Depuis la systèmatisation du travail social a vraiment commencé de se développer dans une façon très importante pendant les années 1880. Le travail social, comme representation des valeurs capitalistes plus spirituelles, a rejeté les frissons faciles que le marché a offert. De nos jours le marché privé des loisirs pour jeunes, davantage expert pour attirer leur attention, est une source de concurrence ennuyeuse pour les animateurs. Ils n’aiment pas la commercialisation effrénée des jeux d’arcades et des centres commerciaux, avec leurs Space Invaders, où la seule autorité est celle du changeur de monnaie. Confrontés à ces rackets fascinants, les clubs de jeunes doivent faire des concessions, ou risquer de perdre toute leur clientèle. Mais nager avec le courant, c’est aussi admettre la défaite de leur projet propre, et il y a quelque chose de sacrilège dans le spectacle de travailleurs sociaux essayant d’être aussi adroits que les premiers gamins du coin à jouer aux Space Invaders[29] sur l’une des deux machines du club. Et le marché amène une tendance à la rechute le jour où le travailleur social se casse.
Etant de plus en plus mécanisés (vidéos, sonos, chambres à musique, studios d’enregistrement), les clubs de jeunes se trouvent obligés de recruter des travailleurs sociaux techniquement compétents, des bricoleurs. Engagés malgré une capacité idéologique moindre, ils ont tendance à se foutre de la gueule de leurs collègues exténués, qui lisent sagement The Guardian, New Society, etc., et ne jurent que par eux, comme ils ont été dressés à le faire. Cette attitude cynique touche au point sensible dans un milieu connu pour sa naïveté professionnelle. Seul l’avenir dira s’il est capable de progresser au-delà du pur cynisme.
D’autres pressions égarent les travailleurs sociaux. Certains gagnent le respect des gamins en enfreignant la loi sur de petites choses et se font passer pour plus durs qu’ils ne le sont généralement. Se tenant eux-mêmes en haute estime et tenant à l’estime des autres, ils sont sans cesse sur la brèche pour se prouver leurs capacités. Il arrivera peut-être bientôt un jour où, à cause de leur vantardise, ils seront obligés de lancer des cocktails pour sauver les apparences. S’ils se font gauler, ils ne manqueront pas de s’apercevoir qu’ils ont bazardé leur boulot mais sans doute trouvé les clés de la taule !
Il y a longtemps que n’existe plus en Grande-Bretagne de relation manifeste entre la grande propriété et le travail social. On retrouve, chez les travailleurs sociaux d’aujourd’hui, des échos de cette « nouvelle conscience du péché chez les gens de bien et d’esprit » chère à Beatrice Webb, mais ce mélange de culpabilisation et de crainte d’être soi-même exproprié, propre au XIXe siècle, a largement régressé. La fonction moralisatrice du travail social s’est progressivement détachée de la défense de la propriété individuelle pour devenir davantage un problème de protection de l’Etat en tant que capital collectif. Les travailleurs sociaux d’aujourd’hui craignent davantage la remise en question de leur rôle que l’expropriation de leurs biens, qui sont plutôt maigres. Mais les bas salaires, les longs horaires, l’astreinte au travail, tout cela permet à pas mal d’entre eux d’estimer que leur rôle aggrave tout simplement la misère sociale.
Le plus grand danger vient de ces grandes gueules d’idéologues marxeux qui s’efforcent de protéger les travailleurs sociaux des effets dévastateurs de la crise sociale et individuelle qui les guette. Prétextant que l’Etat n’est pas un bloc monolithique dont la seule fonction serait de défendre les intérêts de classe de la bourgeoisie, ils encouragent les travailleurs sociaux démoralisés à rempiler joyeusement. Ils les persuadent qu’une fois reconvertis des valeurs libérales et chrétiennes à une approche marxiste, ils pourront enfin aider le prolétariat. Mais les travailleurs sociaux ont-ils jamais pensé faire autre chose ?
Les travailleurs sociaux ne peuvent prendre eux-mêmes d’authentiques initiatives d’action, alors que ceux qu’ils encadrent échappent à tout contrôle. Toutefois, il arrive qu’ils dépassent leur schizo et se joignent soudainement aux émeutiers. Ainsi un éducateur fut arrêté pour avoir lancé un cocktail à Brixton en avril 1981. Il fut condamné un an plus tard à trois ans de taule. Au procès, le juge a déclaré que s’il n’avait pas été auparavant un « bon gars » et un travailleur social, il aurait pris bien plus. Manifestement, pour certains, le travailleur social a encore la cote. Parmi les gens arrêtés et présents lors des scènes d’émeutes, il y avait un nombre impressionnants d’instits et de profs de gym ! La pression du prolétariat, les contraintes du boulot les ont entraînés tout comme les travailleurs sociaux à agir de cette façon explosive et tout à fait non professionnelle.
L’instit-balance
En cette époque de chômage généralisé des jeunes, le travail social affronte les mêmes contraintes que l’enseignement (d’ordinaire plus pour des raisons de coupes budgétaires qu’à cause d’une augmentation du nombre d’enfants) : charge de travail augmentée et beaucoup, beaucoup plus de flicage. D’ailleurs, il y a eu durant les huit dernières années un lent mais sûr processus d’élimination des instits les plus libéraux et « rebelles », ne laissant qu’un noyau d’instits conservateurs ou qui, tout simplement, les mouillent. La déclaration de Sir Keith Joseph[30] (6 janvier 1982) demandant aux autorités locales de trouver « de meilleurs moyens pour se débarrasser des enseignants inefficaces » n’est que la toute dernière en date d’une longue série de critiques similaires.
Les contraintes du travail contribuent à un raidissement de l’attitude des instits et à une position défensive confinant à l’hystérie. Qualifier, en présence de profs de lycée et de collège, l’éducation d’aujourd’hui de conditionnement forcené équivaut à une déclaration de guerre. Dans ces conditions, le recueil d’éléments vraiment essentiels, qui permettraient de dresser un tableau fidèle de la situation dans les écoles, est bloqué par des justifications grossières et crasses. Une analyse du changement et de la fonction des collèges est nécessairement fragmentaire car les détails manquent. Les enseignants ne mouftent pas devant la réalité choquante dont ils sont témoins.
Mais les activités policières dans lesquelles les instits sont progressivement impliqués ont été révélées avec une clarté effrayante et salutaire à Toxteth. The Times a rapporté que « pendant la semaine d’émeutes, des enseignants ont déclaré qu’ils avaient vu non seulement les élèves de leurs propres écoles de Liverpool parmi les émeutiers, mais ceux d’écoles situées hors de la ville. » Sans commentaire.
Bien que les enseignants dans le privé ne soient pas obligés de soutenir le point de vue des Comités d’éducation, ils sont en pratique contraints de suivre le mouvement – ou de risquer des mesures disciplinaires et le licenciement. A Liverpool, par exemple, il y a une concordance frappante entre l’opinion du Conseiller Michael Storey (Président du Comité d’éducation de Liverpool et proviseur d’une école à l’extérieur de la zone de l’agglomération) et celle du Ministre de l’Intérieur, Whitelaw : « La responsabilité parentale s’est évanouie. Il est scandaleux d’ignorer où se trouve son enfant de 8, 9 ou 10 ans. La question est très claire: les parents sont responsables de leurs enfants. » (The Times, 9 juillet).
Le Conseiller Storey s’est abstenu, au moins publiquement, d’endosser la proposition de Whitelaw de punir les parents (par la condamnation de parents à des amendes, jamais mise en vigueur, soit dit en passant), mais il a organisé une réunion exceptionnelle de responsables éducatifs, d’inspecteurs, de responsables sociaux et de la fréquentation scolaire (plus connus sous le nom plus approprié « d’attrapeurs de gosses»). Les enseignants brillèrent par leur absence à cette réunion. Elle eut le mérite de mettre à nue la structure d’un pouvoir vis-à-vis duquel les enseignants n’ont qu’à s’estimer heureux de jouer les sous-fifres ou à se casser. Mais avec l’accroissement des incendies d’écoles (cf. la vague d’incendies qui a envahi école après école la vallée de la Tyne au début des années 1970), avec l’école buissonnière, avec un délinquance généralisée, les instits ne peuvent pas se distancier de leur travail. Cette méthode a toujours été un luxe, et ce dès les débuts de la prétendue éducation de masse. Maintenant elle n’a plus sa place.
La réduction des dépenses d’éducation a aussi engendré un retour au libéralisme impuissant sur les questions « éducatives », en particulier chez les parents de la petite bourgeoisie. L’influence exercée par cette foule de gens est ordinairement marquée par une volonté de préservation de l’Etat local. Dans la mesure où ils voient l’éducation comme un acquis positif, elle fait diversion, inhibant, même si c’est dans une faible mesure, l’émergence d’une théorie révolutionnaire qui ne peut en aucun cas être confondue avec une éducation d’Etat. Elle est aussi idéaliste et grandement élitiste, puisqu’elle tend à assimiler « connaissances » (?) et chances de s’en sortir. Pour paraphraser Francis Bacon « le savoir équivaut à un emploi ». De ce point de vue, les chômeurs sont condamnés à rester des demandeurs tout au long de leur vie de sous-hommes, puisque le « savoir» leur fait défaut. Il n’est rien moins que scandaleux de voir combien les vérités éclatantes de ce libéralisme clair comme du jus de chique révèlent de réactions folles.
Il est vrai toutefois que ceux qui soutiennent de tels points de vue reculent à la première poussée devant ce genre de logique inexorable. C’est comme pour ces déballages publics sur les émeutes (lettres aux journaux, etc.), qui étaient choisis de façon snobinarde parce qu’ils ont paru respectable et non en fonction de quelque conviction réelle. Jugé de ce point de vue avantageusement privilégié, l’éducation devrait avoir forgé les outils pour une pleine jouissance du temps libre (faute de quoi les gosses deviennent émeutiers par manque de formation appropriée). Et revoilà un thème qui commence à être familier depuis le milieu des années 1950 ! Le chômage massif a étendu ce non-sens pour le compte. Les ministres n’y croient plus depuis longtemps, laissant cela à de naïfs rêveurs. Un dernier mot: ironie du sort, bon nombre des enseignants libéraux qui déclarent avoir ce genre d’opinion passent hélas le plus clair de leur temps libre « cultivé» à se bourrer la gueule ou à se défoncer ! (Il n’y a rien de mal à se retrouver continuellement jeté ou raide dans cette époque et ces jours d’aliénation. C’est l’affirmation d’une façade plus conforme qui est inexcusable.)
La subversion rampante mais massive de l’enseignement secondaire présente une grave faiblesse. (L’éducation supérieure est ici sans importance: depuis la fin des années 1960 les combats s’y sont qualitativement transformés. Ils sont aujourd’hui centrés sur le rétablissement des bourses, les possibilités de prolongation des études et non sur le rejet direct des cours, la destruction de l’Université et la fin du personnage de l’étudiant.) Sa faiblesse, donc, c’est qu’elle ne se donne aucune forme d’élaboration théorique. Ça devrait venir des gosses eux-mêmes. (Nous avons cherché en vain la moindre trace de publicité, même minime, des incendies d’écoles de Tyne Side. Tout ce que nous avons pu trouver fut la résistance aux châtiments corporels dans une des écoles non incendiées)
Les contradictions des rébellions scolaires furent aussi mises en évidence dans les émeutes. Malgré l’absentéisme de masse dans les écoles de Liverpool, il n’y eut, durant les émeutes, aucune attaque d’école. Depuis, il est vrai, les écoles de Liverpool ont connu une flambée de vandalisme. A l’école libre anglicane maintenant célèbre de Saint-Saviours, à Toxteth, les élèves ont « dévasté les salles de classe, incendiant et saccageant tout, tournant les extincteurs vers chaque prof qui osait montrer sa désapprobation » (The Daily Telegraph du 23 février 1982).
Commencer à rassembler les éléments d’une critique de l’école, absente même d’une activité aussi destructrice, n’est pas facile. Le système d’éducation en Grande-Bretagne a certaines caractéristiques qui le mettent à part de celui des autres pays capitalistes avancés. Il est moins intégré à un enseignement professionnel que dans la plupart des pays industriels. Excepté peut-être l’enseignement de la lecture, de l’écriture, et de quelques notions scientifiques de base aux gamins, la principale fonction de l’éducation de masse ici est idéologique et culturelle, à première vue sans aucun rapport avec le besoin d’acquérir des connaissances nécessaires au marché du travail capitaliste. Si tel est le cas, la révolte dans les collèges contient les germes d’une critique qui va au-delà d’une simple résistance à l’enseignement chargé de préparer à un boulot particulier. Où mène-t-elle ? Vers quelles splendeurs ?
A la maison, on t’humilie, à l’école, on te frappe
le couple famille/école en crise:
l’imminence d’autres horizons.
Le déclin important de la famille et de l’école, les deux principales structures de contrôle institutionnelles des enfants, amène inévitablement la loi à intervenir de façon plus directe dans la vie des enfants. Bien avant les émeutes, la Commission royale de procédure criminelle (Jack Jones, l’ex-secrétaire « radical » de la TGWU, a siégé dans cette commission) avait conféré des attributions supplémentaires à la police à l’attention particulière des enfants. La recommandation de prendre les empreintes des individus de plus de dix ans suffit à glacer le sang et marque un point de non-retour dans la criminalisation des enfants. Si les commissaires principaux obtiennent gain de cause, ces recommandations entreront en vigueur.
Il y a urgence pour le capital et l’Etat de foutre les enfants sous le microscope de la police. La présence massive des enfants dans les émeutes a conduit les spectateurs à se demander si l’Etat allait laisser cela se poursuivre longtemps : à savoir, des enfants progressivement laissés sans surveillance. Il ne pouvait pas ajouter, pour leur propre bien. Du jour au lendemain, les gamins étaient devenus des étrangers investis de nouveaux pouvoirs et les parents et autres adultes les regardaient ahuris comme s’ils venaient de sortir de leurs cocons. Et pourtant les signes avant-coureurs de l’explosion (une des affirmations les plus avancées que les enfants aient lancées) n’avaient pas manqué. Par la suite, les parents ont dû s’étonner de leur indifférence à imposer une heure fixe pour rentrer et à leur demander, sauf occasionnellement, où ils allaient. Même aller à l’école n’est plus une garantie, à cause de la forte augmentation d’absentéisme.
Philippe Ariès dans L’enfant et la vie familiale relie la généralisation de l’instruction scolaire à « un désir des parents de veiller davantage sur leurs enfants ». C’est ce double processus de surveillance qui est maintenant en crise. Jadis, ce processus annonçait la montée de la famille bourgeoise, en desserrant le carcan des liens familiaux et en se déplaçant sur un nouveau terrain sans références connues ; maintenant, c’est le signal de sa disparition. Sous la puissance grandissante de la police, il faudrait l’acuité d’un Fourier pour voir toute l’importance de cet événement.
Pour pallier l’échec de l’autorité parentale, les Tories proposent une solution draconienne : isoler l’unité familiale avant de lui restituer ses pouvoirs antérieurs. Comme pour la « magie du marché », ça doit se passer spontanément. Mais ce qui arrive réellement, c’est ceci : la refonte des attributions de l’Etat consiste à substituer les institutions existantes par d’autres. Ce qui se met en place actuellement, c’est un renforcement de l’autorité extra-parentale plutôt qu’un retour aux sources, une liaison plus directe des Conseils d’orientation familiale avec la justice et la police. Bien sûr, les organes para-étatiques de contrôle familial n’ont jamais été complètement séparés des organes de répression, mais les travailleurs sociaux de merde seront encore plus disposés à coopérer avec les flics dans l’avenir, lesquels soient les changements au niveau gouvernemental. L’emprise grandissante de l’autorité de la police officielle va presque certainement peser lourdement sur leur libéralisme vasouillard.
On n’attend pas des parents, et plus particulièrement de ceux de la classe ouvrière, qu’ils tiennent le discours idéologique des experts, mais plutôt qu’ils distribuent des paires de claques bien sonnées. Le blâme retombe quand même sur les parents, mais les termes ont changé. (Les résultats d’une enquête commanditée par News of the World sur les gamins des émeutes parurent sous le titre : « C’est notre faute si nos enfants tournent mal. ») Maintenant, ils ne sont pas tant accusés de manque de compréhension que d’incapacité à réprimer brutalement et promptement leurs mômes.
Au moment des émeutes, il y a eu beaucoup de jactance pour forcer les parents à agir de manière « responsable ». L’idée était dans l’air depuis un certain temps. Trois semaines auparavant seulement, un projet de recherche fut présenté à la Commission de recherche du ministère de l’Intérieur pour étudier l’efficacité d’un système d’amendes infligées aux parents pour les contraindre à mieux contrôler leurs enfants. Cette histoire de « parents laxistes » doit vraiment préoccuper sérieusement la classe dirigeante, si on se fie à l’amoncellement actuel de textes grotesques !
On se s’inquiète pas, bien sûr, de tous les parents laxistes mais seulement de ceux appartenant à la classe ouvrière. Pour une fois, les préjugés propres aux études sociologiques sont révélateurs. Tout dépend de quel côté de la barrière de classes vous vous trouvez. On reproche aux parents prolos leur laxisme mais, quand il s’agit des parents des classes moyennes, on parle de permissivité acceptable. The Times du 11 juillet 1981 était relativement franc dans un article qui avait pour titre : « Pourquoi les enfants prennent-ils la rue ? », résumant ainsi ce point de vue : « La permissivité dans l’éducation des dix ou vingt dernières années peut être très bonne pour les classes moyennes qui vivent dans des banlieues aérées et vertes, mais est catastrophique pour les familles des travailleurs manuels, qui vivent dans les cités des centres villes. »
(En citant cet article nous n’entamons pas de campagne en faveur d’une éducation permissive. Quelles que soient leurs différences, les méthodes qui s’opposent ont essentiellement le même objectif: comment élever au mieux cet enculé, le citoyen modèle.)
Particulièrement en ce qui concerne l’éducation, la bourgeoisie s’est longtemps flattée d’être à l’avant-garde, convaincu que ce qu’elle a initié aujourd’hui bénéficierait au proletariat demain. Mais cette dualité dans le système de valeurs signifie que l’époque ascendante de la bourgeoisie est finie. Il n’y a désormais que deux méthodes bien distinctes : une pour les riches, une pour les pauvres. On se sert ainsi des enfants (et de quiconque dans la famille va dans cette voie) comme bouc émissaires. La violence facilement stimulée de la classe ouvrière est ainsi cyniquement activée sur ce terrain.
Mais ces expériences de contrôle dans une société répressive n’ont pas endigué les effets d’un chômage en augmentation rapide, et qui dépasse celui des années 1930. Quand un parent chômeur donne un coup par frustration, cela annule toutes les remontrances moralisatrices, ses dogmatismes étroits. Les différences de taille et de poids entre ceux qui battent et ceux qui sont battus s’annulent au moins sur un point. Tous les deux sont des victimes piégées d’un système indivisible, qui perd son pouvoir de diviser pour régner. Tant et tant d’histoires révèlent que les femmes, les enfants, les bébés, les grand-mères sont battus à cause du chômage grandissant et la violence d’Etat est renvoyée à la gueule de ces manipulateurs comme un boomerang.
Le centre des villes comme enjeu
Les émeutes ne laissent pas présager une ère nouvelle concernant les problèmes particuliers des centres-villes. Ça fait une dizaine d’années ou plus que les autorités s’en inquiètent.
Les premiers efforts pour isoler les centres-villes datent de 1968 et du Programme d’aide urbaine du gouvernement travailliste. Le futur Premier ministre Callaghan avait mis le public en garde contre « les marécages mortels du besoin et de l’apathie ».
En réduisant ces problèmes à une question purement géographique, le Programme d’aide urbaine avait la claire intention de séparer les lieux d’habitation des lieux du travail et du reste de la société. Le rapport de Callaghan est à rapprocher de celui d’Harold Wilson[31], rédigé la même année (1968), et qui met en garde les gouvernements contre l’affirmation du pouvoir de la base ouvrière, auquel ils ne peuvent répondre[32]. Les émeutes qui ont balayé les villes américaines, ainsi que les luttes révolutionnaires en France et en Italie sont la toile de fond immédiate de ces deux rapports.
La grande peur, c’était que le consensus qui avait lié le prolétariat à la social-démocratie réformiste ne se brise. Priorité fut alors donnée au rétablissement de ce consensus.
Au niveau de l’usine, le TUC (Trade Union Congress: unique fédération syndicale, NdT) et la direction mirent l’accent sur la formation des délégués d’atelier (shop stewards) On leur donna des cours de comptabilité, de société, d’organisation du travail, de droit commercial, de relations du travail, etc. Depuis qu’Harold Wilson a fait cette remarque, le rôle du délégué d’atelier a pris un sens de plus en plus ouvertement contre-révolutionnaire. Le seul moment dans l’histoire où le mouvement des délégués d’atelier a constitué une menace révolutionnaire, ce fut pendant et juste après la Première Guerre mondiale. Après cette période, ils se sont régulièrement signalés par leur incapacité à contrôler les débordements de la base. Ni l’Etat ni le patronat ne peuvent permettre que leur activité soit incontrôlée; et tant pis si leur réputation de loups garous est irréversiblement entré en déclin.
Au niveau des vieilles villes industrielles qui avaient autrefois formé le cœur industriel de la Grande-Bretagne, une série de mesures « communautaires » furent prises, en dehors des canaux orthodoxes de la politique municipale (par exemple du Labour Party local).
Cette politique apparemment ambiguë attira les radicaux de 1968 qui n’étaient pas très clairs quant à la sophistication de l’Etat dans son action pour mettre en place divers contrôles. Sans dommages pour lui-même, l’Etat fut capable de reprendre le langage de 68. Ayant perdu toute précision, le mot « aliénation » qualifia simplement « les mauvais rapports entre voisins ». Les contradictions inhérentes à la société capitaliste furent mises de côté, et priorité fut donnée à la redéfinition du centre des villes en termes pathologiques (délinquance, crime, enfants à risques, problèmes familiaux, etc.), et pour lequel un traitement médical était nécessaire.
Ces antennes non orthodoxes étaient étonnamment diversifiées, englobant l’éducation, la santé, la planification urbaine, le logement et les services sociaux. La façon de prendre les problèmes était aussi globale que possible, le but visé n’était ni plus ni moins qu’une réintégration politique des gens accompagnée d’une régénération économique.
Pour ce faire, des organisations comme le CDP (Community Development Projects), fondé en 1969, jouèrent un rôle de pionnier dans la lutte contre le chômage. La plupart du temps, les activités du CD. furent perçues comme « communistes » par les maires travaillistes et leurs conseillers municipaux. A tort : l’Etat sait depuis longtemps porter la modernisation dans les habits de la pseudo-subversion. Mais le CDP fut quand même accusé d’être trop radical et cela ne fit que rehausser son prestige.
Cette stratégie « communautaire » s’accordait bien avec le goût de l’époque pour l’histoire. On alla jusqu’à publier des histoires de divers quartiers des communautés en question. L’intervention de l’Etat, très souple, fut tantôt directe, tantôt discrète, ou parfois une combinaison des deux. Ayant lui-même forgé l’esprit rétro des années 1970, l’Etat avait peu à craindre d’initiatives privées à peu près autonomes. Comme, par exemple, celle de l’atelier d’écrivains d’Hackney, censé encourager les vieux à écrire sur les relations de voisinages d’autrefois. Mais il s’agissait de bien plus que d’une simple mise à jour du passé. [33] Des textes comme Coronation cups and jam jars (1976) [34] évoquent les rapports communautaires sans faille et pleins d’humour et leur stabilité, dans le cocon du parti travailliste et des syndicats, capables de résister aux plus mauvais coups que le capitalisme pouvait infliger. Les émeutes de 1981 ont révélé avec éclat que ces soupapes de sécurité ont aujourd’hui sauté.
Les histoires locales et l’insupportable image d’harmonie qu’elles trimballent ont été un vecteur préparatoire de communication pour les institutions locales de l’Etat. Mais elles ne pouvaient jouer leur rôle de stimuli émotionnels à l’économie politique de la région que si on les entremêlait avec les cultures « extérieures ») qui inondent maintenant les centres-villes. C’est pourquoi des centres communautaires locaux comme Centreprise à Hackney jouent sur l’affinité paradoxale entre une classe ouvrière blanche d’avant la guerre et les images d’un mélange ethnique politiquement stable d’après-guerre. Les deux ayant à peu près autant de rapports avec la réalité actuelle que les poneys dans les puits de mines ou de vieilles barques qu’on exhumerait.
Les principes de l’économie politique au XIXe siècle n’exigeaient pas que l’on connaisse les travailleurs, leur histoire, le passé de leur quartier, etc., ou, très rarement. L’affranchissement politique des « masses », davantage l’œuvre du XXe siècle que du XIXe siècle, a changé tout cela. Dans la mesure ou le « peuple » constitue la majorité de l’électorat, « son » histoire importe à la bourgeoisie, aussi longtemps qu’elle ne menace pas ses intérêts. Elle est une partie indispensable du dispositif de représentativité d’un gouvernement. Quand le consensus s’effondre, l’historien est appelé à la rescousse, afin de sécuriser le present grâce au passé. Ce qui s’est passé avec l’histoire locale radicale, provenant de sources sûres, avec sa morale pour les générations d’aujourd’hui, n’était pas conçu comme élément d’un éventuel résumé de l’histoire du capitalisme mondial. Le vrai but du projet était d’encourager un sentiment de fierté « communautaire » donnant un sentiment d’identité, un goût de l’effort personnel, le respect de la propriété individuelle et co-operative, le tout ficelé avec la revalorisation du droit de vote. L’effet qui en résulte est parfois tout à fait claustrophobique: c’est comme si on se baladait avec un oreiller collé au visage.
Ce pastiche de l’art naïf fut peint par un travailleur social et un secrétaire du « Bethnal Green and Stepney Trades Council » (une organisation travailliste dans un quartier populaire de Londres), après une visite au piquet de grève à Grunwicks (une grêve très célèbre, dominée par des gauchistes) en 1977. Pendant les années 70, les efforts artistiques patronisés par les institutions locales de l’Etat étaient celébrés comme « l’art du peuple ». Imitées de façon lourde pour faire les rabatteurs d’une cause, ils ont perdu leur innocence. Comme dans l’exemple condescendant qui soutient une lutte pour la réconnaissance des syndicats (quand le pouvoir des syndicats n’a jamais était aussi fort – en 1977), ce genre de calcul politique aimerait bien attacher les centres-villes explosifs au poteau du parliamentarisme.
Les Saisons et l’Autonomie
« Il y a trois choses, toutes du même genre, qui ne pardonnent pas : l’inondation, l’incendie et la foule vulgaire du petit peuple. Car celle-ci ne sera jamais retenue par la raison ou la discipline. Et c’est pour ça, en bref, que l’époque présente est si troublée. Ha ! Cette époque qui est nôtre, où va-t-elle ? »
John Gower, propriétaire et avocat, juste avant la révolte des Paysans de 1381.
Incontestablement, l’explosion des émeutes en 1981 a ramené la révolution sociale tant attendue à l’ordre du jour. La révolte industrielle de 1970-1974, et « l’Hiver du mécontentement » de 1979 pâlissent par comparaison. Aucun de ceux qui étaient dans la rue n’a proposé de ces alternatives parlementaires gauchistes au système capitaliste qui étaient tacitement et idéologiquement présentes dans les révoltes ouvrières de 1970-1974. Contrairement à l’opinion de Cajo Brendel dans Lutte de Classe Autonome en Grande-Bretagne, 1945-1977, l’importance réelle de l’autonomie dans ces révoltes essentiellement ouvrières fut moindre qu’on ne l’a imaginé. En faisant la part de l’exagération, on doit cependant admettre que « Échanges et mouvements » a bien montré que la Grande-Bretagne se dirigeait vers une crise qui prendrait des proportions révolutionnaires. En la matière, la plupart des autres ont été moins optimistes.
Mais même les grèves de 1979[35], pendant « l’Hiver du mécontentement », ne dépassèrent jamais vraiment le syndicalisme bureaucratique des délégués d’atelier, comme les conducteurs de camion en grève, qui encerclèrent l’agglomération de Hull et qui exercèrent un contrôle considérable sur l’administration de la ville. Mais il y eut des grèves hautement significatives. Un ami a estimé que plus de trente catégories de travailleurs, qui n’avaient pas d’expérience de lutte, se mirent en grève cet hiver là. Cela suffit à différencier « l’Hiver du mécontentement » des conflits du travail du début des années 1970. Les arrivistes qui veulent s’élever sur le dos des luttes de 1970-1974[36] gardent délibérément le silence sur ces semaines glacées où presque rien ne pouvait bouger. Jusqu’aux cadavres qui s’entassaient dans un entrepôt de Liverpool réquisitionné pour épancher le trop plein de la morgue. Comparé à la vague de grèves de 1970-1974, « l’Hiver du mécontentement » fut riche en incidents inhabituels, qui coïncidèrent avec le fait que la Grande-Bretagne vivait son hiver le plus rude depuis vingt ans. Les éléments – un incendie inattendu, le gel et de grosses chutes de neige – furent habilement utilisés aussi bien par les pompiers en grève que par les sableurs de routes. Un silence étrange régnait sur les rues enneigées, les voies de triage désertées, et les quais vides des gares, où on laissait la neige tourbillonner.
Pendant « l’Hiver du mécontentement », les travailleurs ont utilisé les mauvaises conditions atmosphériques à leur avantage. Mais durant l’hiver 1981-1982, la roue avait tourné. La neige et les inondations ne firent qu’ajouter au poids écrasant de la contre-offensive de la bourgeoisie. Il n’y avait rien à tirer du chaos. La neige montait haut dans les rues, non du fait de la grève des travailleurs municipaux, mais à cause des réductions de salaires et des compressions de personnel décidées par le gouvernement.
Les esprits se courbaient irrésistiblement, comme les branches lourdes de neige. La Chambre de la sidérurgie britannique argua du fait que les aciéries du Pays de Galles étaient bloquées par la neige pour les fermer définitivement. Contrairement à l’hiver 1978-1979, l’espoir d’un changement de l’état des choses ne brilla pas le long des routes bloquées, des rivières en crues et des lacs gelés.
Revenons à la chaleur et aux feux de joie de l’été 1981. D’où vient la profonde différence ? Ces journées de début juillet furent la plus claire expression jusqu’à maintenant du prolétariat devenant « une classe pour elle-même » en Grande- Bretagne. Les jeunes, qui n’étaient pas encombrés par le syndicalisme, nus et abandonnés dans un « vide social » extrêmement dangereux pour le capitalisme, allèrent droit à l’essentiel; ils n’étaient pas gênés par le sabotage de « leurs » représentants « ouvriers », absents, engoncés dans l’appareil d’Etat. Voilà pourquoi les émeutes dérangèrent tant ceux du pouvoir. Les conseillers gauchistes du Labour Party observaient, perplexes. A la veille du mariage royal, la reine était toute retournée. On a dit que la reine et les autres membres de la famille royale furent bien plus gênés par ce qui se passait qu’ils ne l’avaient été pendant la grève des mineurs de 1972, la Semaine de Trois Jours, ou durant « l’Hiver du mécontentement ».
Les avant-gardes gauchistes et le Labour Party
La perspective des premiers rangs se situe à l’arrière-garde
Les partis gauchistes qui ont essayé d’utiliser la jeunesse révoltée pour leurs propres fins furent rapidement jugés pour ce qu’ils étaient. Les journaux tentèrent également de lier les groupes lénino-trostkistes aux émeutes. Ils n’eurent en réalité aucune influence, et furent à la queue du mouvement, se pointant avec leurs brochures et essayant d’organiser des meetings après les émeutes. Ils rencontrèrent soit une hostilité ouverte, soit un mur d’indifférence. Ils furent pris pour des toquards, qui cherchaient à s’introduire de force, par des manipulations, et c’est exactement ce qu’ils faisaient. Chaque groupe léniniste se croyait le seul à détenir l’analyse politique correcte et le bon programme d’action. Tony Cliff du Socialist Workers Party (trotskiste) a dit dans un meeting à Liverpool : « Les jeunes ont fourni la vapeur et, maintenant, nous devons fournir le moteur pour que ça puisse fonctionner. » A l’âge de la technologie de pointe et des microprocesseurs, ces métaphores fatiguants et achaïques, et qui viennent probablement de Lénine, sont plus ridicules que jamais. De plus, il ne fait manifestement pas la différence entre la vapeur et le feu. Il poursuivit dans son langage fleuri habituel, susceptible d’attirer, pense-t-il, les masses absentes : « Parce qu’ils n’ont pas été organisés, les gamins ont attaqué les magasins quand ils auraient dû attaquer les usines (…). On doit leur apprendre à s’emparer de la boulangerie et pas seulement du pain. » (Un sympathisant apocalyptique souhaita qu’ils mettent en pièces les usines.) L’arrogance et l’insensibilité de ces gens sont telles qu’ils ne peuvent comprendre pourquoi ces attitudes sont très mal accueillies.
Les Jeunes Socialistes du Labour Party (LYSP) ont tenu un meeting à Southall après les émeutes et le Mouvement des Jeunes de Southall leur a donné une bonne leçon. Balig Sing Purewall a dit : « Ces mecs viennent pour nous exploiter. Nous ne voulons rien faire avec eux, le SWP, le Workers Revolutionary Party et autres groupes marxistes. On a en a marre de ces gauchistes qui nous disent quoi faire. » Quand le LYPS a tenu un meeting à Liverpool, la réaction a été la même. Claire Doyle, une trotskyste de la tendance Militant, fut constamment huée par les jeunes de Toxteth et de Brixton dès qu’elle tentait de les arnaquer en appelant à la constitution d’un Comité de travail (euphémisme pour le Parti travailliste) pour les deux municipalités. Elle fut, à juste titre, accusée de vouloir accumuler un capital politique sur le dos des émeutiers. Quand elle dit à un meeting : « Vous devez vous organiser pour vous défendre », on lui répondit : « Nous nous organiserons nous-mêmes ! » A un autre meeting, trois membres de la Tendance communiste révolutionnaire voulurent prendre la parole et furent hués. Un kid a dit : « Il y en a marre de ceux qui s’accrochent à nos basques depuis que ça a commencé ! »
Les Noirs sont particulièrement en pétard contre les groupes gauchistes. L’édition du Socialist Worker précédant le Carnaval de 1981 déplore le fait que les leaders noirs aient dit aux jeunes Noirs qu’ils n’avaient rien à faire avec la gauche blanche. A cause de leur position, le raisonnement des leaders est fortement suspect, mais leur conclusion est certainement juste. Ces groupes de gauche sont fondés et dominés par la bourgeoisie blanche. S’il est vrai que les gens au pouvoir dans la société capitaliste se battront pour maintenir leur position, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les groupes gauchistes ? Tout leur est bon pour maintenir leur position, ils abusent des travailleurs blancs, pourquoi agiraient-ils différemment envers les Noirs ? Ces groupes ne présentent aucune possibilité pour les prolétaires blancs et les prolétaires noirs de s’organiser eux-mêmes pour réaliser leur émancipation. En dépit d’une rhétorique anti-capitaliste et anti-raciste, la structure et l’organisation de ces groupes ne sont que le reflet fidèle de la société.
La soi-disant aide pratique des gauchistes dans les Comités de travail fut, apparement, d’assurer que les jeunes arrêtés étaient répresenter par des avocats dans les tribunals. En effet, c’était pour donner du travail au centres legales para-étatiques, les implications de la « politicisation » venant après. Quand à leurs commentaires, c’était de la merde. Socialist Challenge de l’Internationale marxiste et le canard hebdomadaire Socialist Worker atteignirent le comble de l’hypocrisie en défendant les pillards, tout en condamnant les pillages comme anti-socialistes. L’organe du Worker Revolutionary Party, Newsline, du 18 juillet 1981, présenta une collection d’absurdités délirantes, ce qui n’est guère surprenant quand on considère sa longue histoire d’écroulement mentale chroniquement bouché. Pour ces gens-là, l’effondrement intellectuel ne prélude jamais à une percée vers la lucidité. Ils prétendirent donc que les émeutiers étaient à la solde de l’Etat, « provoquées par l’armée et la police », parce que « la contre-révolution tory se prépare à porter un violent coup préventif contre la classe ouvrière ». Ils concluaient que le « principal affrontement est encore à venir, contre les syndicats ». Quelle bavard! Ceux-là au moins n’ont pas hésité à montrer leur vrai visage, en condamnant sans équivoque tous les pillages et le vandalisme, comme les actes d’une « jeunesse facile à berner » qui tombe dans les « provocations policières ». Les gens du WRP ont le mérite d’être trop francs pour réussir à manipuler quoi que ce soit.
Quant aux groupes comme le CWO (Organisation des travailleurs communistes), issus de la vieille ultra-gauche allemande et italienne, ils ne furent capables de pondre que des non-sens. Ayant une idéologie à réaliser, ils ne purent même pas saisir ce qu’il y avait d’unique dans ces émeutes. Ils ont rassemblé comme des trotskystes. Le CWO, par exemple, a prédit dans la plate-forme du Groupe Travailleurs/Chômeurs que « les chômeurs, mis à l’écart par le capital aujourd’hui, seront traînés de force dans les usines d’armement, sous discipline militaire. C’est le seul futur qu’offre le capital. » Mais l’automation croissante et la composition technologique très élevée du capital qui sont requises pour l’industrie d’armement aujourd’hui, combinées au besoin réduit en forces armées traditionnelles, rendent la situation actuelle très différente de celle des années 1930 (base de toutes leurs théorisations à la mords-moi le nœud).
Il est peu probable que ces chômeurs soient embrigadés dans la machine de guerre. A part du pain et des jeux, le capital ne sait plus quoi leur offrir. Ignorant obstinément ces faits élémentaires, comment le CWO peut-il même songer à créer un groupe efficace de chômeurs ? Comme les trotskystes, ils condamnent même les pillages, les qualifiant de « cadeau à la classe dirigeante, car ils ne mènent nulle part ». (Plate-forme du groupe Travailleurs/Chômeurs.)
Le numéro de Solidarity[37] de juin-juillet 1981 sur les émeutes de Brixton est inconsistant, victime d’opinions et d’attitudes que la gauche parlementaire répand de plus en plus. Par exemple, Solidarity n’est pas d’accord avec les émeutiers qui ont cassé les vitrines des petits commerçants, objectant « qu’ils ne le méritaient pas ». Les petits commerçants ont pourtant une réputation bien méritée. Ce n’est pas seulement parce qu’ils sont plus chers que les supermarchés parce quils ne peuvent pas acheté en gros et n’ont pas une agri-business, mais aussi qu’ils arnaquent les clients distraits. En plus, ils sont souvent des balances. De toute façon, leurs ragots déceptifs finissent souvent par arriver au commissariat du coin.
Solidarity a également condamné les émeutiers qui ont saccagé le Bureau d’action communautaire dont, affirment- ils, « le travail est apprécié par les gens du coin ». Mais les choses ne sont pas si simples. Qui n’a jamais entendu « les gens du coin » ivres ou non, maudire de telles institutions para-étatiques ? Et souvent, à juste titre. Peut-être les militants de Solidarity n’ont-ils jamais eu l’occasion de les écouter : ils sont, dans leur écrasante majorité, issus des classes moyennes et certains sont eux-mêmes mouillés dans des rackets d’administration locale. Pire encore, Solidarity suggère un peu que le comportement de la police est excusée parce que les policiers font leur boulot : protéger la marchandise et l’Etat. Dans les quartiers prolétaires, de tels bavardages sont un luxe. On voit bien que les membres de Solidarity tendent à vivre dans les quartiers aisés, où on n’a pas en permanence l’haleine des keufs dans la nuque, et que fait l’observation illumineuse de la structure des rôles, sans exploser, un petit peu dificile. Attendons de voir de quel côté vont tourner les membres de Solidarity, mais il est fort possible que certains d’entre eux finissent par soutenir une politique de contrôle policier discret des quartiers.
Solidarity n’a jamais analysé en profondeur ce qui se passait. On ne soulignera jamais à quel point la délinquance urbaine fut à l’origine de la casse et de l’incendie de petits commerces dans les quartiers pauvres ; ça a cristallisé les pires craintes des réformistes, qui suivaient la ligne préconisée par l’urbaniste Jane Jacob, laquelle commençait à redouter les conséquences de l’urbanisme des tours, des espaces désolés, des rues désertes, en bref d’une planification catastrophique. Ces conditions de vie, pensent-ils, ont détruit le réseau informel de surveillance constitué par les instits, les parents, les commerçants, les cafetiers, etc., qui rendaient le travail de la police presque superflu. D’une manière ou d’une autre, les gens se connaissaient toujours, mais l’anonymat croissant a permis qu’on puisse casser en toute impunité la boutique du coin.
Derrière une façade de ses bonnes intentions (les actes d’accusation que les urbanistes ont lancé contre le redéploiement urbain), il y avait toujours un biais de classe dans lequel les intérêts du petit commerce ont su se faire respecter avant tous les autres. Ces urbanistes réformistes veulent finalement à peu près recréer les conditions qui, à ce qu’ils croient, liaient les communautés divisées en classes. Pour parvenir à cette fin, ils tendent à mettre en avant de façon spectaculaire le crime indiscriminé de la rue. Mais ce qu’ils craignent le plus, c’est une explosion de guerre de classe, qui n’hésite pas à s’en prendre au petit commerce. C’est exactement ce qui s’est produit dans les rues des centres-villes de Grande-Bretagne entre le 4 et le 13 juillet 1981.
On peut bien sûr critiquer les émeutiers, mais il faut plus d’imagination que n’en a la critique gauchiste ordinaire…. Comme dans le suivant.
L’émeute de Saint-Paul à Bristol, avril 1980 : quelques défauts
Les émeutiers, incapables de saisir consciemment les aspects les plus « abstraits » de l’économie marchande, s’arrêtèrent souvent devant des institutions dont ils connaissaient pourtant la fonction brutale et ouvertement une partie de la système. Pendant l’émeute du quartier Saint-Paul à Bristol en 1980, alors qu’ils pillaient les magasins et incendiaient une banque, ils ne touchèrent pas à la Bourse du travail. Un ex-fonctionnaire noir, qui avait été récemment employé à la Bourse du travail, les fit reculer. Il avertit les émeutiers, en passe d’incendier le bâtiment que, s’ils le faisaient, ils perdraient leurs chèques hebdomadaires. Même dans des moments insurrectionnels, les vieilles habitudes peuvent encore exercer une influence redoutable. Au pire, les chômeurs de Saint-Paul auraient dû attendre quelques jours de plus pour toucher leurs chèques. En tout cas, les jours suivant l’émeute, aucun haut fonctionnaire n’aurait osé laisser Saint-Paul sans subventions sans l’aval du gouvernement. L’effet se serait surtout fait sentir dans les autres Bourses du travail et bureaux de la Sécurité sociale. La bureaucratie aurait eu les jetons, et, plus important, ces bâtards des brigades anti-fraudes, qui harcèlent tous les demandeurs de l’allocation chômage, en particulier les mères célibataires, auraient reçu une baffe bien méritée. Le comble, ça a été un an plus tard, quand des fonctionnaires en grève coupèrent les crédits aux chômeurs dans quelques villes, sans l’aide des incendiaires… En gens courageux, ils préfèrent toucher aux allocations plutôt que paralyser les dépenses de l’Otan ou de l’administration de Whitehall.
Michael Foot, l’innommable valet de pied du capital anglais
La perplexité régnait au Labour Party. Ils n’ont même pas eu le courage d’appeler à vider les Tories, alors qu’ils l’avaient fait dans le passé, dans des occasions moindres… A peine six mois plus tôt, le Grand Leader Michael Foot avait, dans un discours prononcé à Pier Head, à quelques kilomètres de Toxteth (Liverpool One) appelé les chômeurs à « se dresser comme des lions ». Rien que ça… Plus tard, avec une grandiloquence désespérée, il réserva sa position sur l’usage des gaz CS et des canons à eau, sachant bien qu’il vit dans un monde où les projectiles sont en papier. Au beau milieu de la colère prolétaire qui faisait rage dans tout le pays, tout ce que Foot, l’innommable valet de l’économie britannique, a pu faire, ce fut d’appeler « acte de barbarie » la décision gouvernementale de réduire de vingt mille le nombre des étudiants (9 juillet 1981)…
Et que dire de Wedgewood Benn, l’as de la manipulation de la machine du Parti, confiné, par chance, dans un lit d’hôpital. Pas un mot, même pas un chuchotement. Quand la paix fut revenue, il rompit son silence pour dire que la Grande-Bretagne allait droit vers un Etat policier. Mais le meilleur fut Eric Heffer, un fossile de l’extrémisme parlementaire, auteur de Lutte de classes au Parlement (hé oui !), acclamé par le SWP. Pressé de faire un commentaire à la télé, cet honorable membre du Parlement élu à Walton (Liverpool) a dit que « les émeutiers et les pillards devaient être punis avec toute la sévérité requise ».
… Et le Labour Party ne peut changer ses billes
C’est vrai, l’Angleterre s’achemine vers la révolution sociale, mais attention, les partis politiques n’abandonneront pas si facilement. La gauche en particulier peut faire beaucoup pour faire avorter le mouvement. Ken Livingstone, leader du Grand Conseil de Londres[38], fit pression sur des bureaucrates importants pour relâcher immédiatement des Asiatiques arrêtés à Southhall. On l’applaudit pour cela, mais d’autres Asiatiques le huèrent après lui avoir demandé pourquoi il n’était pas dans la rue la nuit d’avant. Plus tard dans la semaine, Livingstone s’adressait à la moribonde Ligue Anti-Nazi, à Brixton, alors que l’émeute faisait rage à cent mètres de là ! Ce prince des médias, qui organise les sessions du Grand Conseil de Londres selon un rythme qui convient à la presse, et qui approuva le Conseil communiste de Bologna en Italie, n’a jamais mentionné que ces staliniens ont réprimé les insurgés bolognais en 1977. Il a eu aussi le culot d’écrire dans un éditorial du London Labour Briefing de fin mai 1981 que les combats de rues à Brixton au mois d’avril étaient « excellents ». (Par la suite, il a nié avoir fait de pareilles déclarations.)
Le Labour Party est un vrai caméléon. Quant à « la Labour Party reconstruit », il est tout aussi opportuniste. Il y eut plusieurs manchettes dans les journaux pour rendre compte que des foules avaient été appelées par la « Nouvelle Gauche » à se rassembler autour du Parlement. Pas pour le démolir, mais simplement pour exercer une pression sur les députés. Ce que les médias appellent pompeusement « activité extra-parlementaire » .
Les hésitations tactiques et délibérées de Livingstone durant les émeutes se répétèrent quand les juristes de la Chambre des lords se déclarèrent contre la politique de transport « bon marché » de Londres. Caché derrière un écran de radicalisme, il n’avait pas l’intention de critiquer cette décision. Et le jour où les tarifs des transports londoniens sont devenus vraiment les plus chers du monde, ce cher Ken a payé plein tarif. Un « rebelle » réformiste s’est fait damer le pion et les médias ont exulté. Il alla même jusqu’à dire qu’enfreindre la loi « n’était pas dans la tradition britannique », exhortant les Londoniens à peser sur « leurs 92 députés pour faire réviser la décision des juristes de la Chambre des lords par le Parlement ». (New Standard, 22 mars 1982). Environ une semaine après, ayant digéré le coup des tickets, on l’entendit s’exprimer contre les projets de Sir Kenneth Newsman, ancien chef de la Royal Ulster Constabulary, la police d’Irlande du Nord. Cette fois, tout le monde comprit qu’il ne voulait que sauver la face.
La mauvaise foi de Livingstone est importante ; il est le premier de la « Nouvelle Gauche » à jeter le masque. Le respect de la légalité tient encore bon, mais il y a peu d’amitiés entre l’ancien et le nouveau Labour Party . En Grande-Bretagne, la vieille politique de consensus fait eau de toutes parts tandis que les classes s’éloignent des partis traditionnels. Cela implique à la longue une profonde crise sociale, mais entre temps de nouveaux réalignements politiques s’opèrent quotidiennement.
Le travaillisme a beau avoir la peau dure, il ne peut rien à la longue contre cette expérimentation politique frénétique. La vieille équipe sous-orwellienne d’intellectuels du journal Tribune, défendant une hétérodoxie non conformiste, passée maître dans l’art [traduction de « standards in art »?] et d’embellissement d’un image archaïque du travailleur, n’est pas de taille pour les alliances proposées par « le Labour Party reconstruit ». Cette tentative de consensus inclut les travailleurs venus des secteurs traditionnels comme le charbon et la sidérurgie, plus les minorités « ethniques », les homos, les femmes, les écolos, les activistes du Mouvement pour la paix, les paraplégiques, les retraités, les musiciens « rebelles », les travailleurs sociaux, etc. Tony Benn, dans son rapport du 12 décembre 1981, pour le London Labour Briefing, l’explique : « Nous devions pouvoir accueillir dans notre parti les libéraux radicaux, les activistes du secteur social et celles du Mouvement des femmes, les groupes ethniques, le Mouvement pour la paix et les retraités ainsi que les jeunes. »
C’est un témoignage frappant de la force de la politique « issue » [je ne connais pas comment à traduire ce mot – – c’est l’idée des campagne basées sur perspectives séparés: libération de gay, anti-nucléaire, problèmes des femmes, etc]…
Pas mal de nouvelles recrues furent des étudiants « radicaux » de la fin des années 1960, qui avaient rejoint sans hésitation les partis trotskystes moribonds. A la fin des années 1970, la plupart s’étaient réveillés devant l’inefficacité manifeste des partis léninistes d’avant-garde. Ils eurent même une lueur de grande perspicacité : à savoir que le désintérêt des travailleurs pour le « socialisme » était plus intelligent et égalitaire que les avant-gardistes repentis ne l’avaient cru. Mais continuer dans ce sens aurait bien pu avoir des conséquences personnelles désastreuses (et pourtant libératrices !). Cela impliquait en effet une recherche éthique sur des questions comme l’Etat, le pouvoir et leur propre boulot. Comme ils avaient habilement glissé là-dessus à la fin des années 1960, ce n’était pas pour y revenir à la fin des années 1970, alors que le moment était venu de passer à la caisse. Aussi optèrent-ils pour une ligne « indépendante », qui n’était pas une chose ni l’autre, une ligne qui unissait « l’extra-parlementarisme » au parlementarisme. C’est en substance ce qu’expliqua Hilary Wainwright (co-auteur de Beyond the fragments), quand elle et d’autres gauchistes se sont joints au Labour Party pour débattre de leurs petites différences (cette grotesque rencontre fut qualifiée à l’époque de « débat politique du siècle »). « Le Labour Party », déclara-elle, « s’appuie trop sur l’Etat et le Parlement et est incapable de développer des organisations extra-parlementaires. » (The Times du 10 mars 1980).
Leur notion de ce qui est extra-parlementaire est intentionnellement vague. Ça peut signifier des méthodes parlementaires non orthodoxes. Par ailleurs, « le Labour Party reconstruit » utilisera des termes comme assemblée, sachant bien qu’il a une certaine résonance d’autonomie, pour promouvoir une forme d’assemblée corporatiste mélangeant capital et classe (par exemple, l’Assemblée de Londres, chargée de discuter des problèmes sociaux de Londres, des augmentations de tarifs, etc.). Pour faire face à la désaffection grandissante envers la politique, ces nouveaux auxiliaires du Labour Party doivent se maintenir à une bonne distance des partis afin de coller aux luttes des opprimés. Dès que ces luttes échappent à tout contrôle, « le Labour Party reconstruit » disparaît de la circulation pour réémerger plus tard, une fois le calme revenu, avec ses Comités travaillistes.
Les nouveaux auxiliaires du Labour étaient, à la fin des années 1960, de petits roublards, manifestement faux libertaires, qui s’étaient soudainement retrouvés dans le havre douillet lénino-trotskyste des parties vanguardistes. Même à cette époque, ils se démerdaient très bien pour rester dans la course et préparer leur carrière. Mais au moins ces partis gauchistes n’hésitaient pas à utiliser le terme de révolutionnaires, quoique d’une façon irrémédiablement déformée. Le Labour Party, pour sa part, a toujours hésité à se revendiquer de la révolution. Les jeunes loups dessalés du « Labour Party reconstruit » affrontent maintenant la tâche peu enviable et insoluble de faire semblant de soutenir les actions les plus lucidement autonomes, même pendant les années 1960 en Grande-Bretagne, tout en entérinant ce que la démocratie parlementaire peut avoir de plus minable.
En attendant, ces nouvelles recrues du travaillisme essaient de ne pas laisser échapper des commentaires qu’elles pourraient regretter plus tard. Pendant et après la semaine d’émeutes, elles observèrent un silence prudent. Le New Statesman reconstruit se limita à une critique d’un article très partiale sur la deuxième émeute de Brixton qui était parue dans le Daily Mirror et à un article détaillé, mais finalement superficiel, sur le comportement de la police à Toxteth.
Le Roi Arthur et les chevaliers du travail salarié
Mais quelle nouvelle race de militants syndicalistes sera désormais le fer de lance du « Labour Party reconstruit ».? Serait-ce, par exemple, des hommes comme Arthur Scargill, d’abord leader des mineurs du Yorkshire, et présentement président du NUM ? De son trône bureaucratique, il peut menacer le pouvoir de grèves si, par exemple, les retraites et les bas salaires du plan YOP ne sont pas immédiatement augmentés. Pendant la grève de Grunwick de 1977 et celle de la sidérurgie de 1980, le roi Arthur, gai comme un pinson, conduisit les bataillons de mineurs bien entraînés pour constituer des piquets de grève. Mais il y avait de la méthode dans son orgueil anti-sectaire. Il habituait en effet les mineurs à l’idée d’un seul grand syndicat dans toutes les industries de base. Quand le pathétique Bill Sirs (de la Confédération syndicale de la sidérurgie) annonça qu’il prenait sa retraite, le Roi montra qu’il avait déjà des vues sur la fusion des deux syndicats.
Pour parfaire son jeu expansionniste, le Roi fait gaillardement parade de ses opinions sur un certain nombre de sujets, tels que le racisme. Il est tout simplement incapable de résister au plaisir de paraître à la télé, faisant de la pub pour sa prochaine élection, au poste de président du NUM, tout content de frayer avec les célébrités du show bizz. Peut-être la BBC a-t-elle ses propres raisons de vouloir que ce brillant stratège du blocus de Saltley Depot en 1972 devienne le boss du NUM.
Du Sud du Yorkshire, juste après les émeutes, le Roi, assis dans son nouveau Camelot, pouvait triompher pour avoir prédit à la fin de cette charade artisitique – la Marche pour le travail – qu’une violence égale à celle de Brixton et de Bristol « éclaterait dans toute l’Angleterre » à moins que (toujours à moins que) « le gouvernement ne change sa politique ». Mais, pour le Roi Arthur, l’émeute n’est pas l’affaire du « socialisme ». Il croit que toute la rage des prolétaires peut être dirigée contre les Tories et la ligne politique tory de tous les nouveaux partis politiques, comme le SDP.
Au demeurant, même avant son élection, Scargill en était venu à adoucir ses positions nettement anti-tory. L’impressionnant pouvoir des mineurs qui l’a porté au pouvoir peut tout aussi facilement le balayer. Il est mieux placé que quiconque pour le savoir. Dans le futur, pour sa propre sécurité, il devra s’appliquer à faire monter la température avec précaution. Longue vie au Roi ! Beaucoup de mineurs, particulièrement ceux du Sud du Pays de Galles et du Kent, ont eu des propos durs à l’égard de Scargill quand il refusa fermement d’encourager les mineurs du Yorkshire à faire grève pendant les grèves éclairs contre les fermetures de puits, au printemps 1981 ; et cet enfoiré insinua à la télé que les mineurs du Yorkshire s’étaient mis à genoux lors des grèves de mineurs en debut des années 70 et avaient docilement extrait du charbon comme des marionnettes du NCB (Chambre nationale du charbon). Mais la prudence de Scargill remonte à 1979, à « l’Hiver du mécontentement » et à la vague de grèves provoquée par la décision du gouvernement de geler les augmentations de salaires à 5 %. Pendant ces semaines critiques, on ne l’a ni vu, ni entendu. Sauf un soir à la télé, où il fit acte de présence et se déclara d’accord avec le patronat sur le manque d’investissements dans l’industrie anglaise. Manque d’investissements dans l’industrie, manque d’investissements dans les villes. Manque d’investissements, manque d’investissements ! Ces bureaucrates ruminent toujours le même refrain ennuyeux, les mêmes vieilles solutions. Qu’en est-il d’un monde sans argent ? Est-ce si difficile à envisager ?
T’as de la tune ?
Le gouvernement Tory a nommé fin octobre 1981 une équipe de choc de vingt-cinq « capitalistes socialement concernés », venant du secteur des banques, des travaux publics, des compagnies d’assurance (y compris la Barclays Bank, la société de bâtiment Woolwich et le Fond de retraite du pétrole britannique), chargés d’établir une série de rapports sur la coopération entre les secteurs public et privé. Depuis lors, ils ont visité plusieurs villes américaines, dont Détroit, Philadelphie et Atlanta. (Le gouvernement leur a généreusement donné £2000 d’argent de poche par tête de pipe quand ils visitèrent les States.)
Cette mission feinte souligne la détermination de Thatcher à réduire davantage le rôle de l’Etat dans l’économie. La reconstruction des villes américaines qui a suivi les longs étés chauds des années 1960 sera utilisée comme prétexte pour changer fondamentalement, en théorie du moins, le modèle de financement de l’Etat qui a largement dominé la reconstruction urbaine de la Grande- Bretagne d’après-guerre.
Il est peu probable qu’ils reviennent aussi loin dans le passé . En dépit de ses assurances, Heseltine (ministre de l’Environnement) a sagement laissé la porte ouverte à une autre politique. Dans un discours prudent à la Conférence du Parti Tory en 1981, il a reconnu qu’une aide financière de l’Etat serait nécessaire quand une autre ne marche pas. Les fidèles de Thatcher l’applaudirent chaudement, mais c’étaient eux qui faisaient les frais de la plaisanterie. Ils avaient bêtement supposé que le voyage en autocar d’une trentaine de banquiers organisé par Heseltine, à travers les quartiers dévastés de Liverpool, était le dernier mot du gouvernement Tory sur la question. Quand Heseltine revint finalement de son erreur, leurs oreilles étaient trop bouchées pour entendre correctement.
La retraite tactique de Heseltine ne signifie pas pour autant que les Tories· comprennent la situation particulière du capital financier en Grande Bretagne. Et ce n’est pas d’aller aux Etats-Unis qui les aidera. Bien que le dollar soit toujours l’étalon monétaire international, le capital financier n’a jamais occupé aux Etats-Unis la place prédominante qu’il occupe en Grande-Bretagne. Il y a, par exemple, des règlements fédéraux qui limitent l’épargne et les prêts entre les Etats. Croire un seul moment que les monstres qui dirigent les opérations financières depuis la City de Londres vont parrainer, en coopération avec l’Etat, une décentralisation du capital financier, relève de la plus haute absurdité. Au contraire, ils ont depuis longtemps condamné à l’oubli tout ce qui en Grande-Bretagne hors de la cathédrale Saint-Paul, Blackfriars Bridge[39], ou une très sélective mythologie de l’aristocratie britannique.
Peu après les émeutes de Brixton, un riche homme d’affaire nigérien, Francis Nyeribe, se ramena avec le projet de promouvoir l’initiative privée à Brixton. On n’a pas entendu parler de lui depuis, mais, à l’époque, ça a fait la une des journaux. Les média se sont raccrochés à ce canular, dans l’espoir que d’autres hommes d’affaires suivraient cet exemple faussement sérieux.
Il était question à l’époque que, non seulement les bailleurs de fonds, mais aussi les industriels, offrent réparation en bonne et due forme aux villes et régions qu’ils avaient jadis pillées avec une telle « insensibilité ». Fait significatif : après le retour des financiers de leur voyage aux Etats-Unis, une organisation appelée BIC (Business in the Community) est apparue sur la scène britannique, subjectivisant encore davantage l’économie politique. Elle semble elle aussi suivre des exemples américains. Par exemple, après les émeutes de Watts à Los Angeles en 1965, un groupe de riches capitalistes se réunit pour former le Community Committee, (le Comité municipal) pour voir ce qu’ils pourraient faire pour sauver leurs culs sans valeur. Ils l’avaient fait spontanément, à la différence des hommes d’affaires britanniques qui ont besoin d’être cajolés. Sir Monty Finniston et Lord Melchett, auparavant patrons de la British Steel, peuvent bien s’associer à la campagne menée par cette conne de sociologue Laurie Taylor sur le thème : « Eviter la détention préventive aux jeunes. » Mais le patronat britannique se caractérise en général par un tel repli suicidaire sur lui-même qu’il est son pire ennemi. [40]
Les banques ont craché peu de fric : seulement 70 millions de Livres. Alors que la construction, au debut des années 70, de le Bradford Interchange[41] a coûté à lui seul 18 millions de Livres et des broutilles. Ces subventions ont été accordées selon le modèle de l’Action pour le développement urbain, formule utilisée aux Etats-Unis et destinée à attirer six dollars venant du secteur privé pour chaque dollar venant de l’Etat (à ce que nous disent ses apologistes). En fait, ici, l’aide pour le développement urbain va encore être controlée essentiellement par le gouvernement. Ce n’est qu’après que les banquiers pourront estimer si les investissements faits par les autorités locales, les milieux d’affaires et groupes locaux, sont rentables, pour dans ce cas prendre la place des comités de fonctionnaires qui croient que l’argent pousse dans les arbres.
Mais appliquer les leçons apprises chez les Américains ne sert, en l’occurrence, à rien. Le gouvernement britannique essaie de fortement convaincre les gens à l’idée de la paix sociale dans les ghettos américains, pendant les années 1970, est due au succès de telles initiatives conjointes (l’Etat et les compagnies privées, par exemple, le Comité d’action de la municipalité de Watts, qui est toujours florissant).
[cette section est très difficile de comprendre – c’est contradictoire en anglais, et je pense c’est parce qu’ils n’ont pas bien édité ce text – comme beaucoup d’autres de leurs textes; pour cette raison je laisse tombé une phrase, que même les traducteurs originales n’ont pas traduit]
La « reconstruction » des ghettos est considérée comme un brillant exemple de la libre entreprise américaine. En fait, le changement qui s’est produit est plus vraisemblablement dû à la prodigalité de l’Etat, qui a réussi à sauver les apparences de la libre entreprise. Quelques jours seulement après que l’incendie social se soit apaisé en Grande-Bretagne, un reporter s’est démerdé pour déterrer un émeutier de Watts qui s’est rappelé de façon pittoresque comment, dans le milieu des années 1960, il n’avait qu’à laisser dépasser son chapeau de la fenêtre pour ramasser les billets de banque qui pleuvaient du Welfare (le système d’allocation aux pauvres ). Quiconque a vécu en Grande-Bretagne dans les mois qui suivirent les émeutes ne peut raconter de telles salades. Un an plus tard, les moellons calcinés sont toujours là pour enflammer l’imagination…………..
Le gouvernement britannique, qui fait partie du lot des Etats « menacés d’émeute », s’accroche désespérément à l’apparence de paix sociale qui règne dans la société américaine depuis la fin des années 1960. Il mise sur des étés courts et froids cette année, l’année prochaine, et encore l’année suivante. En soulignant l’importance des stratégies de diversion politique, il espère minimiser l’importance de la situation économique actuelle qui ne peut pourtant que saper l’effet de ces diversions. Espérer un répit comme celui qu’ont connu les Etats-Unis ces dix dernières années, c’est espérer en vain.
Quoi qu’il en soit, la marge de manœuvre est étroite. Mais la gravité de ses difficultés présentes lui a fait prendre conscience de l’effondrement imminent des lois qui gouvernent l’accumulation capitaliste. On est frappé par ça dans les contactes quotidiennes, qui oscillent entre le libre échange et l’asile d’aliénés. Un gamin de 8 ans a échangé, pendant l’émeute de Brixton en 1981, un bracelet en or qu’il avait arraché contre un coca, juste parce qu’il avait soif. Strictement parlant, ce n’était même pas du troc ! Il n’y avait rien de mensurable dans cette forme d’échange !
La bourgeoisie pâlit devant ses propres calculs. Leurs modèles économiques chiffrés, ‘compris’ dans le passé par les petits groupes selectionnés et qui toujours ont réussi de finir avec une reflexion obscure mais rassurante, se révèlent être bidons ! C’est comme si les hautes mathématiques s’étaient réduites à quelques chiffres : deux millions de chômeurs, puis quatre millions, finalement même dix millions. Admettre cette probabilité statistique revient pour les économistes à jouer à la roulette russe avec une machine à calculer. En train de crquer, ils cherchent la bouteille et l’abacus dans le park à enfant. L’Unité d’économie de Cambridge a prédit récemment que les demandes d’emplois commenceront seulement à chuter vers l’an 2000. En privé, ils doivent en savoir autant que tout un chacun : la haute technologie et le développement de l’automation (« La contradiction du capital en mouvement », Marx, Grundrisse) rend cela impossible.
On peut appliquer schématiquement une extrapolation des Grundrisse au mouvement général du capitalisme, mais pas à la Grande-Bretagne, perdue au milieu des débris d’une industrie à l’abandon. Les monétaristes anglais ont pu avoir un plan économique et social, un de ceux qui en appelaient aux plus mauvais instincts de la bourgeoisie comme du prolétariat, mais ce n’est plus le cas. Les vrais gagnants sont les financiers de la City de Londres, comme toujours. Sir Keith Joseph, auparavant ministre Tory de l’Industrie, a déclaré le 19 juin 1981, à peine trois semaines avant les émeutes : « Il n’y a jamais eu autant d’argent disponible dans ce pays », enfermé dans les banques, les fonds de retraites et les compagnies d’assurance. Il parla d’une manière imagée de « l’argent qui sort des oreilles des banquiers ».
C’est justement ce genre d’images qui rend la gauche du Labour Party folle d’espoir. Conséquemment, elle parle à nouveau de nationaliser les banques et les fonds de retraites, thème qui a toujours valu aux orateurs des applaudissements nourris lors des conférences du Labour Party. Comment compte-elle empêcher une fuite de capitaux devant une telle menace ? Ce n’est pas clair. Mais c’est un pari qui, sous l’étiquette d’un nationalisme « rouge », pourrait encore intéresser une partie du prolétariat. Pour cette raison, la bourgeoisie industrielle n’est pas très partante. Elle sait qu’au cas peu probable où une telle chose arriverait, pour préserver la paix sociale, le prolétariat recevrait de l’argent qui aurait été disponible pour des investissements…
Monétarisme : Grande-Bretagne contre USA, mieux gérer la baraque… ou assainir les mœurs ?
Le monétarisme pratiqué par Reagan ou Thatcher peut bien provenir de la même mangeoire friedmanienne (de Friedman, le théoricien du monétarisme, NdT), mais la comparaison s’arrête là. En Grande-Bretagne, le monétarisme n’est pas un mouvement culturel au même degré qu’aux Etats-Unis. Il est franchement économique, sans la présence décorative des Nouveaux Chrétiens, de la Majorité Morale et des Créationnistes.
L’élite Tory peut en privé sympathiser avec la morale sexuelle répressive et les plus archaïques vouloir en sous-main favoriser sa restauration. Mais des choses comme les centres de chasteté dans les rues principales, parrainés avec succès par un sénateur républicain de l’Alabama, ne marcheront jamais en Grande-Bretagne. Les Tories n’ont ni l’argent, ni la volonté, ni même assez de prétention pour devenir une « majorité morale ».
Il est plus difficile de convaincre les gens que la place des femmes est à la maison quand le Premier Ministre est une femme. Même aux Etats-Unis, où la première, et peu libérée, dame du pays joue les reines aux réceptions du Grand Chef Blanc, les projets d’abrogation de l’Amendement sur l’Egalité des Droits sont truffés de contradictions. Comment Mrs Schlafly, l’égérie du mouvement monétariste Kinder, Kirche und Kuchen, a-t-elle pu trouver le temps d’écrire tant de livres et d’être si active à la Fédération Républicaine des Femmes ? Entre le ménage, les couches, la cuisine et le repassage pour les enfants ? Ou tout ça s’est-il fait avec une paire ou deux de servantes noires ?
Quelle que soit la législation, le chômage de masse signifie que les femmes sont en général plus liées à leur maison. Mais pour la même raison, les hommes le sont aussi. En fait, toutes les contraintes du chômage lient chacun beaucoup plus à la maison, où la tension ressemble alors à celle d’une cellule surpeuplée. Ce n’est pas là restaurer l’unité de la famille, mais, au contraire, l’amener jusqu’à un point de rupture. L’affaire est mal partie quand la preuve (ardemment saisie par Mary Whitehouse[42]) d’une revitalisation d’une adolescence heureuse dans une famille unie repose sur des fondations si ébranlées.
Ces sornettes moralisantes, comme les bavards du Festival of Light, probablement ne peuvent produire en Angleterre un clivage politique. Les campagnes contre l’avortement, le porno, le sexe et la violence à la télé ont attiré des gens connus pour leur soutien de longue date, ou dans le passé, au Labour Party. Le conservatisme moral en Grande-Bretagne est, à l’inverse de ce qui se passe aux Etats-Unis, une marchandise en vente libre, qui appartient autant à la droite qu’à la gauche traditionnelle. Il n’est, ni pour le capitalisme, ni implacablement hostile au « communisme » (c’est-à-dire la nationalisation totale ou le capitalisme d’Etat) ; il porte encore la marque de sa naissance qui remonte, en particulier, à Thomas Carlyle. Il y a bien de temps en temps des rumeurs d’infiltration communiste dans les médias, mais la confusion entre laxisme, libération des mœurs et communisme, entretenue aux Etats-Unis par la droite, est relativement rare en Grande-Bretagne. La vigilance des médias en Grande-Bretagne, à la différence de ce qui se passe aux Etats-Unis, est préoccupée, jusqu’à l’obsession, par la sexualité comme spectacle marrant, et dans une moindre mesure par la violence.
Les vertus domestiques, combinées à une foi religieuse délirante dans le capitalisme du laisser-faire, ont traditionnellement été le fondement du droit américain. C’est exactement l’inverse en Grande- Bretagne : sur les toits brûlants des chaires du marché pas régulé, l’impudicité est la grande gagnante. Bien plus, dans le siècle qui s’est écoulé depuis que la gauche était considérée comme une suborneuse d’enfants, on n’a pas vu dans ce pays de livres qui puisse rivaliser avec Vanity Fair.
En Grande-Bretagne, les partisans du réarmement moral ne se servent pas des partis politiques. Même si l’on pensait à organiser un référendum pour légiférer sur les mœurs, on préférerait prendre un décret[43] parce qu’il ne serait pas influencé par les principes du droit de vote bourgeois, qui est censé être la cause première de la démoralisation des masses. Les mouvements fondamentalistes aux Etats-Unis sont contraints de racoler une sorte de majorité, même s’ils exagérent énormement les chiffres. Mais en Angleterre, la sauvegarde de la morale publique est l’affaire d’une élite qui n’a pas oublié son vieil anti-capitalisme quasi féodal. C’est sans surprise qu’ils répugnent à s’emparer des médias, traitant la radio et surtout la télé comme l’œuvre du diable en personne. Enfin, il n’y a pas de bons mécènes prêts à raquer pour la propagande moraliste de ces prêcheurs dignes et compassés.
Et qu’en est-il du créationnisme dans un pays où L’origine des Espèces a vu le jour ? Le Musée d’Histoire Naturelle de Kensington, à Londres, a fait paraître une brochure pour le public, qui contenait la phrase : « Si la théorie de l’évolution est vraie », ce qui fut la cause d’une attaque immédiate de la part du journal Nature. Mais c’était loin d’être une concession au créationnisme. C’était une manière de dire que si l’aptitude à la survie détermine la sélection des espèces, les organismes primitifs sont une « solution excellente ». Il s’agit d’un débat scientifique, où certains biologistes dissidents soulignent certaines contradictions qu’ils trouvent dans la théorie de Darwin. Cela n’annonce ni une série de procès, ni la pression d’une clique gouvernementale, comme en Amérique.
Il n’y a que quelques exemples où la comparaison entre le monétarisme extra-économique anglais et celui des Etats-Unis est possible : les deux gouvernements ont reçu l’appui des écologistes. Heseltine, ministre de l’Environnement, a proposé des plans pour ramener la campagne dans les villes, comme réponse aux émeutes, par la transformation des grises ceintures industrielles en espaces verts, alors même que, ô ironie, il échouait à empêcher les fermiers de défricher les parcs nationaux, de détruire les Sites d’Intérêt Scientifique et de convertir la campagne en prairie. Même là, Heseltine a procédé avec prudence. Il n’y a pas eu de coups de bâton, au contraire de ce qui s’est passé aux Etats-Unis, pour les fermiers qui se préparaient à ensemencer Exmoor. Au lieu de ça, une ‘code de conduit’ était mis en place qui demande que les fermiers de l’agri-business pour les grandes supermarchés devraient prendre soin des colines et vallées et les arbres et les fleurs. Ca ne risque pas!
En Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis, dans les dernières campagnes électorales les féniants au chômage fut traitée comme le mal incarné. Ce qui a fait plus qu’aider Thatcher. Mais elle n’a vécu que pour regretter amèrement ce jour. Le chômage qui montait rapidement diminuait la tension entre ceux qui n’avaient pas de travail et ceux qui en avaient et qui, bien avant les émeutes, commençaient à regarder d’un œil désabusé l’effondrement de l’économie souterraine.
La culture et le TUC
L’encadrement du prolétariat
Le TUC, qui est de son temps, a commencé à accorder le droit d’accès aux postes bureaucratiques à des minorités ethniques, dont quelques membres sont devenus des maquereaux de la force de travail. Comme l’a dit Ken Gill, de la Charte de l’égalité des droits pour les Noirs, « la structure du syndicat devrait être réexaminée, pour supprimer les barrières qui empêchent les travailleurs noirs d’arriver aux charges du syndicat et aux instances dirigeantes. » (Par exemple, délégués syndicaux, agents dans les bureaux de quartier, dans les comités régionaux et nationaux, etc.) ( Morning Star, journal du Parti communiste, (NdT) du 17 juin 1981). Malgré une apparence de progrès, c’est l’essence de la contre-révolution, parce que le respect pour les syndicats et autres formes d’autorité extérieures se perd. C’est précisément au moment où le syndicalisme se meurt dans le monde entier que le TUC cherche à vendre aux minorités ethniques le mensonge de l’intégration démocratique au syndicat. Considérons le destin de l’infâme Journée d’action, lancée par le TUC, le 14 mai 1980. L’appel à la grève du TUC fut suivi par des centaines de milliers de travailleurs sans aucun résultat. Mais les millions de mecs qui allèrent bosser n’avaient pas précisément choisi de lécher le cul des patrons. Le meilleur exemple, celui qui résume le mieux la situation, fut fourni par Liverpool, cette ville semi-insurrectionnaire. Désobéissant aux ordres du syndicat, des ouvriers d’usine commencèrent à bosser comme d’habitude ce matin-là uniquement pour cesser le travail une heure plus tard, après une engueulade avec la direction. Un arrêt de travail sauvage le jour même de la Journée d’action du TUC! Quel paradoxe et quelle fausse note, à la fois pour le patronat et pour les syndicats ! Comme un copain le fit remarquer, la décision de travailler comme celle de faire grève se valaient par leur ambiguïté.
Les membres du TUC ne peuvent espérer manipuler la rage des prolos indéfiniment. Tout ce dont ils paraissent capables, c’est de faire l’éloge de l’histoire de leur « mouvement ouvrier » défait, n’arrêtant pas de commémorer les martyrs de Tolpuddle, Peterloo et de répéter une version atténuée de la Révolte des paysans. Mais ils n’ont pas commémoré les excellents excès des Luddistes, du Capitaine Swing, des Ranters, etc., parce que ces derniers ne sont pas conformes aux règles d’action promues par le TUC.
Devenus des historiens de quatre sous [possiblement mieux: Devenus des historiens de feuilletons (attendez le prochain épisode)], ils ont appris, avec un goût indéniable pour le grand spectacle historique, à consigner dans des musées du Travail le passé immédiat. Dans l’espoir que la lutte de classe demeure un sujet de spectacle, la Marche du peuple pour le travail fut sur le champ changée en pierre quand Ken Livingstone inaugura une plaque commémorative à County Hall avant même que la Marche soit officiellement terminée. Ce jour-là, la mairie fut même ouverte aux skins, qui arpentaient calmement, contrairement à leurs habitudes et avec stupéfaction, les kilomètres de couloirs de l’honorable bâtisse.
Autre initiative grotesque du TUC: après l’occupation il y a quelques années de la Compagnie navale de l’Upper Clyde, la table de négociation en formica fut placée dans le musée de l’Histoire du travail, nouvellement créé à Limehouse ( Londres) !
Le TUC n’a pas manqué d’acquérir quelques connaissances en art d’avant-garde. Pour le dépassement des cours du soir en la peinture à l’huile, c’est grâce aux ex-soixanthuitards. Leur comité économique pour l’automne 1981 fit marcher un spécial Express du travail, composé de wagons « gaiement décorés», qui s’arrêtait pour des meetings arrangés à l’avance à travers tout le pays. La comparaison avec les trains soviétiques d’agit-prop s’impose inévitablement. Avant les premiers tours de roues, on pouvait savoir que tout cela ne serait que de l’enculage.
Le théâtre du chômage
Il n’y a pas d’exemple qui démontre mieux que celui qui suit la fragilité de la façade constituée par des manifs organisées. Quatre semaines avant l’émeute de Toxteth, il y eut une manif attirant plus de cent mille personnes à Trafalgar Square, à la fin de la Marche du peuple pour le travail. Tous les gros pontes du TUC et du Labour étaient là. Les marcheurs tannés par le soleil étaient salués par les applaudissements et les retournaient poliment. Cette grosse manif se déroula dans l’ordre. Il n’y eut aucune arrestation. On n’a même pas pu trouver un seul tract sensé. Un homme avec un spectacle des peruquets était en arrière. Un mois plus tard, Liverpool explosait.
La Marche du peuple pour le travail démarra de Pierhead le 1er mai 1981, fête du Travail. La banderole portée par les Croisés de Jarrow pendant la Marche de la faim dans les années 1930 fut délicatement déployée. Assurée pour 25 000 Livres, c’était une antiquité, qui devait être réutilisée dans une autre marche organisée à Jarrow même par le Labour, à l’automne. A Pierhead, les jeunes marcheurs chômeurs avaient tous été équipés d’anoraks verts et de coquets sacs à dos. Un graphisme portant l’inscription « Marche du peuple pour le travail » avait été dessiné exprès. On aurait pu aussi bien exhiber un badge : « J’aime New York. »
En fait, l’art graphique a joué un rôle majeur dans la création de ce spectacle de la revendication. Quand ils tracèrent les plans de la Marche, les organisateurs furent frappés par l’impact visuel des photos des Croisés. (Des caméras attendaient le passage de la Marche à travers le village de Lavendon-in-Bucks, lieu de la photo la plus célèbre de la Marche de Jarrow). Jadis, l’impact s’était fait principalement à travers les journaux, maintenant, on a la télé couleur. Ainsi les conseils des équipes de design reflètèrent-ils en quelque sorte la profondeur du changement opéré depuis les années 1930 dans la tactique syndicale. A l’époque, la Marche de Tyneside, parrainée par le TUC coûta 300 Livres. Cette fois, l’addition dépassa 50 000 Livres.
La Fête d’Amnésie
Les résolutions des syndicats et l’organisation de la défaite
Pour les activistes militants du Labour Party et leurs copains syndicalistes, l’amnésie consciente est un outil commode. Ils ont malalaisement oublié les émeutes de l’été, qu’ils considèrent comme quelques jours de folie dans les rues. Malgré des hésitations, le point de vue officiel sur les chômeurs prédomine encore: les chômeurs sont des créatures faibles, écrasées, déclassées et qui le resteront jusqu’à ce que le TUC ou des institutions para-étatiques leur viennent en aide. En réalité, ils sont en train de sauvegarder leurs carrières et l’idée de leur importance. Cette conception de leur impuissance est institutionnalisée. Ruth Lister, directrice du Groupe d’action d’aide à l’enfance pauvre a dit (27 septembre 1981) : « Les chômeurs semblent être abattus et ne savent pas ce qu’ils doivent faire. Les syndicats et les députés du Labour ne protestent nulle part suffisamment. » Cette idiote n’a pas dû entendre la clameur de la rue.
La Mort Prolongée du Rock ’n Roll
« Ils disent qu’il va crever, mais baby, soyons clairs: on ne sait même pas ce qui va le remplacer. »
(Move it, Cliff Richard)
Depuis l’apparition du mouvement punk, on n’avait jamais vu en Grande-Bretagne autant de musiciens soutenir une très vague cause socialiste, qui, malgré une image anarchisante, voulait annoncer une transformation strictement politique de la société. Des groupes tels que The Specials, The Jam, The Gang of Four, Tom Robinson ont trempé dans des campagnes diffuses (à propos par exemple du racisme, du chômage ou du désarmement nucléaire) organisées par les trotskistes, la gauche, le centre du Parti Travailliste ou les syndicats. Cependant ces musiciens ont été, sans exception, complètement étrangers aux courants négatifs les plus profonds qui ont empêché les politicards, même lorsque le blitz de Thatcher était à son point le plus haut, de recouvrer leur ancien prestige. Rassemblant comme le super chic Bianca Jagger qui, dans des habilles haute couture, a fait des appels pour les pauvres de l’Amérique Centrale, les groupes de musique dans le Royaume Uni ont été mainoeuvrés de faire la manche pour la cause des pauvres au même temps qu’ils achetent des manoirs dans la campagne.
[Il y a 4 paragraphes qui manquent ici. Ce n’est pas qu’un cas du censorer mais aussi parce que c’est très difficile de comprendre ce qu’ils veulent dire même en anglais Et de ce que est compréhensible ce n’est pas de tout clair pourquoi ils disent ce qu’ils disent.]
La musique et la nostalgie. La répression d’une mémoire révolutionnaire.
Le rock, en tant que musique populaire, n’a connu de vrai problème qu’une fois que la promesse d’une bonne vie pour tous se fut réfugiée dans les comptes en banque des îles Cayman et les sanctuaires, à l’épreuve des balles, de Malibu Beach réservés à quelques rares élus. Tant que le fric rentrait, tout allait bien pour les géants de l’industrie du spectacle musical. Mais un tel état de chose, contraire aux traditions populaires du rock’n roll, ne pouvait durer longtemps. L’industrie de la musique a toujours voulu réduire les musiciens rock à un statut d’amuseurs, mais elle a toujours dû, ensuite, faire face à la désaffection du public.
Au début des années 1970, il était clair que le rock était au creux de la vague. Les tonnes de bons morceaux apparues dans les années 1950 et 1960 avaient fait place à des bons morceaux très peu nombreux. Il n’y avait pas moyen d’échapper à cette constatation : la musique rock était plus morte qu’un dinosaure. Et presque la seule chose qu’elle pourrait offrir était les parodies de Gary Glitter qui ont devenu plus désopilantes quand le marché des adolescents et les pré-ados ont mordu à l’hameçon.
La conjonction, qui avait été importante bien que problématique, entre la musique et la contestation semblait finie. C’était une époque irréelle. Le monde semblait se réinstaller dans les vieilles ornières, tandis que le moment critique global de 1968/1969 était réduite à un trauma de l’histoire mondiale. Les gens furent rejetés en masse vers la nostalgie, ce qui, d’une manière ou d’une autre, mit toujours fin aux réflexions si nécessaires sur les événements révolutionnaires de la fin des années 1960. « Cela ne menait à rien », et la manie du commentaire sur les revivals nostalgiques du début des années 1960 fit pendant à cette veine historianisante.
Mais peu importe la manière dont on a réprimé la mémoire de ces événements de la fin des années 1960, qui ont ébranlé le monde, une lutte de classe encore dynamique devait affecter cette propension au souvenir essentiellément conservatrice. En Grande-Bretagne, cela prit la forme insistante d’un repli sur soi collectif : recherche de ses origines de classe, recherche de ses racines, ce qui devait, dans la forme limitée impliqué ici, contribuer à sauvegarder le système de classe. Les principaux responsables de. cet enfermement furent les bureaucrates syndicaux, shop stewards, enseignants, conférenciers à temps partiel, personnels d’assistance sociale, tous d’origine ouvrière, que leur position dans la structure de la société retourna contre la cause qu’ils avaient embrassée. Cette contradiction devait pour finir déboucher dans l’explosion punk, qui eu recours elle aussi au repli sur soi comme protestation contre le monde, cette vieille réponse démagogique à la division en classe de la société britannique.
Les luttes du début des années 1970 n’eurent aucune incidence sur l’industrie de la musique. Ce fut une période de consolidation pour les plus grosses boîtes, une époque où le show-biz se contenta de jouer sur le rapport très superficiel qui existait entre le système des vedettes et son public principalement ouvrier. Mais restructurer pour longtemps le rapport public/vedettes au profit du nouveau panthéon des célébrités hollywoodiennes était une tâche désespérément à contre-courant du climat économique, qui poussa finalement le prolétariat dans une direction différente. Seulement pendant un peu du temps on pourrait penser que les fans de, par exemple, Rod Stewart – un gars prolo qui a réussit – pouraient lui regarder sans devenir faché avec ce con. Plus tard Sid Vicious, du ‘Sex Pistols’, aurait invertir la relation en semblant de tirer sur les spectateurs passives. C’était qu’une variation de la même scène vieille, mais pour les grandes sociétés, c’était inquiétant.
Le grand capital privé est rarement favorable aux mouvements populaires et lorsque survint l’explosion du punk et des marques indépendantes, les grandes compagnies réagirent d’abord avec un mélange de peur et d’exécration. Puis, le parfum du profit qui en émanait les fit changer d’avis et elles se mirent à suivre de près ce mouvement. On ne dira jamais assez que le punk (en tant qu’expérience musicale) a été un mouvement plus populaire que classiste, où les intérêts des musiciens et du petit capital ont été maintenu par un équilibre précaire. Ce mouvement associant « créativité » et capitaux spéculatifs finit par éveiller l’intérêt des grandes compagnies, enlisées dans le déclin de leurs marges de profits, l’accroissement rapide des coûts de production et d’administration, et l’extension des dépenses de promotion. Il y eut tout de même des marques indépendantes (telle Factory Records de Tony Wilson) pour reconnaître avec un peu d’honété : « Il s’agit de faire du fric et quelque chose de super en investissant dans le talent et en y croyant, au lieu de promouvoir de la merde. »
Tout au long des années 1970, du marasme du rock au debut de la décenné jusqu’à la new wave, le rock a été en crise permanente. En dépit de transfusions répétées, la musique fut incapable de retrouver son ancienne puissance. Le punk débuta comme une tentative pour « détruire » le rock et l’architecte de ce situationnisme musical (l’un des moyens désormais familiers de la récupération de la théorie situ), Malcolm MacLaren, appela sa compagnie ‘Glitter Best’[44] soulignant ainsi l’unité du canular et des faux-semblants honteux de la new wave.
MacLaren fut capable de faire du ‘fric à partir du chaos’, tant que sa (triste) réputation ne fut pas dépassée par des perspectives plus radicales. Il fut le dernier boucanier du music-biz, mais ironie du sort, le jour où il fut démasqué, la prétention de la musique ne serait-ce qu’à une pseudo-radicalité s’effondra elle aussi. Le punk ne put se décider entre l’agressivité authentique prolétaire et des faux-semblants spectaculaires au cours de ses irruptions sur le devant de la scène musicale. Sid Vicious (Sid Vicieux), toujours à la recherche d’un nouveau scandale, pour faire les titres des journaux, fut conduit au meurtre et au suicide. Un autocollant disait ceci : « MacLaren recherché pour meurtre vicieux . »
Toutefois, en tant qu’idéologie d’art radical, le punk fut mortel pour tous ceux qui s’y investirent. Jamais dans l’histoire du rock on n’avait autant insisté sur le fait de ne pas chercher à vendre, de ne pas se faire acheter, de ne pas trahir, ce qui voulait dire qu’une critique du capitalisme prenait racine. C’était toujours ça.[c’est une bonne traduction de « so far so good »?] Mais dans le même temps, les mentors du punk se sont laissés acheter avec une hâte éhontée, trahissant toutes leurs déclarations sur l’égalitarisme et le mouvement de masse, si bien que des individus et des groupes ont pu grimper jusqu’à la tranche des hauts revenus et pénétrer dans le monde des stars.
Il a pris du temps pour être compris, mais ceux qui avaient été sincères, au moins sur quelques points, se sentirent d’autant plus salement floués. Cet déroutant mélange d’image et de réalité, d’hypocrisie ahurissante et d’honnêteté eut même des conséquences néfastes pour quelques-uns des artistes qui avaient accepté d’enregistrer et dont la tête avait tourné sous l’effet des gros chèques. Poly Styrene, qui n’est pas heureuse comme The Palice de faire des « pas de géant sur la Lune », s’imagine qu’elle a fait plusieurs voyages sur Mars; elle ne fait que commencer à redescendre…
Même quand la musique rock s’inspirait de sources rhythm and blues plus authentiques, les détails essentiels qui font qu’une musique s’inscrit dans un contexte de vie quotidienne étaient le plus souvent gommés. Le punk a agi de même, mais cette fois en récupérant des éléments de critique révolutionnaire. Il n’est que de lire la feuille de réclame des Sex Pistols : ‘Vacances au soleil’. Les seules paroles raisonables est la dernière ligne: « Une vacance de bon marché dans la misère des autres ». Sinon, c’est un mosaïc des lignes meritantes d’être jetables: « Vous voulez voir de l’histoire, parce que j’ai une économie raisonable » (??????); « Je ne veux pas une vacance au soleil, je veux aller au Nouveau Belsen » (quoi?????).
The Clash, lors d’un récent concert à Paris ont refusé de rendre publique la situation difficile de prisonniers libertaires en Espagne, condamnés à des peines allant de dix à quarante ans de taule. Mais ce groupe a consacré tout un album de trois disques aux Sandinistes, ces léninistes/ guévaristes du Nicaragua, qui n’ont, par comparaison, pas le moindre potentiel révolutionnaire.
“Get back, get back, get back to where you once belonged”[45]
Comme la plupart des mouvements populistes, la new wave n’a donné de l’importance au prolétariat que tant que celui-ci n’a pas eu le dernier mot. Il est surprenant de voir à quelle vitesse la relation entre les zonards et les groupes a tourné au vinaigre, une fois qu’un certain nombre de musiciens punk ont commencé à faire du fric [a réussir?]. Cela nous rappelle une discussion que nous avons eu en 1978 avec un couple de chômeurs allant sur leurs 20 ans qui, une année auparavant, avait squatté avec The Police. Le groupe avait déjà commencé à faire du fric et à engranger. L’un des jeunes en particulier était plein de mépris pour eux et il les traitait de cons (…). Son rejet du groupe s’étendait même à la période où The Police n’était qu’un groupe de squatters aimant faire de la musique.
Cette attitude reflète une part de la sauvagerie et de la complexité de l’apartheid social. Ceux qui réussir ne peuvent jamais s’en démarquer parce qu’on le fait dériver du hasard de la naissance.[est-ce que c’est clair ici?] Cette fausse conscience est le fondement d’un paradoxe commode que le capitalisme britannique utilise pour maintenir la classe ouvrière à sa place. Parce que l’origine est première et la structure seconde dans ces échelles d’identification de classe inversées, un premier ministre peut dire : « Je suis un travailleur, mec » et, en partie, s’en tirer avec ça.
Les marques indépendantes de disques ont manipulé cette fausse conscience à leur avantage. Une fois qu’il était clair que les Sex Pistols, The Clash, The Stranglers n’étaient pas destinés à vivre du chômage, il devenait absurde qu’ils chantent la survie accrochée aux boulots de merde. C’est pourtant du maintien de cette contradiction que dépend la survie de l’industrie musicale, parce que le consommateur, délaissant sans arrêt les représentations fausses, recherche une expression de plus en plus précise qui saisisse à la fois l’intensité de ses désirs et la force de sa misère quotidienne.
A un degré jusqu’alors sans précédent, la musique pop des années 1970 a joué à fond sur la classe et les racines. A cause de son association avec le reggae, Roots a une relative connotation raciale, mais comme on le verra, la classe et les racines, en tant que concepts d’identification, étaient pour les Blancs comme pour les Noirs, interchangeables. Ce fut un aspect des stratégies des marques indépendantes. Quand le livre de Haley, ‘Roots’ (‘racines’ en anglais), a été pour la première fois transposé à la télévision, New Musical Express consacra au livre toute sa couverture et une page intérieure. Pour un Noir vivant aux Etats-Unis ou aux Caraïbes, savoir que ses ancêtres sont arrivés là, pieds et poings liés dans un navire négrier, a quelque importance; mais quel intérêt cela peut-il avoir pour une industrie musicale très largement blanche en Grande-Bretagne ? En fait, cette industrie n’a fait que reproduire la forme d’identité propre à la Grande-Bretagne, où par une sorte de régression à l’infini un lord (par exemple, Tony Benn, l’ex-lord Stangate) peut prétendre appartenir à la classe ouvrière en se référant à un ancêtre mort depuis longtemps.
Cette duplicité typiquement britannique était aussi présente dans le punk. Il y eut quelque surprise quand on apprit tardivement combien de musiciens avaient des origines sociales élevées, avaient fréquenté les écoles huppées, etc. On aurait pensé, d’après le premier disque des Clash, que tout le groupe avait toujours eu pour horizon l’échangeur de Westway, depuis l’une des tours de London W 10. Il s’avéra plus tard, beaucoup plus tard, que Old Joe (c’est-à-dire Strummer ) avait été dans une école privée et que papa était diplomate. Un manque d’honnêteté en cette matière est étonnant pour la Grande-Bretagne, et les Américains par exemple trouvent très bizarre cet art d’effacer ses traces. Cela tend à confirmer leur impression que la Grande-Bretagne est une nation d’agents doubles.
L’idéal des marques indépendantes serait un monde de la musique contrôlé par quelques petits producteurs indépendants: S’ils avaient la moindre chance de réussir une action politique, l’un des points de leur programme serait à coup sûr le démantèlement des grands monopoles de l’industrie musicale. C’est en tant que fraction de la bourgeoisie qu’ils s’opposent à leurs grands frères, beaucoup plus puissants. Par exemple, Branson, de Virgin Records, dans une déclaration défavorable aux intérêts des grandes compagnies attira l’attention sur la manière dont celles-ci manipulent les hit-parades. De telles déclarations sont bien accueillies par la majorité des musiciens, parce qu’un plus grand nombre d’entre eux auraient des chances d’être représentés sur le marché du disque si cette pratique cessait. Mais ça ne veut pas dire que les musiciens automatiquement parlent avec sympathie des marques indépendantes: en fin de compte, celles-ci ne vivent qu’en faisant de l’argent sur leur dos.
On oublie souvent que l’ascension météorique vers la gloire et la fortune des musiciens de rock au milieu des années 1950 a été favorisée à ses débuts par ces marques indépendantes, qui espéraient fourguer cent mille exemplaires d’un même disque. Elles s’aperçurent bien vite qu’elles pouvaient en répandre un million sur le marché, parfois davantage, et certaines, comme Atlantic, entrèrent dans la grande ligue avec un chiffre d’affaires mensuel de plusieurs millions de dollars. Certaines de ces marques, comme Atlantic, ont commencé quasiment. comme un passe-temps, ce qui rend un son familier quand on rapporte cela à certains développements modernes.
La gauche et la musique
Bien que les indépendants d’aujourd’hui fassent partie d’une dynamique de croissance endémique dans le capitalisme, le changement du climat politique et social poussa, particulièrement en Grande-Bretagne, les marques indépendantes à soutenir les propositions apparemment radicales faites par les syndicats, l’aile gauche du parti travailliste, et les militants trotskystes. Branson alla jusqu’à fermer certains de ses magasins de disques lors de la Journée d’action de février 1980 (organisée par le TUC).
Ce rapprochement unique entre le business syndical et l’appareil musical est accentué par leur intérêt pour la gestion du chômage massif des jeunes. Il y a une certaine fatalité dans la manière avec laquelle les syndicats sont amenés à faire des déclarations maladroites, mais impensables il y a seulement cinq ans, à propos du monde musical. Cette reconnaissance est favorablement accueillie par la presse musicale, qui rend la pareille aux Trade Unions, particulièrement le New Musical Express, en reprenant les vieux clichés que les parlementaires de gauche veulent à tout prix maintenir en vie.
Tout cela se révéla dans les incidents qui éclatèrent au moment de la Marche populaire pour le travail, en mai/juin 1981 et dans la réponse du New Musical Express aux émeutes. Quand la marche atteignit Manchester le 8 mai 1981 (presque deux mois jour pour jour avant l’éruption de Moss Side), il y avait, parmi les douzaines de fédérations syndicales présentes pour accueillir les marcheurs, un orchestre de tambours de Moss Side, à qui les haut-parleurs de la police interdirent de jouer. Un organisateur régional de l’UCATT (le syndicat des travailleurs du bâtiment) prit aussitôt leur défense. « C’est une honte, dit-il, que la police réprime ainsi sa propre classe. » Ce genre de niaiserie que les gens de Moss Side ignorent heureusement se retrouve aussi dans la presse musicale « politiquement consciente ».
Dans un lamentable article sur les émeutes, le journaliste du New Musical Express, Chris Salewicz, fit la remarque assassine suivante : « Le gouvernement est en train de jouer un jeu dangereux avec la vie des gens, la vie des kids et la vie des policiers – des vies de la classe ouvrière. » L’art frivole du forgeur d’expression fut cette fois incapable de masquer la misère intellectuelle du journaliste musical. Laissant de côté la prudence gâteuse de Foot, Salewicz déclara que les seuls mouvements politiques constructifs dont il eût entendu parler venaient des Jeunesses Socialistes du Labour Party, qui proposaient « l’idée de l’action collective par une transformation socialiste du Labour Party, comme seule issue à nos problèmes. Certainement, nous pouvons pas s’en sortir par dansant. Fin du sermon. »
Et fin de Chris Salewicz. Il n’y a pas la moindre allusion à l’idée d’en finir avec la marchandise, l’Etat, le travail salarié, etc., et c’est de cette même position conservatrice et avantageuse que les Specials jugèrent les émeutes. Leur disque, Ghost Town (ville fantôme), qui lançait un avertissement prémonitoire (« Pas de boulot dans ce foutu pays/ça ne peut plus durer, les gens deviennent se fâcher ») appelait des commentaires de leur part. « J’aimerais, déclarait Lynval Golding, que le gouvernement écoute nos chansons. Nous arrivons à communiquer avec les kids à leur niveau. On parle avec eux dans les pubs, on connaît leurs problèmes. » Le succès de cette chanson dans les hits a été défait par la rue. Si Ghost Town avait été écoutée par le gouvernement, les choses se seraient peut-être réglées courtoisement, avec l’amabilité bien connue de l’Etat, et les émeutes auraient peut-être été stoppées avant même qu’elles commencent. Perspective déprimante !
Quelque six mois plus tard, un autre ex-membre des Specials, Terry Hall (maintenant le Fun Boy Three) entonnait encore le même air. « Ghost Town a été premier dans les hits et il y avait des émeutes et des combats encore longtemps après, ça n’a donc rien accompli dans le sens de les empêché. »
A moins d’une révolution sociale, la prévention des émeutes n’est pas une activité dont on puisse être fier et Terry Hall, parce que le disque n’y parvint jamais même à moitié, fut libéré d’une telle tâche. Si les désirs étaient tout-puissants, le succès de Ghost Town aurait dû être couronné par le vidage des rues (pour créer des villes fantômes ?). Qu’il en soit ou non conscient, Terry Hall est de ce parti du mensonge qui a manipulé l’image des émeutes pour qu’on n’y voit pas l’annonce d’une révolution sociale à grande échelle.
Nouvelles de la Jamaïque : quoi de neuf ?
La vague actuelle du rock et du commentaire journalistique politisé fournit un mandat que la structure politique d’un parti de gauche pourrait, tout à fait utiliser pour contrer efficacement, surtout chez les jeunes, une tendance chronique à l’abstentionnisme. Mais c’est vers la Jamaïque que nous devons nous tourner pour trouver le plus parfait exemple de patronage de l’Etat sur la musique moderne.
Sous le régime social-démocrate et populiste de Michael Manley (1972/1980), le reggae, bien que totalement soutenu par le capital privé, est devenu l’objet d’un patronage politique. Manley se fit un devoir de faire des apparitions dans les concerts de reggae; ses ouvertures envers le rastafarisme et l’usage du patois lui rapportèrent quelques bénéfices politiques. Au cours du One Love Peace Concert (concert unique pour l’amour de la paix) qui eut lieu en 1978, d’immenses placards publicitaires exhortant le peuple – « Construire avec discipline la Jamaïque » – « Travailler ensemble pour l’autosuffisance » – « En avant avec la constitution du peuple » – accompagnaient le spectacle.
Ces concerts peuvent même être considérés comme un prototype politico-esthétique expérimental destiné à redonner un souffle, à travers de la fascination de l’art, à la « bataille pour la production », à la manière du stalinisme. Inutile de dire que le contenu révolutionnaire de ces festivals était inexistant.
Mais la facilité avec laquelle Manley et le PNP (People’s National Party) ont manipulé les musiciens reggae a révélé combien ceux-ci ont trahi quelques-unes de leurs prétentions radicales. L’opération de Manley et du PNP sur le reggae a plus ou moins coïncidé avec l’accord d’un prêt draconien par le FMI, lequel fut la cause d’une nouvelle aggravation de la condition de la classe ouvrière (durant les huit années de « socialisme démocratique », le coût de la vie a augmenté de 320 %), et entraîna pour Manley la perte de nombreux soutiens. Manley avait fait de gros efforts pour manipuler les aspects les plus corporatistes de la « conscience noire » en Jamaïque (allant même jusqu’à se faire appeler Joshua) ; mais, en dernière analyse, le reggae comme la mystification religieuse et raciale furent incapables de controler la désharmonie de la classe ouvrière soulevante.
Derrière son apparence pure et dure, le reggae a une nature politique particulièrement tendre. Du temps où Manley était Premier ministre, les bénéfices que faisaient les musiciens du reggae qui jouaient dans ces concerts d’inspiration politique allaient vers le secteur de l’assistance sociale et les projets de création d’emplois. En fait, la politique du reggae a, depuis longtemps, été dirigée vers la gestion du chômage – et le message destiné aux chômeurs a toujours été de « se calmer » (C’est le titre du premier disque de Bob Marley – un tranquillisant pour les durs de Kingston.)
Sans aller jusqu’à entamer sérieusement la crédibilité du Reggae, ce qui s’est passé en Jamaïque a été beaucoup plus qu’un secret public en Grande-Bretagne. Il y a de plus en Jamaïque une liaison organisée entre le chômage et le gangstérisme politique (lors de la campagne électorale de 1980, 700 personnes, en majorité des pauvres, furent tuées par des gangs armés du Jamaican Labour Party et du PNP), ce qui fournit en permanence une base à partir de laquelle les musiciens reggae peuvent, sans perdre la face, exhorter à la paix. L’expérience du chômage en Grande-Bretagne est, en revanche, beaucoup plus sociale, espérons que cela dure. Black Uhuru, terrifié de voir avec quelle promptitude les jeunes d’Eglington (Canada), d’Utica Avenue ( New York) et de Kingston (Jamaïque) mettaient la main au revolver, doivent reconnaître qu’à Brixton les jeunes « ont laissé leur Smith et Wesson au vestiaire ». Pour le moment, l’absence, dans les rues de Grande-Bretagne, des fusils et des ports d’armes pour affirmer son appartenance politique montre qu’il y est moins facile de manipuler la violence et que les questions sociales peuvent s’y manifester plus ouvertement. Cela suffit à rendre absurde la conclusion de Black Uhuru : « Les kids veulent seulement aller à l’école ! » En regard de l’éventail unique des ruptures sociales qui sont maintenant possibles en Grande-Bretagne, un tel « lyrisme » se dégrade en sermon pour le néant – et ce qui demeure, c’est l’esthétique frustrante de la musique pour la (comme?) musique.
L’économie souterraine et le rock: à la recherche d’une petite dose de respectabilité
La new wave, plus que toute autre phase de la musique rock, s’est nourrie de l’expérience du chômage et du refus de l’idée d’accepter les quelques sales petits boulots mal payés encore disponibles. En peu de temps, cette musique fut connue comme « le rock de la queue de chômage », comme une vitrine du chômage. Elle attira en particulier l’attention de chômeurs qui venaient de quitter l’école, leur donnant un moyen d’intégration dans ce cirque, moyen hors de portée des chômeurs plus vieux sans perspectives qui se sont « établis » dans une vie centrée sur les allocations. Etre à la fois chômeur et musicien représentait, jusqu’à la signature d’un contrat, une espèce de populisme clochard, en attendant la valorisation personnelle dans un rôle de star à la gueule moite.
Quand la new wave apparut, l’idée que le chômage de masse ne partirait pas commençait à s’infiltrer dans les cercles gouvernementaux. Il fallait trouver des solutions à long terme qui soulagent la stigmatisation du chômage. Pourtant avec la victoire des Conservateurs aux élections, les chômeurs furent, à court terme, mis en accusation et servirent de bouc émissaires pour tous les maux de la société.
Le choix de faire de tels remous montre que les Tories étaient incapables, à partir des résultats obtenus par ce laboratoire sonore spontané, de tirer le moindre enseignement sur la meilleure façon de gérer le chômage. Mais la vieille ficelle [????]du studio d’enregistrement a été finalement reprise: on en trouve aujourd’hui jusqu’au fond des clubs de jeunes. Et les animateurs sociaux sont une création du capitalisme plus durable que le thatchérisme.
Les monétaristes du Royaume-Uni n’avaient pas manifesté de préférences artistiques mais ils devaient détester doublement la nouvelle vague pour son association passée avec l’économie souterraine. Les disques étaient fabriqués et financés par celle-ci, mais il faut dire que la signature d’un contrat parallèlement à l’exercice d’un boulot pourri fut pour l’essentiel une création de la mythologie punk. Les punks au chômage couraient constamment le risque d’être dépouillés par les escadrons fiscaux aux aguets. Il y eut un cas particulièrement absurde quand un groupe fut chopé en train de jouer pour une fête de Noël d’un centre ANPE locale.
Jusqu’alors, le Labour Party et l’appareil syndical avaient méprisé l’économie au noir, la considérant comme un cloaque où proliféraient les jaunes. Ils ont dû changer d’idée. Son mauvais goût mis à part, l’idéologie des punks pouvait s’inscrire dans un schéma de gauche. Avec les concerts de Rock Against Racism, les carnavals et les contrats, la new wave gagna peu à peu en respectabilité. Ce contact sans précédent avec un art de masse « socialement conscient » fut une étape essentielle dans l’évolution vers la tolérance syndicale pour l’économie souterraine, poliment rebaptisée « l’économie de l’ombre ».
Le fait d’avoir à élargir un peu le sens de certains mots ne signifie pas que l’appareil syndical ou le Labour Party qui dominent les appendices locaux de l’Etat dans les grandes villes soient prêts à laisser l’économie parallèle s’associer aux émeutes. Ils aimeraient la tenir en réserve en la liant peu à peu à des industries locales subventionnées, à .des coopératives, et aux projets destinés à résorber le chômage local. Ils espèrent, contre toute vraisemblance, que tout cela deviendra autosuffisant – peut-être le jour où le ‘Programme pour le redressement’ du TUC entrera en vigueur ou commencera à faire son effet.
Cet objectif n’est pas intrinsèquement étranger au gouvernement conservateur actuel. Le point central du désaccord porte sur le montant des dépenses gouvernementales nécessaires au sauvetage du capitalisme. En fait, les Conservateurs ont garanti à l’économie parallèle une légalité de facto, s’il peut être prouvé qu’une personne fait des bénéfices pendant le temps nécessaire à la mise sur pied d’une entreprise viable. L’initiative doit être subventionnée et un groupe pop qui passe de la queue de chômage à une situation requérant les services d’un comptable entre dans ce cas de figure.
“You dont know how lucky you are: back in the USSR” [46]
La régulation étatique du petit commerce est un produit de la gestion centralisée qui s’est considérablement accrue depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est encore un écho lointain des contraintes économiques et idéologiques que les régimes capitalistes d’Etat font subir aux activités du petit commerce.
Les régimes de l’Est sont jusqu’à présent loin d’avoir récupéré la musique rock, le chômage et le refus de travail avec le même succès que l’Ouest (bien que le refus de travail, par essence, ne soit jamais récupérable). Une combinaison beaucoup plus explosive fait que là-bas les émeutes aux concerts de rock, à moins d’être vite arrêtées, peuvent facilement déborder et se transformer en une rébellion générale (par exemple Berlin Est, 1978). De plus les groupes pop ne possèdent pas la liberté économique et idéologique que leurs homologues de l’Ouest tiennent pour naturelles. A moins d’un ébranlement général, il est virtuellement impossible pour des musiciens rebelles de « doubler » [trahir?] le prolétariat en arborant, lorsqu’ils l’abandonnent, tous les leurres insultants du succès.
Des changements dans le mode de production musical… ?
Une critique profonde de la musique, c’est-à-dire qui ne tourne pas autour du pot, est difficile à faire. Dénier tout intérêt à ce qui est arrivé depuis le milieu des années 1950 en le considérant comme l’œuvre diabolique de trusts musicaux pour dévoyer le prolétariat ne tient pas. La musique rock a possédé depuis ces années 1950 un public de masse qu’aucune autre forme d’art n’a jamais eu. Cependant le rock est irrémédiablement pris dans le système de représentation du capitalisme, cet enivrant miroir déformant, comme dans des contradictions auxquelles le public prolétarien réagit de façon pertinente.
Mais jusqu’à présent, on a rarement tenté d’analyser la musique rock comme une branche spécifique de la production capitaliste. La musique et les artistes rock ont occupé le devant de la scène tandis que les gestionnaires, les producteurs de disques, les ingénieurs du son, les financiers faisaient leur boulot à l’abri des regards.
Les rares exemples d’analyse sont au mieux ambigus et ruinés par une incapacité à frapper fort. Charlie Gillet dans son livre sur Atlantic Records dit très justement que « le livre traite de chanson et d’argent », puis il marche sur des œufs, en louant la compagnie Atlantic d’être une « maison de disques qui a du caractère – au lieu d’être une société sans visage » ; il va jusqu’à parler des services d’Atlantic à New-York, qui sont « vivants et efficaces – en comparaison de tous les autres services bureaucratiques que j’ai pu voir. »
C’est peut-être ce qu’il veut dire par une « maison de disques qui a du caractère » [société attendrissante]? Le livre de Gillet peut légitimement être pris comme un reproche adressé aux autres compagnies, telles RCA, Capitol, EMI, etc., les priant de s’amender. Dans son bouquin Making Tracks, on ne trouve pas trace de cette conscience que les entreprises de production devront, comme le reste du capitalisme, disparaître.
Le dépassement de la musique…
Plus que toute autre forme d’art, la musique donne une impression de vie qui met en jeu aussi bien l’esprit ludique et le sexe que l’amour et les rythmes du corps. Il est impensable de contempler à separer Jimi Hendrix – cette musique égale à celle de Charlie Parker – aux courants qui déchiraient l’Amérique de la fin des années 1960.
Les concerts musicaux permettent rarement un relâchement cathartique de l’énergie; c’est à l’heure de la fermeture des clubs que les choses sérieuses de la soirée commencent, au point où la musique s’est arrêtée. En comparison avec ce que s’est passé hors des discoteéques en Dalston en mai/juin 1981 et le Club 200 en Balham (des quartiers de Londres) en juillet 1981, la performance notoire du ‘4 Skins’ dans le Hamborough Tavern est méchant et pas de tout pertinent.
Lors de la première de la longue série des émeutes urbaines qui devaient frapper la Grande-Bretagne (les émeutes du carnaval de 1976/1977), les espérances de satisfaction déçues et la présence provocatrice de la police causèrent l’explosion. Cela fit un effet aussi fort sur la « communauté noire » que sur la « société blanche » parce qu’il fut tout de suite évident que la jeunesse des Caraïbes née ici méprisait le cirque transposé des traditions de Trinidad dans les rues de Notting Hill. Les appels des organisateurs à cesser de « gâcher le carnaval » furent ignorées, les chars sur lesquels se trouvaient les orchestres, et les systèmes sonores vrilleurs de nerfs renoncèrent et s’en retournèrent, désolés d’avoir été empêchés de jouer jusqu’aux premières lueurs du jour, comme lors des années précédentes.
Au contraire de ce qui se passa pour la police et les vitrines de magasin, il ne fut jamais question de s’en prendre directement aux machines à musique (bien que la rumeur dire que cela fut bien prêt d’arriver à quelques reprises). Quant aux orchestres et aux propriétaires de sonorisation, l’idée frustrante d’avoir été traités sans cérémonie était difficile à encaisser. Même si c’était cibler à un niveau assez bas, ils avaient été l’objet d’une critique qui, presque par défaut, incluait la musique.
Il est même possible que certains des jeunes Noirs qui participèrent aux émeutes du Carnaval aient fait partie du personnel des systèmes de sonorisation mobile. Certains font ce travail pour améliorer l’allocation du chômage et ce sont souvent des individus remarquablement discrets. Bien qu’ils soient investis dans la musique, ils n’ont pas un égo artistique, ayant acquis une attitude laissez-faire envers la musique.
Cette insouciance est, entre autres choses, le produit des facteurs techniques liés à la mécanisation accrue de la musique, qui relativisent [‘dévaluent’ est mieux] le statut de la dextérité manuelle sur l’instrument.
Par coincidence, la plus forte poussée dans ce sens est venue de l’évolution du reggae en Jamaïque, où la part des morceaux obtenus par des procédés électroniques dans les studios d’enregistrement a repoussé les spectacles en direct à l’arrière-plan. Dub a grandi grâce aux discos mobiles et aux systèmes de sonorisation. King Tubby, l’un des tout premiers innovateurs, était à l’origine un ingénieur en électricité faisant. Dopé par des injections massives de réverbération et d’écho, l’essentiel de la basse, des percussions, du clavier et de la voix fut mixé en des séquences aléatoires. Quoi d’étonnant à ce que ces kids noirs de Grande-Bretagne soient plus attirés par les systèmes de sonorisation que par l’idée de devenir des joueurs musicales. De façon contradictoire, ils vivent déjà au-delà du concept de l’individu artiste.
Il y a maintenant de nombreux facteurs tant techniques que subjectifs qui poussent au dépassement des musiciens et de l’industrie musicale. Faire de la musique devient accessible à tous. Pendant de longues années, comme peu d’autres traditions « folk », le rock a réservé une place à part au magicien des trois accords. Mais le « culte du génie » et les combines commerciales ont élevé, de façon inouïe, quelques élus à un niveau beaucoup plus riche, où ils étaient les seuls maîtres en musique.
Ce fut la conséquence inévitable de la capitalisation générale de la musique, qui impliquait l’abandon des droits de propriété ordinaires. Cette évolution fut rendue possible par la complicité des musiciens professionnels à qui on offrait l’occasion de faire une carrière inhabituelle dans la musique. Ces musiciens professionnels qui, en un rien de temps aiment se considérer comme des gens diablement importants ayant droit à des privilèges particuliers, sont déjà la cible de commentaires de dérision, mais il faut rendre cela encore plus explicite. Pour le moment, la principale ligne de défense des « pros » est la ficelle populiste [‘de manipuler les gens avec une idéologie populiste’ est mieux] , qui est le recours de tous les professionnels quand ils sentent leur rôle menacé. C’est pourquoi une critique de la musique est organiquement liée à la redécouverte d’autres fonctions, que le capitalisme a retirées au prolétariat. Un immense travail de démolition à l’encontre de la musique est nécessaire. Ce ne sera que lorsque la planète sera débarrassée de la marchandise que la musique cessera de ne satisfaire nos désirs qu’à moitié, mais pourrons-nous encore parler de musique? En attendant cette aube magnifique, à bas les musiciens ! Et pendant que nous y sommes, à bas l’art et tous les artistes. Ça a déjà été dit, mais cette répétition n’est pas superflue.
Crime et Châtiment
voiture fracassé dans le fenêtre d’un commissariat
« Les prisons modernes ne sont pas perfectibles puisqu’elles sont déjà parfaites. Il n’y a rien d’autre à faire qu’à les détruire. » Victor Serge (Les hommes dans la prison, 1914).
Dans les taules et les clefs mises au poubelle
2500 personnes furent arrêtées et emprisonnées durant la semaine d’émeutes. Initialement, le trop-plein de prisonniers devait être logé dans les camps de l’armée tel que celui de Rolleston, qui avait déjà reçu des prisonniers pendant la récente grève des matons, grève à propos des salaires. Ce n’était pas exactement des camps de concentration, comme l’a écrit Tass (le 14 juillet 1981), mais si le personnel pénitentiaire avait continué sa grève, c’est l’armée qui aurait dirigé les camps. La loi sur la détention provisoire avait été votée douze mois auparavant, en 1980. Elle semble bien être un pas de plus dans l’escalade vers un Etat militaire, même si des grèves de matons peuvent encore éclater dans le futur. En décembre 1981, par exemple, les matons refusèrent de prendre les prisonniers condamnés à de courtes peines, à cause de la surpopulation des taules. Ces vieilles carnes ont finit par craquer du fait de leurs conditions de boulot et ont décrété un beau jour que les arguments des réformateurs de prisons, qu’ils haïssaient au passé, convenaient désormais à leur action « ouvrière ». En tout cas, cette mansuétude est bien peu de chose [l’originale est un détournement d’une ligne très connue de Shakepeare en ‘Merchant of Venice’; c’est marrant parce que c’est mélangé avec des expressions argots de la classe ouvrière] quand on sait que les matons sont prêts, au nom de leurs intérêts catégoriels, à envoyer les taulards dans des camps de l’armée.
Whitelaw, les magistrats et le pouvoir de la populace
Comme on pouvait s’y attendre, les pressions exercées sur le gouvernement Tory pour qu’il mette en place des mesures spéciales anti-émeutes pendant et après la semaine de révolte furent particulièrement fortes. Après tout, il avait été élu sur un programme de légalité et d’ordre. Mais le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Whitelaw, avait été prévenu plusieurs semaines auparavant que les prisons étaient pleines à craquer et qu’une autre fournée de petites peines pourrait être catastrophique. Avant que la première pierre ne soit lancée, Whitelaw avait tenu prêts les camps militaires, ce qu’il fit passer ensuite pour la réponse gouvernementale aux exigences des médias, qui réclamaient bruyamment de nouvelles mesures à l’égard des émeutiers.
Il y eut, par exemple, beaucoup de discussions pour remettre en vigueur la loi anti-émeutes qui avait fait partie du Code depuis les émeutes londoniennes du XVIIe siècle et qui n’avait été abolie que – incroyablement – en 1967. D’après les termes de cette loi, quiconque était arrêté sur les lieux d’une émeute était présumé coupable et le droit au jury lui était refusé automatiquement. Les Tories se sont jusqu’à présent abstenus de prendre des mesures aussi draconiennes, mais il existe à l’intérieur du gouvernement de puissants courants en faveur d’un pouvoir répressif accru pour les magistrats (la responsabilité d’exécuter la loi anti-émeutes fut laissée essentiellement aux magistrats). Ces courants veulent abolir le droit, pour un grand nombre de délits, d’être jugé par un jury, au profit d’un tribunal plus important[47]. On peut dire qu’au sein du thatchérisme réformes et noire répression alternent sans cesse dans les mêmes cerveaux pourris.
Cependant, même pour le thatchérisme, les considérations pragmatiques ont gagné. Rien qu’à cause des conditions de détention, Whitelaw a dû négocier un virage pénal complet, même pour les prisonniers condamnés à de courtes peines, qui ne feraient plus que le tiers de leur temps. Juges et magistrats se sont mis en travers de ce projet, avertissant Whitelaw qu’ils augmenteraient les condamnations si jamais son projet était mis à exécution.
Confronté à la puissance du pouvoir judiciaire, Whitelaw a dû battre en retraite, ce qui servit à étayer la thèse de l’indépendance du pouvoir judiciaire en Angleterre, qui est une caractéristique si exceptionnelle de la Justice en Grande-Bretagne.
La facilité avec laquelle les gens peuvent finir en taule en Grande-Bretagne est pour plus d’un Anglais une source perpétuelle de cauchemar. Une masse de gens lit ou regarde à la télé avec une horreur proche de la fascination les conditions de détention rapportées par les partisans libéraux de certaines réformes. (Par exemple, huit millions de spectateurs regardent régulièrement un documentaire de la BBC sur la taule de Strangeway à Manchester. L’émission n’a évidemment jamais réclamé une abolition inconditionnelle et révolutionnaire des prisons.) En outre, la Grande-Bretagne a une population pénitentiaire supérieure à celle de tous les pays européens et le pouvoir judiciaire anglais fournit l’exemple le plus notoire d’esprits étroits [étriqués?; bornés?], entêtés et ignorants.
En réalité, les Tories ne firent que promettre de prendre des mesures sévères contre les émeutiers. La répression fut laissée aux bons soins du judiciaire planqué dans son territoire qu’il garde jalousement. C’est ce que les Tories souhaitent depuis le début, leur projet étant de rétablir une hypothétique division entre le civil et le politique, selon les dogmes du capitalisme du laisser-faire. Ironie suprême, le gouvernement Tory s’est acharné à arracher des changements à l’un des secteurs de la société qu’il vénérait le plus.
Les émeutiers se payèrent des condamnations épouvantables : huit ans ici, cinq ans là, simplement pour avoir lancé un cocktail. Si ‘The Angry Brigade’ (la Brigade enragée) avait mené ses actions dans les années 1980, en dépit de ses illusions terroristes, elle se serait pris dans les cinquante ans par tête de pipe. On a fait peu de battage pour ceux qui étaient tombés, hormis quelques extraits dans les canards les plus « concernés ».
Une grande partie des émeutiers qui passaient en justice n’avaient pas de travail, ce qui augmentait encore leurs chances de tomber sur des magistrats et des juges hostiles au premier coup d’œil. C’est un lieu commun maintenant de relier la morale du travail à l’émergence du capitalisme industriel, mais la persécution acharnée des sans-travail, surtout de la part des juges, a des racines bien plus anciennes en Angleterre.
Marx consacra un chapitre entier du Capital à la « Législation sanguinaire contre les expropriés », qui est encore très poignant à lire. Il y décrit comment les mendiants, privés de tous moyens de subsistance, furent, depuis les Tudor, marqués au fer rouge, fouettés et emprisonnés. La genèse de la rente foncière fut à l’arrière-plan de ces tortures. Différentes lois, expression d’une législation ouvertement capitaliste, établirent· avec une précision sinistre ce que le pouvoir judiciaire local pouvait couper (mains, pieds, etc.). Il serait stupide de suggérer que ces lois de 1530 ont eu une influence directe sur les juges vengeurs qui siégeaient dans les tribunaux de l’été 1981. Mais de telles habitudes sont tenaces, surtout pour des vieilles institutions comme la justice anglaise. Toute explication de ces condamnations atroces, doit remonter, en partie au moins, jusqu’à ce passé vénérable. Pour être exact, au jour où la première oreille fut coupée.
De nos jours, les travailleurs britanniques sont beaucoup plus protégés, en comparaison, contre les poursuites judiciaires, et les jugements délirants des magistrats hostiles aux puissants groupes ouvriers (Dennings and Co) sont très vite cassés par des cours d’appel plus réalistes (en général, la Chambre des lords).
La bourgeoisie a eu les chocottes d’introduire une législation répressive contre les luttes ouvrières (voir, par exemple, la malheureuse loi sur les Relations du Travail du gouvernement Health), même depuis le week-end dramatique de juillet 1972, quand cinq dockers furent flanqués en taule à Pentonville. Ils furent relâchés le lundi matin, la justice ayant trouvé un biais légal pour prouver son autonomie. Il y a peut-être un rapport entre ce cadeau inattendu de la justice en l’air et un tentatif d’attaque par des manifestants de la prison de Pentonville[48], ainsi que la grève générale sauvage qui commençait à se répandre en Grande-Bretagne, tel un feu dans le maquis.
Les chômeurs ne peuvent utiliser les armes de la grève ouvrière et des occupations d’usine. Cependant il était possible de faire beaucoup plus pour défendre les émeutiers arrêtés contre la vengeance des juges. Pour faire connaître les conditions de détention des emprisonnés et préparer leur procès, on aurait pu occuper des bâtiments publics. Mais aucune assemblée permanente des gens vivant dans les quartiers des centres-villes n’émergea des cendres et les quelques propositions allant dans ce sens échouèrent, faute de réunions publiques. Quand, par exemple, dans un cadre très différent, les travailleurs en grève de la société Ascon à Vigo en Espagne se révoltèrent (cf. La pauvreté du syndicalisme dans Wildcat Spain Encouriters Democracy – c’est-à-dire L’Espagne sauvage rencontre la démocratie), cassèrent des banques, des magasins, incendièrent des voitures, élevèrent des barricades, etc., et ce à partir de l’existence d’une assemblée souveraine, dans laquelle malgré les manipulations du comité de grève et des syndicats, les erreurs et succès des actions étaient ouvertement discutés.
Quand une société est ravagée par des crises périodiques comme l’est la Grande-Bretagne, le système et pénal est l’un des premiers gardiens de l’ Etat à sentir la tension. C’est pourquoi en appeler à la tradition et espérer que tout se passera bien, comme le fit Whitelaw quand il fut confronté au pouvoir judiciaire, est un non-sens historique. Les juges sont d’une espèce différente de ceux du XIXe siècle, car la situation a dramatiquement empiré et parce que la Grande-Bretagne devra probablement faire face à un bouleversement révolutionnaire dans les années qui viennent.
Dans de telles situations, la loi perd toutes ses prétentions à l’impartialité (nécessaire pour sa légitimité) et la justice est de plus en plus arbitraire. La jurisprudence bourgeoise connaît de violents accrocs. Avec, en plus, le pouvoir croissant de la police (y compris celui de tuer et d’être excusé pour légitime défense, comme dans l’affaire du maître d’école Blair Peach sans parler des célèbres morts suspectes de Jimmy Kelly, Liddle Towers, Barry Prosser et autres pendant qu’ils étaient en taule[ou garde à vue- « in custody » peux être les deux – « incarceré »?]), le système des libertés civiles fait maintenant des embardées dingues. Ce système était autrefois la fierté de la classe dirigeante britannique, et beaucoup de réfugiés politiques, comme l’anarchiste Johann Most (à ses dépens), considéraient qu’il allait de soi [bonne traduction de « took for granted »?].
Bien que les condamnations assenées aux émeutiers aient été ouvertement destinées à intimider leurs camarades et qu’elles soient en rupture avec la réputation traditionnelle de ‘fair play’ (literalement ‘jeu juste’) du système pénal britannique, elles sont toujours en continuité avec ce système. La loi britannique est basé sur ‘precedence[49]‘ et obéit, comme tout le monde le sait, à une jurisprudence très puissante politiquement et qui peut saper l’autorité de lois votées par le Parlement, si elles vont à l’encontre d’un Code juridique anachronique qui détermine le bien et le mal. Le récent projet voté par la Chambre des lords et qui abolit la politique des transports bon marché justifia de sa légitimité en se référant à un texte du XIXe siècle qui exigeait l’autofinancement des transports publics comme ‘devoir fiduciaire’. Dans toutes les autres grandes villes du monde, il est admis que le système des transports publics fonctionne à perte.
Il y a d’habitude des contrepoids traditionnels à ces procédures, pour éviter que l’a nature fondamentalement arbitraire de la loi britannique ne devienne complètement délirant. Par exemple, les Conférences spéciales des juges, où ceux-ci échangent leurs impressions. Quand cela n’a pas lieu et que des sentences aberrantes sont rendues, le Président de la Cour Suprême peut répondre (comme il l’a fait en certaines occasions), à des déclarations qui dénoncent cet outrage à la conscience, pourvu qu’elles proviennent de piliers reconnus des institutions. Mais il n’yen eut aucune pour les condamnations des émeutiers. C’est un point de non-retour pour la loi britannique et un avant-goût écœurant de ce qui nous attend. Sous leurs perruques et leurs robes, derrière leurs manières aristocratiques et leur pédanterie juridique, ces vieillards bigots, ces mystiques excentriques, ces fétichistes de la matraque ont lâché la bride à leur sadisme.
Des infirmiers « populaires » pour une justice malade
Il y a beaucoup de forces qui font de leur mieux pour que la justice ne devienne pas complètement cinglée; le bas de l’échelle judiciaire comprend des corps influents, comme le Groupe parlementaire des affaires pénales, qui regroupent des membres de tous les partis. Ce groupe a publié un rapport à chaud (le 7 juillet 1981) pendant les émeutes, ‘Jeunes délinquants, une stratégie pour le futur’. Il appelait à renverser la tendance actuelle qui consiste à enfermer de plus en plus petits délinquants.
La parution de ce rapport ne fut pas noyée sous les huées d’indignation disciplinées, mais il ne fut pas davantage accueilli à bras ouverts[dans l’originale c’est très dificile de comprendre ce qu’ils veulent dire ici]. D’autres groupes défendent un point de vue similaire (par exemple, le groupe Howard pour une réforme pénale). En bref, leur programme c’est la réforme de la législation, l’îlotage policier,[ « le quadrillage par les travailleurs sociaux » n’existe pas dans l’originale] et les peines sans incarcération afin de réduire la population pénitentiaire. Tout est fait pour empêcher « l’application arbitraire de la loi », avant qu’il ne soit trop tard.
Heureusement, les événements montrèrent que la radicalité de ces rapports était mensongère, et explicitement pas revolutionnaire: la secrétaire générale du NCCL (Conseil National pour les Libertés Civiles), Patricia Hewitt a écrit un article dans le Times (16 juillet 1981) où elle condamne toutes sortes d’injustices bien apparentes : gaz CS, quadrillages et rafles de la population d’Irlande du Nord, balles en caoutchouc, canon à eau, lois anti-émeutes, couvre-feu, etc. Mais l’agitation dans la rue a clarifié de quel côté de la barrière se plaçait le NCCL. « C’est épouvantable », écrivit la secrétaire générale, « que les policiers aient à affronter maintenant les cocktails Molotov. »
Les illusions de ces groupes de pression viennent de leur idée de la loi, qui peut, pensent-ils, gérer véritablement les grandes crises sociales dans une façon juste. Un groupement national d’avocats, le Groupe d’action légale, a condamné, par exemple, les propositions visant à introduire une nouvelle loi anti-émeute qui aurait, selon eux, « de sérieuses conséquences pour le système judiciaire, qui se doit d’être encore plus impartial pendant les périodes d’agitation sociale et politique ».
Toutes les expériences historiques prouvent le contraire, et ce qui s’est passé récemment dans les tribunaux britanniques, ce ne sont pas des erreurs judiciaires. L’équité est l’apanage des régimes bourgeois stables, car il arrive un moment où les conflits de classe atteignent un point de non-retour, et où la bourgeoisie doit restaurer l’ordre capitaliste par n’importe quel moyen. Dans ces moments, le consentement du prolétariat est un luxe qu’elle ne peut pas s’offrir.
Les conclusions hyper-légalistes auxquelles arrivent les avocats radicaux n’ont aucune valeur historique, pour d’autres raisons. Les avocats radicaux sont un produit des tensions entre les deux classes fondamentales de la société. Leur survie dépend de l’acceptation générale du caractère « objectif » de la loi. Ils se tiennent entre les deux classes principales sans avoir d’ancrage dans aucune des deux. Leur conception de la justice comme d’une entité relativement neutre doit s’opposer naturellement à la lutte de classe révolutionnaire. L’appareil judiciaire est après tout un appareil d’Etat. Insister sur la nécessité d’augmenter le contrôle du pouvoir judiciaire (« plus d’impartialité, pas moins »), c’est simplement l’une des manières de rendre l’Etat plus sensible, plus intelligent, pas le prélude à son abolition. Quand la loi est battue en brèche et que l’autorité est partout défiée, c’est que l’Etat se désintègre. A ce stade, la loi est en voie de la suppression sous la poussée du mouvement de la justice sociale prolétaire. Pris entre deux feux, les avocats radicaux ne peuvent que se tâter inutilement, réprimandant faiblement les abus des deux parties combattantes, et devenant jour après jour des figures tragiques.
Une illustration marquante de cela a été fournie pendant les jours qui suivirent l’émeute de Brixton en avril 1981. Plusieurs journaux ont mentionné le fait que Rudi Narayan, l’avocat noir qui a défendu les émeutiers de Bristol, reçut un accueil plus que frais à Brixton quand il essaya de tirer profit des événements de là-bas. Selon le groupe anar du coin eXtra, le Comité de défense de Brixton renonça à demander une amnistie pour tous ceux qui avaient été arrêtés et, craignant des troubles, décommanda la manif prévue. Narayan n’a jamais dit clairement en public s’il y était opposé ou non. La loi étant la loi, semble-t-il. La violence de la justice à l’égard des Noirs a fait Narayan. La violence de leur réponse l’expose pour ce qu’il est.
Guerre de clans
La justice et la défense de l’Etat
L’émeute de Bristol en avril 1980 claqua comme un coup de tonnerre inattendu sur la scène britannique. Elle éclata de la grisaille [‘inattendu’ est le sens du ‘out of the blue’], le week-end où la grève de la sidérurgie, la plus longue de l’après-guerre, commençait à tourner en eau de boudin. Parce qu’à ce moment-là il a semblé que cette émeute était un moment isolé, et non le premier de tant d’autres, la bourgeoisie a pu se payer le luxe de la clémence. Ils se remuèrent les méninges pour trouver une explication qui leur permette de laisser dans le fourreau le sabre vengeur de la justice. Tous les accusés qui choisirent d’être jugés par un jury furent acquittés. Il fallut environ un an pour que toutes les affaires soient examinées.
Vinrent les émeutes de l’été 1981, dans toute la Grande-Bretagne. Il était évident que la bourgeoisie ne pourrait plus se permettre les mêmes ‘luxes’. Ils avaient été valables pour un seul évènement, une simple goutte d’eau, pas pour un robinet qui coulait sans fin. Désormais, on ne pourrait éviter une justice sommaire, sinon les tribunaux seraient surchargés.
Comme le Times l’a admis, le gouvernement était très désireux que les tribunaux frappent pour l’exemple, pour effrayer les autres. D’autre part, une répression complètement aveugle ferait plus de mal que de bien. Aussi Thatcher utilisa-t-elle la question embarrassante des condamnations pour diviser les émeutiers qui avaient « copié »[50], disait-elle, ceux de Mosside et de Toxteth. Le Times du 13 juillet a rapporté ses paroles : « Il n’est pas nécessaire de rechercher les origines de la délinquance des trois derniers jours, qui est due à l’effet d’imitation. En revanche, il faut se pencher sérieusement sur les causes des émeutes de Toxteth et de Manchester. »
En autorisant les tribunaux à agir d’une manière particulière à leur égard, Thatcher lançait des fleurs aux émeutiers « suivistes ». C’était une reconnaissance implicite du fait que l’irruption de la délinquance d’après-guerre avait atteint un nouveau stade. Les hooligans commençaient à se fondre dans une expérience vécue d’unité de classe, qui mettait ces émeutes par imitation au-dessus de l’aveuglement des hooligans des matchs de foot le samedi après-midi et des bagarres dans les stations balnéaires les jours fériés. Il est vrai que les émeutes ont attiré des jeunes qui pratiquaient ces deux types de bastons, mais il y eut lors des émeutes peu de ces embrouilles sous-culturelles ou de ces délires idiots, notamment racistes, qui accompagnent habituellement le hooliganisme associé aux matchs de foot.
Durant les émeutes, il ne fut voté aucune loi instituant des tribunaux spéciaux. Les cris s’apaisèrent, mais qu’on ne s’y trompe pas, l’idée subsistait. Les tribunaux spéciaux utilisés étaient familiers, c’étaient les mêmes que l’on convoque après un match de foot Celtic contre Rangers, ou après les vacances du mois d’août à Brighton. Mais si des mesures anti-émeutes apparaissent, du même type que la dernière loi anti-émeutes, (ça dépend du degré de la lutte de classe, et non d’actes de violence ponctuels) la délinquance d’après-guerre, si étroitement liée au moment où la classe ouvrière devient importante pour le capitalisme en tant que consommatrice, y sera pour une bonne part.
La dernière grosse agitation sous-culturelle a eu lieu un an avant, le week-end de Pâques 1980. L’émeute de Bristol s’était déroulée quelques jours auparavant, et la grève de la sidérurgie bien qu’en déclin se poursuivait.
Elle a eu certaines particularités qui la distinguent des éruptions de violence des années 1960. En ce qui concerne les looks, c’était le même style, à part les punks, sauf que les dégaines des gens étaient beaucoup plus variées que dans les années 1960. Plus important, cette agitation s’est répandue à travers toute l’Angleterre (Ayr en Ecosse, Great Yarmouth, Cardiff et Bangor au Pays de Galles, aussi bien que Margate et Brighton), dépassant ainsi l’exclusivité du coin sud-est de la Grande- Bretagne (une assemblée mod s’est tenue à Scarborough !):
A l’époque, on pensait que ces événements du week-end étaient de bon augure. Un facteur nouveau était apparu, celui de la mobilité, quand des bandes de jeunes voyageaient d’un lieu agité à un autre.
Bien que les tribunaux aient prononcé de fortes amendes s’élevant jusqu’à 650 Livres, la peine maximum de prison fut de trois mois seulement. Insignifiant, comparé à la rage des tribunaux quinze mois plus tard. Mais entre temps on était passé de la guerre de clans à la guerre de classes, de la graine au fruit.
L’immaturité des conflits de classes est la raison de l’importance démesurée attribuée aux looks. Il est tout à fait certain que les looks des années 1970, looks d’emprunt, reflétaient des réalités de classe, autant que dans les années 1960. Mais le look de nos jours en dit plus sur le tailleur que sur la personne. Un jeune avec des cheveux orange fluorescents, et une figure peinte en blanc avec un large éclair rouge et bleu autour de l’œil droit fut interviewé après les troubles du week-end de Pâques 1980. Il travaillait comme foreur et manieur d’explosifs dans une carrière à Colne, Lancashire, et son idole était David Bowie. Il alla jusqu’à dire : « Les fans de Bowie sont totalement contre la violence. » Dix ans auparavant, il aurait été le portrait tout craché d’un skin.
L’évolution des looks est loin d’être linéaire. Il y eut, au cours des années 1970, ni progrès, ni régression. Contrairement aux années 1960, les looks étaient des produits prêts à consommer et non plus des créations spontanées, et plus d’un rescapé des sixties pouvait à bon droit les trouver tristes et artificiels.· On était bien parti pour assister à une bataille mesquine de costumes. Mais la réalité vécue par la classe opprimée était bien pire que dans la décade précédente. Et quand le grand jour arriva – enfin ! – ce méli-mélo des looks contribua à atténuer la tension entre les clans. Comme le look n’exprimait plus les moindres détails des divisions à l’intérieur du prolétariat, cette obsession ne fut pas une entrave significative aux premières actions de classe des chômeurs.
Le week-end de Pâques 1980, quelqu’un lança un engin explosif parmi la foule rassemblée sur le terrain de Tottenham Hotspurs pendant le match contre Arsenal. C’était un incident écœurant, mais la réprobation moraliste ne peut se substituer à l’analyse. La même main qui a jeté l’engin a pu un an plus tard atteindre le bon objectif.
Bien des supporters de football – pacifiques ou fanatiques – savent depuis un certain temps qu’en gros les hooligans qui fréquentent les matchs de foot n’ont pas grand intérêt pour ce jeu. Ce qui se passe dans les tribunes et en dehors du terrain importe bien plus. Ces supporters en sont choqués, parce que cela montre l’existence d’une crise au sein de ce jeu fortement contrôlé par le capital. Des gens se pointent aux matchs, qui préfèreraient de loin .faire une émeute plutôt que de regarder le jeu.
C’est justement ce type de problème auquel les militaires polonais étaient confrontés quand ils interdirent tous les spectacles sportifs. Ils savaient que les stades se raient utilisés à des fins autres que le sport. La conscience de classe avait atteint, cela va sans dire, un niveau bien plus haut chez les Polonais que chez les hooligans britanniques qui fréquentent les matchs de foot, et il n’y a pas la moindre chance de voir les matchs interdits dans le futur en Grande-Bretagne. (Les interdictions de supporters deviennent cependant plus fréquentes.)
Mais parce que le foot concerne tant de secteurs de cette société britannique déchirée par les luttes, il joue un rôle trop important pour être laissé aux mains du marché privé, comme il l’était auparavant. Il a concentré petit à petit (ou match après match) les initiatives politiques. Dans tous les pays, l’Etat profite régulièrement du délire nationaliste chaque fois que le prolétariat cède au bonheur illusoire de soutenir son pays lors des matchs internationaux (cf. la victoire de l’Argentine dans la Coupe du Monde en 1978 et celle de l’Italie en 1982).
Mais en Grande- Bretagne, parce que le public des matchs de foot est tellement rebelle, les matchs deviennent un terrain d’expérimentation pour les techniques de contrôle des foules, y compris quand il faut se débrouiller rapidement et efficacement contre une émeute. Ce sont aussi des centres d’expérimentation de la répression, combinant des méthodes douces et dures allant jusqu’à dix ans de taule.
Les présidents de clubs de foot doivent maintenant faire face à des problèmes tels que la criminalité et la communauté, et comment éviter une situation qui « transforme les honnêtes gens en hooligans ». Tiens, tiens, ça a un son familier ! Non, ce n’est pas le commissaire libéral Anderson qui cause, mais le président du club de football de Sheffield, dans une lettre au Times (8 septembre 1980). Il y a mieux. Comme un philosophe du XVIIe siècle qui médite sur les principes politiques, il ajoute : « Un bon gouvernement, dans ce pays ou ailleurs, exige du pain et des jeux. » Qu’on le croie ou non, c’est un président de club de foot qui s’inquiète de ce que le maintien de l’Etat repose sur des matchs de foot !
Abolir les flics …
… ou fliquer les abolitionnistes ?
Il est très rare de rencontrer en Grande-Bretagne quelqu’un qui ait une notion claire de la fonction de la police. Ce manque de conscience peut ramener le prolétariat sous le contrôle de la police – même après avoir détruit son pouvoir. Parce que la question du pouvoir de la police est posée de manière intemporelle, métaphysique – la loi et l’ordre -, la spécificité de ce que la police signifie réellement dans une société capitaliste est ignorée.
Par exemple, quand cette question a été posée autour de Merseyside, où les relations avec les flics sont particulièrement tendues, les gens ont répondu qu’ils étaient pour la loi et l’ordre. Envisagée ainsi, la police n’a rien à voir avec le système économique qu’elle est chargée de protéger. Mais quand on questionne les gens sur les pratiques policières dans leurs propres lieux d’habitation, ils les condamnent totalement, une vue généralement partagée par les parents ainsi bien que par les enfants.
Mais pour ceux qui croient encore que le Labour Party, reconstruit ou autre, est là pour abolir la police, débarrassons-nous de ce mythe une fois pour toutes, car il se fait tard et d’effrayantes ombres s’approchent. Le Labour Party est contre la police telle qu’elle est actuellement, mais certainement pas pour l’abolition de la police. Cette revendication est inséparable de l’abolition de l’économie marchande, du travail salarié et de l’Etat, ce que le Labour Party n’acceptera jamais. Il préfère jacter du maintien de l’ordre par les municipalités. Comme le roi des réformistes, Tony Benn, l’a dit : « Dans les régions et les municipalités, la police échappe à tout moyen de contrôle réel par les représentants élus du peuple. » (En fait, le contrôle municipal de la police se ramène au contrôle politique de la police sous un Labour Party Reconstruit.)
Par définition, aucune police n’est socialement neutre : tout ce qui peut changer, c’est l’allégeance à tel ou tel parti au pouvoir. Le parti Tory est traditionnellement le parti de la Loi et l’Ordre et il s’est assuré longtemps avant les élections de 1979 du soutien de la police, en lui promettant d’augmenter les salaires, les primes et le nombre de flics. Mais ce n’est pas simplement une campagne de promesses économiques. Les Tories entreprirent de soutenir inconditionnellement la police, et lui promirent une plus grande protection contre les critiques, renforçant ainsi l’étroitesse d’esprit et la bigoterie de ce corps. (Mais le caractère intouchable de la police s’était déjà renforcé depuis des années sans rencontrer d’opposition.)
La gauche du Labour veut renverser la vapeur, pendant que les Tories s’acharnent à laisser l’appareil de répression centralisé et incontrôlé. Pendant ce temps, ils démantèlent autant que faire se peut le contrôle de l’Etat sur l’économie. Mais si les deux partis sont pour un Etat centralisé, ils ont toutefois des projets différents, auquel il faut ajouter celui de leur nouveau rejeton : l’Alliance libérale-sociale démocrate. La gauche du Labour veut nationaliser, c’est-à-dire centraliser toutes les industries de pointe et les grandes banques, en se déchargeant autant que possible de la tâche d’assurer une légitimité politique, ce qui inclut de transférer la responsabilité du maintien de l’ordre aux municipalités.
Pour l’instant, les Tories ignorent volontairement ces garde-fous indispensables. Maniés convenablement, ils pourraient sauver la Grande-Bretagne d’une révolution sociale. En les méprisant, les Tories vont récolter la tempête.
Les diverses gauches du Labour mettent toute leur énergie à saper le pouvoir du Commissaire de Police Régional et du Préfet de Police de Londres, cherchant à s’opposer au pouvoir du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, qui a réduit à rien les comités de police localement élus. Putain ! Le ciel doit être avec nous pour qu’ils osent faire des choses pareilles !
Juste après Brixton, Ted Knight, le fameux leader du Conseil de Lambeth à Londres, a déclaré qu’il voulait voir dissoutes toutes les forces de police de la capitale, pour qu’elles soient « remplacées par une organisation qui réponde aux besoins de la classe ouvrière ». Voilà qui sonne radical !
Les politiciens du Labour ont la tradition de faire des déclarations révolutionnaires à l’occasion de grands rassemblements prolétariens. Ramsey Mac Donald appela à la constitution de Conseils de soldats et d’ouvriers lors de la révolution russe. Les commentaires de Ted le Rouge sont du même acabit. C’est une réponse qui veut flatter le populo.
Si Ted le Rouge était tout à fait logique, il devrait aussi appeler à la dissolution de l’Etat local. En tant que chef haut placé du Conseil de Lambeth, il est peu probable qu’il le fasse. En fait, de même que les autres conseillers municipaux, il combat pour étendre le pouvoir des municipalités contre l’attaque sans précédent de l’Etat centralisé.
C’est à la lumière de cette tactique qu’il faut piger ses critiques de la police. Ce qu’il veut voir, c’est le retour de la domination du civil sur la police, par le biais de toutes sortes de comités. Comme il a ses propres intérêts gauchistes à défendre, il prévoit des comités de délégués syndicaux, des bureaux du syndicat local, etc., en bref, des corporations ouvriéristes qui entravent le prolétariat dans sa lutte pour sa propre dissolution en tant que classe.
Des personnages aussi rusés que Ted Knight n’hésiteront pas à utiliser les émeutiers comme chair à canon pour arriver à leurs fins. C’est ce qu’a fait lady Smiley à Liverpool, le jour précédent l’immonde mariage royal.
Cette lady Smiley de Toxteth, pair à vie et présidente du comité de police de Merseyside, sembla prête à jouer avec le feu et avec sa carrière : « Les gens de Toxteth, déclare-t-elle, ont raison de se révolter. » D’après les informations de la police, quelques heures après sa déclaration, Il y eut des troubles sur une grande échelle.
C’était l’acte désespéré d’une bourgeoise libérale et non le geste gratuit et unique d’une aristocrate, qui aurait décidé de tout plaquer. Elle a dit clairement dans une interview qu’elle était « tourmentée par les méthodes policières. Mais je ne peux pas en discuter avec notre commissaire de police. C’est le point faible de notre société. »
Bien des choses se sont passées depuis que lady Smiley a fait ces commentaires. Le rapport Scarman a été publié, et oublié, mais ses recommandations ont eu quelques effets. Les contrôles réglementaires par des Comités de police n’ont pas été retenus, mais le grand chic, c’est maintenant une consultation accrue et une espèce de police municipale. Peu après Noël 1981, des patrouilles à pied faisaient leurs rondes à nouveau dans Toxteth ; c’était la première fois qu’elles pénétraient dans le territoire depuis l’été 1981.
Donc lady Smiley n’avait pas tout perdu. Mais pour les gens de Toxteth, elle avait perdu la popularité honteuse dont elle jouissait, parce que tout le monde sait qu’elle a entamé en sous-main une campagne pour protéger Ken Oxford, le chef des flics. Comme l’a dit une autorité policière : « Elle aurait pu avoir sa tête sur un plateau. Elle essaie maintenant de l’aider à se maintenir à son poste. Elle ne veut pas que les voyous pensent qu’ils peuvent être récompensés pour s’être révoltés. »
Dissoudre les brigades spéciales ? Beaucoup de gens l’ont demandé, surtout depuis que l’opération Bas-fonds d’avril 1981 a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase à Brixton, et que tout le monde le sait. Mais à quoi ça sert de demander que ces brigades de la police d’élite, composées d’assassins, cessent leurs activités ? Une grande partie du travail de la police se fait dans le secret le plus impénétrable. De plus, si le Labour autrefois au pouvoir ne peut empêcher aujourd’hui les émeutes, ce ne sont pas les commissaires de police qui vont consulter les petits copains travaillistes avant la mise à mort : « S’il te plait, camarade Président, peut-on les gazer ? »
Les discours libéraux contre les brigades spéciales ne sont que fumisterie servant à faire régner une certaine ambiance : plus le bruit sera fort, plus le futur gouvernement travailliste, s’il voit jamais le jour, se sentira obligé de changer la loi sur la Police de 1964, créant à sa place une police politique plus ouvertement liée au parti.
Avec le Comité de police GLC, une nouveauté en la matière, présidé par Paul Boeteng, avocat noir de la moyenne bourgeoisie, on a tracé les grandes lignes de cette nouvelle police. Boeteng, outre l’ambition de contrôler la police, a des visées politiques. Comme son rusé rival et compagnon d’armes, Rudi Narayan (qui, lorsqu’il tenta de se parachuter à Brixton sur le dos des émeutiers, fit un bide bien mérité), il bande à l’idée de devenir le Premier ministre noir du Labour Party.
A l’encontre des propositions presque fascistes du Commissaire de Police de Manchester, Anderson, ces bureaucrates sont plus attirés par l’exemple du libéral et bien-aimé John Alderson, commissaire du Devon et de Cornouailles. Alderson se retire pour prendre un poste à Cambridge, mais cette retraite peut être temporaire. Ses idées ont reçu une publicité énorme; Scarman et Alderson s’encouragent mutuellement et régulièrement. Le plus grand flic de Cornouailles est bien décidé à transformer à nouveau, par on ne sait quel tour de passe-passe, le flic de base en cette illusion de distinction champêtre et libérale qui paraît jouir d’un si grand prestige en Grande-Bretagne. Quand il eut à vider pacifiquement les contestataires qui occupaient le site d’une future centrale nucléaire, il le fit avec tout le charme d’un gentilhomme campagnard, coiffé d’un chapeau de chasse en tweed à carreaux, un modèle de correction et de politesse. En même temps, Alderson a fait savoir qu’il avait été élevé chez les mineurs du Yorkshire, et il s’imagine avoir été fort influencé par leur égalitarisme. Si sa « révolte », qui s’appuie sur la région, contre la centralisation croissante des forces de l’ordre, veut réussir, elle devra faire appel à autre chose qu’à l’idéologie bobby de village du « small is beautiful ».
Comme le TUC, ils veulent plus de keufs de couleur. En même temps et significativement, ils demandent plus d’instits de couleur pour les quartiers prolos du centre.
Le plus gros défi posé aux philosophes d’une force populaire et locale de maintien de l’ordre (oui, les commissariats du Devon et de Cornouailles emploient maintenant des philosophes – sans blague), c’est d’arrêter la tendance à réprimer aveuglément, tendance qui aboutit rapidement à un refus de la population de collaborer et à une hostilité générale envers les keufs. La police municipale, par une approche sélective, isole le voleur à main armée ou le cambrioleur; elle fait ainsi baisser les risques d’une explosion généralisée qu’implique une répression aveugle. Toutes les possibilités de fuite coupées, soit le délinquant s’amende, soit il se fait happer par la spirale du crime et de la violence, entre des séjours en taule de plus en plus longs.
Le sort des révolutionnaires fixé par cette forme de quadrillage correspond au scénario décrit ci-dessus. La police municipale a reçu le soutien des travailleurs sociaux, des travailleurs municipaux, des avocats radicaux et des gardiens des « libertés civiles », etc., et les critiques vraiment révolutionnaires se sont retrouvées isolées et assaillies par la haine de tous·ces gens-là réunis.
Ce n’est pas aussi délirant que ça en a l’air. La vedette John Alderson a épuré les fiches de la Special Branch dans sa circonscription, à grands renforts de publicité. Ont été jetées à la poubelle les fiches concernant les activistes anti-apartheid, les adversaires des sports violents, les excentriques et les indésirables politiques qui avaient des désaccords avec Benn. Bien joué, parce que ce qui reste, c’est le noyau dur, englobant les ennemis les plus consistants de l’Etat et du capitalisme. Non seulement l’Etat sait qui sont ses vrais ennemis, mais ça lui évite de perdre du temps à noter les noms et les détails sur quiconque s’est fait choper à lever le petit doigt.
Actuellement, la Spécial Branch lance ses filets si loin et si profond que seuls quelques petits poissons sont assez chanceux pour en réchapper. Mais passer ainsi au crible une population entière peut aussi rapporter beaucoup plus d’ennuis que de résultats : entre autres banaliser son importance comme technique policière et provoquer chez les gens une saine antipathie pour la police.
Un autre point : l’effet insidieux de la sectorisation du maintien de l’ordre est de faire intérioriser la violence des relations sociales capitalistes. S’accorder la moindre liberté d’exprimer réellement la violence devient une folie. Dans certaines municipalités, la police rend le désespoir social encore plus horrible en permettant qu’on décore avec des fleurs nos prisons insupportables. Aidez donc les gentils flics îlotiers de votre quartier. Auto-tabassez- vous !
Handsworth
Handsworth, à Birmingham, un quartier à population en majorité noire et asiatique, est l’endroit où la politique de sectorisation du maintien de l’ordre a fait jusqu’ici le plus de progrès. Au début des années 1970, le commissariat était régulièrement assiégé et n’eût été le traitement expérimental de pacification pratiqué ces temps-ci, l’explosion aurait égalé celle de Liverpool. Le commissaire David Webb, tout comme Alderson, quitte maintenant son poste, désabusé par l’étroitesse d’esprit de la police, pour devenir le député du coin (sans doute Libéral/SDP). Le jour où Toxteth flambait, un festival était organisé à Handsworth, qui a accueilli 8000 personnes. Selon le reporter du Times (1er juillet 1981), « l’état d’esprit était aussi aimable et paisible qu’à une fête de village ». Ce festival était organisé conjointement par la police et les groupements municipaux, son président n’était autre que le directeur de la taule locale. Ces festivals appelés Racines font partie de l’attirail de conciliations inséparable d’une politique de quadrillage policier « soft » et beaucoup de musiciens locaux et de reggae boycottèrent ce festival. Pourtant, cinq jours après, Handsworth explosait, et le commissariat de police était assiégé. Bien que les kids aient voulu la tête de David Webb, le débordement manquait de la férocité de Toxteth ou de Moss Side.
Un maintien de l’ordre souple et géré localement, tel est le mot d’ordre à la mode en ce moment. C’est le must de tout discours politique. Panacée facile pour tous les troubles quels qu’ils soient, elle ne sera qu’une force d’appoint marginale aux méthodes fortes. Quand il y a des émeutes, elle n’est d’aucun secours. Six mois après la première éruption d’émeutes, des brigades anti-émeutes style européennes, équipées de gaz CS et de balles en plastique, fortes de 11000 hommes, ont été formées à partir des unités policières constituées initialement pour s’occuper de la défense civile en temps de guerre. Peu importe dans quelle mesure elles emprunteront à l’expérience de l’Amérique où à la réforme de Mitterrand en France, ce ne sera que lorsque les choses iront mieux que Dixon, le corbeau paraplégique de Dock Green, sera de nouveau exhibé.
Tortures et châteaux de sable
Une combinaison des deux méthodes, la douce et la forte, est même envisageable, si l’on se fonde sur la nomination de Sir Kenneth Newman au poste de Préfet de Police de la ville de Londres. Ce cocktail peu ragoûtant fut expérimenté en Irlande du Nord, quand Newman, à la tête de la RUC (Royal Ulster Constabulary, la Gendarmerie de 1’Irlande du Nord) réorganisa ses troupes pour en faire la force policière la mieux équipée et la plus sophistiquée de toute la Grande-Bretagne. A la même époque, il présidait le célèbre centre d’interrogatoires de Castlereagh, où les gens suspectés de terrorisme étaient torturés. Pour décompresser un peu entre ces scènes de barbarie médiévale, il a monté aussi des discothèques, fréquentées par des dizaines de milliers de gamins catholiques et protestants, et la crème des flics, entraînés à l’action sociale, sortaient les enfants des taudis et les emmenaient en ballade au bord de la mer.
Cela montre finalement à quel point l’Irlande a été un terrain d’expérimentation. Newman l’admit également, quand il prit le commandement du RUC. « J’avais tout à fait présent à l’esprit que les forces de police britanniques pourraient bien être confrontées à des problèmes similaires dans les années à venir. » Newman a commodément réduit le problème à celui du maintien de l’ordre des minorités, et il n’a évidement pas saisi l’importance de la question de classe en Grande-Bretagne. Il fut consterné que la RUC n’ait pas pu assurer l’ordre lors de la grève des travailleurs de l’Ulster de 1974, et les leçons qu’il a apprises en Irlande du Nord pourraient bien n’être d’aucun secours en Angleterre. Encore que les méthodes développées en Irlande du Nord aient été utilisées lors du premier grave incident en ·1982, à Notting Hill Gate, Londres. Il sembla pendant dix petites minutes que les flics avaient reculé et s’étaient retirés, étouffant par l’ennui le coup de colère momentanée. Puis, un groupe puissant et compact donna soudainement l’assaut : c’était le premier engagement réel des Unités de réponse immédiate, d’après le modèle d’unités semblables en Irlande du Nord. En quelques minutes, tout était nettoyé.
Cependant, au cours de l’été 1981, les autorités n’étaient pas prêtes à mettre au rencart les techniques typiquement britanniques de maintien de l’ordre, ou plutôt ce qu’il en restait. Le sous-préfet Pat Kavanagh a déclaré dans le New Standard du 20 juillet 1981 : « Il C’est le public et la presse qui nous ont acculés en exigeant des canons à eau, et des meilleurs boucliers », et Mac Neel, le préfet de police de Londres de cette époque, a déclaré qu’il était opposé à une police anti-émeutes de style français. La tâche la plus lourde fut laissée, peut-être inévitablement, au président de la Fédération de Police (syndicat des flics), Jim Jardine, qui engloutit 30000 Livres dans une campagne pour le rétablissement de la peine de mort. Mais si l’on excepte le meurtre de David Mower (écrasé à plusieurs reprises par une Land Rover de la police) à Liverpool, les deux parties mirent des limites à la violence. Il était admis que les keufs et les émeutiers pouvaient se défoncer mutuellement le crâne et s’incendier. Mais quand il s’est agi de tuer, un respect civique bien enraciné de la vie humaine était imperceptiblement présent dans l’air brûlant des rues.
Des flics hilares ?
Pendant la semaine d’émeutes, les flics étaient tendus à l’extrême. Lors de la première nuit d’émeutes à Moss Side, le Commissaire de Police de Manchester n’a pas choisi la répression mesurée et discrète, comme il s’en est vanté ; il n’y avait tout simplement pas assez de flics pour s’occuper des émeutiers, parce que beaucoup d’entre eux avaient été appelés à la bataille de Liverpool. Sir Robert Mark a dû l’admettre : « Pour presque toutes les forces de police, plusieurs heures se passent avant qu’une force de réserve puisse se rassembler et s’occuper d’une urgence imprévue. » (The Observer, 12 juillet 1981).
Bien que le mouvement d’émeutes se soit épuisé en dix jours, à la fin de ceux-ci les flics étaient vannés. Constamment de service ou pouvant être rappelés immédiatement, beaucoup s’effondraient en larmes, à cause de la tension, et certains s’endormaient même sur leurs boucliers anti-émeutes. On devra s’en rappeler à l’avenir, pour accroître la démoralisation. On dit par exemple que les changements de personnel sont plus nombreux dans la police que dans n’importe quelle autre profession, pour cause de dépression nerveuse. Sûrement parce que les flics sont constamment utilisés dans les manifs, contre les piquets de grèves ou les piquets volants; cela atteint profondément ceux chez qui il reste encore quelques embryons d’humanité. En fait, pendant les émeutes, la tension commença à régner chez les keufs. Pendant que les inspecteurs et les commissaires se planquaient dans leurs abris rupins, les flics de base, couchés par terre étaient la cible d’un tir ininterrompu.
Pour garder le moral malgré tout, les flics de Liverpool en plaisantaient. Un flic avait craqué, et prenant la fuite, s’était effondré contre une porte. « Debout, mon gaillard », dit une voix. « Désolé, sergent, répliqua-il, je n’en pouvais plus. » « Vous voulez dire inspecteur », lui fut-il répondu. La silhouette accroupie leva les yeux : « Merde alors, je savais pas que j’avais couru si loin en arrière ! »
C’est la première fois que le traditionnel keuf britannique à la gueule bovine et rougeaude a été contraint de plaisanter ainsi, à ses propres dépens.
L’embrasement
Les émeutiers provoquèrent la chute de la Livre, ce que seuls certains mouvements ouvriers puissants ont réussi à faire. Mais il n’y eut pas d’exemples d’émeutiers appelant les travailleurs à se joindre directement à eux, et à se servir de l’arme de la grève. Le joint doit se faire d’une manière ou d’une autre, et travailleurs et chômeurs doivent se préparer à se rencontrer devant une bonne bière, une boîte d’allumettes ou une bétonnière. Quoique les émeutes fussent plus destructrices et plus étendues que Mai 68 en France, elles manquaient de la clarté des émeutiers français, et une fois les fumées dissipées, il n’y eut pas d’usines occupées.
Les nuits d’émeutes ont nettement offert la possibilité de s’unir, surtout dans les villes du nord. Les émeutes se déroulèrent à proximité des zones industrielles de villes telles que Manchester et Hull. Moss Side n’est pas loin de la zone industrielle de Trafford Park, saignée à mort, mais qui n’en demeure pas moins la plus importante d’Europe, et, tactiquement, il aurait peut-être été préférable d’aller là-bas, plutôt que de proposer le pillage du centre Arndale, situé dans le centre de Manchester.
A Leeds, on aurait pu repousser une police fatiguée à plus d’un mile des vieux ossements industriels et du vieux tracé séparant le centre ville de Chapeltown. Mais Leeds est la capitale économique et financière de la région, et même pendant les années 1930, elle a été préservée des taux de chômage catastrophiques que connaissaient ses environs. Il est donc peu probable que les émeutiers eussent été bien accueillis. (Soit dit en passant, un sex shop fut incendiée à Chapeltown, et des poupées gonflables en flammes planaient dans l’air chaud de la nuit. Et ce n’était pas du féminisme : beaucoup d’autres marchandises reçurent le même traitement.)
Dans le Sud, l’agitation dans les villes telles que High Wycombe et les cités de Medway (Kent) ne fut pas assez forte pour provoquer un effet immédiat sur les travailleurs de l’industrie. Et Londres est si vaste, si disparate et si différente de toutes les autres villes anglaises, que toute comparaison est ici sans signification.
LIVERPOOL 8-LES FLICS 0
Si la poulaille de Londres était pétrifiée, à Liverpool, les keufs reçurent la raclée de leur vie. Les frictions avec les flics ne sont pas une chose nouvelle à Liverpool. Il y a vingt ans, on disait déjà que la police se comportait comme une armée d’occupation. On disait que les pires flics étaient ceux de Belfast, Birmingham et Liverpool.
Les keufs appellent traditionnellement les jeunes de Liverpool les bucks. Le terme ne se réfère pas nécessairement à quelqu’un qui a une réputation de violence. C’est un terme ordinaire. Dans son sens le plus large, ça évoque l’accent, l’habillement et le mode de vie en général. C’est un terme de pur mépris de classe, utilisé par des gens issus de l’élite de la classe ouvrière ou de la petite bourgeoisie, d’où sont habituellement recrutés les flics. Ce sont les gens les plus prompts à se dissocier des éléments prétendument douteux de la classe ouvrière. Ceci justifiant que la chasse soit toujours ouverte contre eux.
Cela pour les jeunes Blancs, mais les Noirs sont traités avec un mépris encore plus grand. Ici, le racisme est une composante du mépris de classe. A cause du haut taux de petite délinquance à Liverpool 8, la police considère tous les jeunes comme des criminels, et parce qu’elle les considère comme une sous-humanité, toutes sortes de brutalités et de tracasseries sont permises. Comme l’a dit un gamin : « Nous les haïssons et ils nous haïssent, c’est aussi simple que ça. »
Les conditions de vie à Liverpool, le triangle des Bermudes du capitalisme britannique, et la nature particulière de la police de Liverpool ont produit la violence urbaine la plus exacerbée sur le continent britannique depuis le XVIIIe siècle.
Beaucoup de jeunes qui ont participé aux émeutes ont aussi dévalisé n’importe quel vieux docker à la retraite, sa poche pleine des biffetons de la paie du jeudi soir. Cela ne sert à rien de prétendre le contraire. Il est bon d’attaquer n’importe quel commerce, mais malheureusement les gens vivant au-dessus des magasins de Lodge Lane furent aussi incendiés. Ils méritaient mieux. Cependant, ni à Liverpool, ni à Brixton, les gens sinistrés ne montrèrent la moindre animosité envers les émeutiers. Ils sentaient intuitivement que les émeutiers attisaient simplement le feu. Un membre du Comité de défense de Liverpool 8 accusa le commissaire Ken Oxford d’incompétence pour n’avoir pas su tenir ses troupes en main et empêcher « l’incendie de notre Lodge Lane ». Nous avons l’impression que cette personne avait joliment honte de ce qui s’était passé là -bas, et n’osait pas se mouiller en blâmant les émeutiers.
Le Guardian n’a eu que des critiques négatives. Il a déploré un manque de conscience de classe, qui, si elle était arrivée à pleine maturité, aurait piétiné ce torchon. « La chose la plus triste, c’est que les victimes de ces destructions, qui regardaient la scène en calculant combien ça allait leur coûter, étaient de simples citoyens du quartier. Bien que quelques grands magasins aient été attaqués, la plupart des magasins détruits ou pillés étaient ceux de gens habitant cet endroit, et luttant pour gagner leur vie. Si les émeutes avaient eu un caractère politique, on aurait pu attendre une attaque plus directe des symboles du capitalisme. Le capitalisme a détruit l’ordre social dans les centres-villes, mais aucune identité de classe n’en a émergé. »
Le Guardian est un canard suffisamment réactionnaire et bête, et contrairement à ce qu’il dit, certains objectifs ont été soigneusement sélectionnés, et pour de bonnes raisons. Le Raquet’s Club fut incendié parce que, comme l’a dit un jeune Noir, « mon père avait coutume de me dire que c’était là que les juges allaient bouffer après avoir envoyé les Noirs en taule. C’est un hôtel pour les gens qui ont la mainmise sur Liverpool. » Un magasin d’antiquités appartenant à Swainback fut incendié; c’est un ancien conseiller municipal Tory, qui avait fait preuve d’hostilité envers les jeunes Noirs du coin. Un jeune, interviewé pendant l’émeute, déclara qu’il n’y avait aucune raison d’avoir peur. « Nous ne nous attaquons pas aux maisons des gens », expliqua-t-il. « Et ce garage au coin alors, il y a bien des gens qui y travaillent ? », demanda le journaleux. « Oui, mais les proprios, c’est pas eux, c’est la Shell », répondit l’émeutier.
A Liverpool 8, les liens familiaux sont solides. « Me mam » (ma maman) est un personnage très aimé et respecté. Un journaliste du Daily Star a rapporté qu’un jeune qui était en. train de lancer des briques s’arrêta pour demander l’heure: « Eh ! Je dois être bientôt rentrer, ma mère va me tuer si je suis en retard ! Les parents tendent aus si à être solidaires de leurs gosses, quoi qu’ils fassent. Un reportage du Sunday Times fait à Kirkby il y a quelques années parle d’un jeune qui avait été arrêté plusieurs fois pour vandalisme. Quand il lui fut demandé ce que ses parents pensaient de tout ça, il haussa simplement les épaules en disant : « Ma mère m’aime. »
L’un d’entre nous a causé avec une femme d’âge moyen à Sefton Park, au début de la marche contre Oxford. Elle n’allait pas à la marche, mais disait : « J’ai une fille qui est terriblement militante. Je lui ai apporté son gilet au cas où il ferait froid. » Un bon exemple de la désintégration de la famille tant redoutée des Tories, si jamais il y en a une. Ces quelques lignes ne sont pas une défense de la famille. C’est simplement qu’à Liverpool 8 la famille ne se conforme pas aux idéaux respectables de la moyenne bourgeoisie défendus par Jill Knight, député Tory de Edgbaston, qui était tellement retournée pendant les émeutes qu’elle déclara : « La famille a été affaiblie, rabaissée et bafouée par la permissivité à la mode, mais c’est la pierre de touche sur laquelle repose la force d’une nation. Dans une bonne famille aimante, l’enfant apprend la générosité et le respect de la propriété d’autrui; il aime ses parents, veut les rendre fiers de lui, et évite tout comportement qui pourrait causer de la peine ou du tort. »
Par delà les désaccords et les séparations, règne à Liverpool un humour irrépressible qui a pimenté toutes les révoltes prolétariennes qui s’y sont déroulées. Après les émeutes, un keuf arrêta et fouilla un gamin. Il trouva une brique dans sa poche. Le gamin expliqua : « Ce n’est pas une brique, m’sieur l’agent, c’est un acompte pour me payer une télé ! » Cette réplique, née dans l’émeute de Liverpool, trouva rapidement sa place parmi les blagues fameuses de l’Angleterre du nord, et échoua dans un documentaire télévisé plutôt sentimental d’ Alan Bleasdale sur Liverpool, quelques mois plus tard. Coupée de son contexte, l’anecdote était, il est vrai, utilisée surtout pour rehausser l’image de marque de Bleasdale, un auteur dramatique roublard et dans le vent.
Une assemblée souveraine à Merseyside ?
Ce qui s’est passé à Liverpool, durant les premières heures du lundi 4 juillet, est sans doute la plus grande occasion manquée de toute l’histoire de la Grande- Bretagne industrialisée. Il était clair que la police perdait la bataille. Les émeutiers se dirigeaient vers les principales artères de Liverpool: Lime Street, Pierhead, le tunnel de Mersey, fréquentées par des milliers et des milliers de travailleurs. Si les flics terrorisés pour leur vie n’avaient pas lancé des gaz CS, à l’aube les émeutiers auraient sans doute établi un premier contact avec les travailleurs de la première équipe. Il existe une camaraderie entre chômeurs et travailleurs bien plus grande à Liverpool que dans n’importe quelle autre ville anglaise, et l’apport supplémentaire et explosif d’un réveil de la classe ouvrière aurait rendu le mouvement quasi irrésistible. Etre ensuite allé piller, même bras dessus, bras dessous, le centre commercial du Vieux Marché Saint-John, aurait été un simple passe-temps. Avec la police visiblement battue et désarmée, toute la ville aurait été entre leurs mains. Un Conseil local unique dans l’histoire des Conseils aurait bien pu voir le jour. Cette assemblée publique aurait certainement abordé des questions telles que la dissolution de la famille, le droit des gamins et des tout petits enfants à l’autodétermination, le refus et l’inutilité du travail salarié – toutes conclusions qui furent à peine ébauchées dans l’expérience antérieure des Conseils. Si l’on considère l’effet dynamique de l’émeute de Liverpool sur toute l’Angleterre, cet exemple aurait facilement pu être suivi ailleurs. Le jour où ça (ou quelque chose de similaire) arrivera, la révolte deviendra révolution.
Pendant les émeutes, il y a eu des exemples limités d’intervention des travailleurs aux côtés des émeutiers. Les pompiers de Liverpool refusèrent d’intervenir « contre la communauté » et d’autoriser les flics à se servir de leurs tuyaux. Comme tous les pompiers qui intervinrent lors des émeutes, ils avaient été lapidés par des émeutiers. Le fait qu’ils aient refusé, malgré de très fortes provocations, de collaborer avec les flics en dit assez sur leur conscience de classe. Même au cœur de l’émeute la plus violente, à Upper Parliament Street, des émeutiers parlementèrent avec des ambulanciers et firent une trêve avec la police pour permettre l’évacuation des vieux de l’hospice Princess Park, qui se trouvait à côté du Racquet’s Club en flammes. (Plus tard, on découvrit que les casiers de plusieurs vieux avaient été dévalisés.) Cet incident inexcusable et pathétique a eu lieu dans une émeute par ailleurs exemplaire, et c’est un rappel attristant de combien certaines personnes peuvent être soumises au poids mortel de la vie quotidienne dominée par le capitalisme.
Dans les mois précédant juillet 1981, les grèves à Liverpool avaient connu un déclin inhabituel. Ainsi les dockers y auraient repris le travail ce lundi matin, après les 24 heures de grève rituelle au sujet de l’équipement. Les entrepôts adjacents à Toxteth où ils bossaient autrefois sont maintenant déserts, en attendant leu r reconversion en un musée, un centre de loisirs ou de luxueux appartements (…). La majorité des dockers travaillent maintenant au port de containers de Seaforth, en aval de l’estuaire de la Mersey, mais ils se rencontrent toujours au stade, dans le centre-ville.
Plus tard dans la semaine, Thatcher eut le culot de rejeter la responsabilité du taux élevé de chômage à Liverpool sur la classe ouvrière locale, accusée de faire fuir les capitaux par sa combativité. Cette dame cherche l’émeute. Mais pour la seconde fois en une semaine, les ouvriers de Liverpool n’ont pas eu la réponse adéquate, même s’ils savent parfaitement que le capitalisme a décidé de liquider Merseyside.
Quand les pacifistes deviennent des hommes de loi
Dans la nuit de lundi, les travailleurs sociaux achevèrent ce que les gaz CS avaient commencé la nuit précédente. Le Conseil des relations communautaires de la Mersey fit le tour des zones d’émeutes en camions, avec des haut-parleurs prêtés par les flics, pour appeler les gens à rentrer chez eux. Chez eux pour quoi faire ? Au mieux la télé, un joint, quelques cannettes de bière, au pire le désespoir, les tranquillisants et le lit qui engourdit sans fin. Cette farce des relations communautaires était aussi bidon que l’appel unitaire des Eglises de Liverpool. Il n’est pas surprenant que l’Eglise considère le travail social comme de son ressort, puisque ce dernier est né historiquement de l’échange des aumônes contre des pénitences. Quand à l’évêque anglican de Liverpool, le révérend D. Sheppard, ce libéral compréhensif, ex-joueur de l’équipe nationale de cricket, il ferait bien de réfléchir à la supériorité écrasante des émeutiers à ce sport, à Brixton plus tard dans la semaine, quand ils utilisèrent des battes de cricket pi liées dans les magasins de sport pour se battre contre les matraques des flics.
Combattants de rue…
Les émeutiers se sont très bien organisés. En l’espace de quelques heures, ils devinrent d’habiles stratèges et combattants de rue, inventant de nouvelles tactiques au fur et à mesure. A Liverpool, ils répandirent de l’huile sur la route entre les barricades, qui pouvaient être arrosées d’essence et incendiées une fois que la police avait pris la première. En même temps, des gens confectionnaient des cocktails à l’arrière des camions pendant qu’ils faisaient le tour de la ville. A Nottingham, l’inspecteur Colin Sheppard a dit, avec une terreur mêlée de respect : « Il n’y avait pas de limites à l’imagination des émeutiers qui passaient leur rancune sur la police. »Waily Telegraph, 14 juillet 1981. Et il ajouta : « Ce furent les jours les plus noirs de Nottingham. »
… plus radio et CB
L’usage de la radio, comme moyen de guérilla, a été une caractéristique nouvelle des soulèvements de ces quelques dernières années, en particulier en Italie en 1977 et en Grande-Bretagne en 1981. Dans les deux cas, la diffusion radio (en Italie) et les intercommunications de CB (en Grande-Bretagne) retrouvèrent une fonction cohérente au moment de la révolte. L’agitation dans la rue balaya la soupe inconsistante qui passe habituellement par ces supports.
Radio Alice à Bologne, cette radio mao-dadaïste, faisait un certain nombre d’enregistrements culturels « subversifs », mêlant la musique, la poésie et des commentaires entre les coups de fil d’auditeurs. C’est un fait bien connu que les stations radio passent des tubes aux heures de pointe pour harponner les auditeurs. Mais à Bologne, pendant les évènements, Radio Alice laissa de côté les merdes culturelles (un mélange de commedia dell’arte, de parallèles artistiques tirés de la Révolution Russe et d’illusions sur les musiciens pops multi-millionnaires), et informa les insurgés des manœuvres policières.
Techniquement, la CB permet plus de « démocratie ». C’est aussi bien un émetteur qu’un récepteur. En revanche pour les programmes radios, il y a un plus grand contrôle de la rédaction. Un coup de bouton, et la personne qui émet est coupée au milieu de sa phrase. Et il est impossible de solliciter de suite l’opinion des auditeurs sur un problème.
L’utilisation des CB pendant les émeutes est aussi à relier à la mobilité des émeutiers. Ils se déplaçaient depuis des kilomètres jusqu’aux lieux chauds des émeutes, utilisant même des voitures de fonction de diverses sociétés. A Londres, des émetteurs fabriqués maison, ce qui ne requiert que des connaissances moyennes en électronique, interrompirent Radio Capital et LBC par ce genre de messages : « Attention ! Il va y avoir une émeute à Kings Road. » Comme l’a dit un porte-parole de l’Autorité de la radiodiffusion indépendante : « On ne peut absolument rien faire contre. »
Ce type d’actions semble offrir des possibilités infinies. Telles que brouiller des émissions avec du matériel émettant depuis l’arrière de camions en marche, ce qui rend la tâche doublement difficile aux espions du ministère de l’Intérieur.
Ce démantèlement du monopole étatique des ondes a toutefois ses inconvénients. Si avoir une CB est à la portée de n’importe qui, qu’est-ce qui empêcherait les flics et autres autorités de capter et de comprendre aussi bien que tout un chacun le jargon CB ? A cause des émeutes et des nombreux incidents qui s’y rapportent, la police doit maintenant en apprendre le langage. C’est pourquoi les modes d’emploi CB vont à l’encontre de leurs propres intentions; la CB doit évoluer constamment, si elle veut conserver son potentiel subversif. Mais être toujours en avance d’une longueur peut entraîner la privatisation totale du langage. Dans ce cas, les extrêmes se rencontrent, car la CB est rapidement devenue l’art d’échanger « en toute sécurité » des codes secrets. Comme le dit un inconditionnel, « si je parle à quelqu’un avec la CB et qu’il utilise des mots d’argot que je ne connais pas, il pourrait aussi bien causer en serbo-croate » (lettre à un magazine CB 1)
Pour aller à l’encontre de cette tendance, il pourrait être important de constituer des réseaux d’amis proches qui seraient prévenus des changements de vocabulaire. Dans une cité du conseil de Warwickshire, récemment, un collecteur de loyers n’a pas réussi à rentrer dans les appartements où on lui devait des loyers en retard. Des CB avaient été installées dans les apparts pour prévenir les locataires de sa venue. Maintenant le collecteur de loyer a sa propre CB, (quelqu’un a bavé), et peut ainsi capter les locataires qui préviennent leurs collègues. La prochaine fois, il ne se fera pas avoir si facilement. Mais il est possible de passer outre. En inventant un code secret connu des seuls locataires de confiance, le collecteur des loyers serait éjecté de la scène.
Les CB sont légalisées maintenant. Mais il y en a plus de 250000 illégales en Grande-Bretagne, émettant sur des ondes prohibées. Le gouvernement les a interdites, prétendant qu’elles bloquaient des messages vitaux comme ceux permettant aux ambulances de circuler convenablement. Cela a pu se passer à l’occase, mais le contraire est vrai aussi: il arrive que les CB illégales fassent venir les secours plus vite.
Mais derrière ce souci du « bien public », il y avait la crainte réelle que des fanas de CB bloquent la radio des flics. Cela s’est passé à Hull récemment, quand les flics ne purent alerter les pompiers pour éteindre l’incendie qui avait pris dans une usine. Leur radio avait été bloquée par un saboteur qui s’est lui -même appelé « Yankee Bucket Mouth ». On découvrit plus tard que l’incendie était d’origine criminelle. Yankee Bucket Mouth ? La police n’en est pas sûre, mais il ferait mieux de se déconnecter vite fait !
Il y a beaucoup de choses nouvelles sous le soleil, mais le jargon CB, utilisé à des fins subversives, a renoué à Londres avec une tradition bien plus ancienne ; il a ressaisi l’essence oubliée du cockney, cet argot à rimes. Pendant les terribles émeutes de Londres aux XVIe siècle et XVIIe siècle, le gouvernement envoyait des espions dans les quartiers pauvres. Les cockneys, qui avaient l’esprit vif, improvisèrent un langage parallèle, qu’ils remaniaient constamment, pour éviter les oreilles indiscrètes.
Tout est calme sur le front ?
Un calme précaire règne dans les rues. La presse annonce que seules des petites bagarres continuent dans les zones où il y a eu les plus grosses émeutes. Il s’agit de bien plus que ça. Les centres-villes bouillonnent de révolte. En dépit de tous les baratins sur la sectorisation du maintien de l’ordre, et des comités de liaison, la présence des flics est plus lourde que jamais et ressemble à une armée d’occupation. Les sirènes hurlent continuellement, les projecteurs s’allument, et des voitures passent à toute vitesse, pendant que dans une allée sombre un car de flics attend, menaçant. Une autre explosion urbaine, qui pourrait prendre plusieurs formes, est-elle en perspective ? Une chose est sûre, les flics ne se laisseront plus prendre par surprise comme lors des émeutes de l’été 1981. Au moindre signe de danger, une police mieux entraînée, pourvue de tout l’équipement anti-émeute nécessaire, se remue immédiatement le cul pour établir un cordon autour du lieu de troubles potentiel.
Chut ! Il y a une émeute !
La police tient secrets ses déboires. Une antenne de police a été assiégée fin mars 1982 à Bedford, à trente miles au nord de Londres, mais la police a censuré toute information sur cet événement pendant plusieurs semaines. Pour autant que nous le sachions, il n’y a pas eu de troubles à Bedford en 1981. La même chose est arrivée à deux reprises à Notting Hill à Londres, une fois vers Noël, l’autre fois début avril. Mais quand la troisième fois il y eut des barricades dans plusieurs rues, l’incident était trop gros pour être passé sous silence, et fut immédiatement rapporté le jour suivant à la radio et dans la presse.
Mais l’agence de presse de Scotland Yard l’a bouclée pendant longtemps. A moins que les médias n’aient pas voulu savoir ou pas voulu que cela se sache, préférant déverser leurs habituelles et lénifiantes bonnes nouvelles. On vient juste de lire dans la presse (avril 1982) que des cocktails ont été lancés dans les vallées minières du Pays de Galles pendant la semaine d’émeutes. Et cette info étonnante a été tenue secrète pendant tout ce temps ! C’est dire combien la Grande-Bretagne est proche de la révolution.
Mais y aura-t-il un Toxteth des usines dans un futur proche, qui consumera toutes les horreurs du capitalisme ? Les ouvriers ont pris bonne note des émeutes, les incorporant à leur propre lutte. Pendant une récente occupation de la fonderie d’aluminium à lnvergordon dans les Highlands en Ecosse, un travailleur licencié interrompit soudain une émission de télé pour dire que Brixton et Toxteth avaient montré le chemin. Le terrain des ouvriers est cependant miné du début jusqu’à la fin par les syndicats, toujours prêts à ramener les travailleurs en rupture à la table de négociations et au siècle dernier. La plupart de ceux qui vivent dans les centres-villes n’en sont pas encombrés et peuvent donc s’en prendre directement à la gorge du capital, sans se faire racketter le long du chemin par ces représentants de merde.
Les prolétaires qui ont un emploi doivent répondre à la nouvelle situation créée par les émeutes. La classe ouvrière de Liverpool a été la première à le reconnaître et en bloc. Mais avant que les travailleurs puissent commencer à se battre de façon radicale, ils doivent balayer les syndicats et toutes leurs procédures formelles, et cela une fois pour toutes. Au cours des dernières années, à des moments vraiment cruciaux, les travailleurs ont laissé le contrôle de la lutte aux conférences de délégués syndicaux, généralement à travers les shop stewards (délégués d’atelier). Psychologiquement, ils n’étaient pas prêts à agir dans ces occasions en or. Cette rage qui n’a pas trouvé à se réaliser se transforme, quelques jours plus tard, en un désespoir muet et refoulé.
Pendant la grève de l’acier du printemps 1980, des ouvriers de la sidérurgie, dans le sud du Pays de Galles, au lieu d’aller directement aux puits de charbon pour étendre la grève, renvoyèrent leur action à une date ultérieure, quand elle serait ratifiée par une réunion du syndicat local. Et une semaine plus tard, ça équivaut à un siècle. La tension se dissipa et la solidarité s’évanouit. Les mineurs – contre l’avis du NUM gallois (1) – ne se mirent pas en grève comme prévu. Un appel passionné des ouvriers de la sidérurgie en grève aux mineurs aurait pu sauver la situation. Découragés, les dockers levèrent leur boycott des importations de charbon, ne voulant pas faire les frais d’une défaite prévisible.
Le match de rugby Angleterre-Pays de Galles, qui eut lieu à Twickenham peu de temps après, montra un exemple révélateur de ce gâchis. Les commentateurs et les spectateurs en parlent comme du match de loin le plus brutal qu’ils aient jamais vu, avec de nombreux blessés, même dès la première minute.
De nouveau, à British Leyland fin octobre 1981, l’initiative fut perdue, dans ce qui promettait d’être la grève la plus importante depuis des années. Cette grève allait bien au-delà d’un conflit du travail ordinaire. Le directeur de British Leyland, Michael Edwardes, par exemple, aurait bien pu exécuter sa menace de liquider l’usine. Et la pression était à son comble dans les ateliers.
Le management a sa crise
La crise du management a entraîné des changements draconiens dans les méthodes de direction, quand les dernières traces de fair-play formel qui pacifiaient les relations du travail furent balayées. (Cette modernisation aurait peut-être eu besoin d’un Sud-Africain impitoyable, le patronat britannique a été sensiblement plus lent à s’adapter). Comme l’a dit un ouvrier de Leyland : « Appelle ça le besoin de garder notre dignité si ça te chante, mais nous pensons que nos vrais droits d’hommes libres sont maintenant en jeu à British Leyland. »
L’insensibilité manifeste du patronat et sa politique arrogante du « c’est à prendre ou à laisser », qui avaient connu un tel succès lors des trois derniers accords salariaux lui sont retombées sur la gueule, c’est normal. Quand les contremaîtres arpentaient les chaînes à Longbridge, en menaçant de virer ceux qui ne pointeraient pas le jour suivant, il y eut une grève massive. John Barker, le chef du syndicat des transports à Birmingham, a admis que les permanents syndicaux avaient dû utiliser la contrainte pour empêcher les ouvriers de quitter leur boulot sur le champ.
Cet incident s’est passé environ deux semaines après que le chef du personnel a envoyé une lettre cynique aux ouvriers, menaçant de virer quiconque se mettrait en grève. Mais comme toujours quand il est menacé d’une catastrophe imminente, le dernier rempart du capital, ce sont les foutus syndicats, qui purent retenir suffisamment les ouvriers pour que la direction reprenne l’initiative. Après le délai de trois semaines fixé par les syndicats, la direction de Longbridge accorda une augmentation record des primes pour séparer Longbridge des autres usines plus petites dispersées dans toute la Grande- Bretagne.
Héraclite a écrit : « Ceux qui rampent sont gouvernés par les coups. » Après que les ouvriers de British Leyland ont accepté, fin octobre 1981, une augmentation de salaires payée à coups de lance-pierres, une opération militaire du style Service Spécial des Airs (SAS) fut immédiatement montée contre les travailleurs de Lawrence Scott à Manchester. Des hélicoptères survolèrent les piquets de grève pour rassembler le matériel destiné aux abris de sous-marins Polaris. Les flics avaient été prévenus. Coincés à l’extérieur des portes, les piquets de grève ne purent que regarder les hommes de main des SAS fouiller l’usine. Et la Grande- Bretagne a gravi un degré supplémentaire vers une vulgaire dictature bananière. Immédiatement après les émeutes de Moss Side, quand les cendres fumaient encore, les travailleurs occupant l’usine furent vidés par des huissiers armés de manches de pioche et de marteaux. Qui ose n’est pas toujours gagnant, car s’ils avaient fait ce coup de main contre les habitants de Moss Side, la réaction aurait été rapide et terrible. La réponse des travailleurs qui ont un boulot peut être terrible, mais ils doivent encore surmonter leur manque de punch actuel. Leur pouvoir de destruction ne réside que dans leur mémoire menacée.
Lawrence Scott est une filiale de Mining Supplies (fournitures pour les mines) de Doncaster. Quand les piquets volants de l’usine de Manchester s’installèrent au dehors de l’usine à Doncaster, en réaction au raid des SAS, la direction s’effondra. Elle aurait pu aisément utiliser la loi sur les piquets de grève. Mais, dans l’intervalle, quelque chose lui avait flanqué la trouille. Si la direction osait seulement lever le petit doigt contre les piquets, les mineurs du coin avaient promis de leur venir en aide.
Mais, à Manchester, hors de portée immédiate des mineurs du Sud Yorkshire, le patronat, soutenu par une armée de camions et de jaunes, écrasa les piquets de grève une fois pour toutes, en février 1982. Les ouvriers de l’industrie de Manchester fermèrent les yeux. Dix ans auparavant, des milliers d’entre eux occupaient les usines dans la ville et autour de l’agglomération. Déterminé à montrer maintenant qui était le patron, Lawrence Scott envoya ces salauds d’huissiers pour briser les ouvriers.
Par contre, au nord de la frontière, le patronat a intérêt à mettre des gants. Peu après le Nouvel An 1982, deux usines appartenant à British Leyland et au trust électronique multinational Plessey furent occupées dans la petite ville de Bathgate. Bien que les travailleurs de British Leyland aient arrêté leur occupation, ceux de Plessey, en majo rité des femmes, restèrent fermes, ignorant l’ordre d’évacuer les lieux. L’occupation était populaire, dans une ville où le chômage atteint 30 % de la population. Les gens du coin leur rendaient constamment visite, en leur laissant des vivres. Comme les travailleurs du centre de l’Ecosse remettaient leur argent à Manchester, le tribunal d’instance d’Edimbourgh déclara l’occupation légale. Mais pas avant que les hélicoptères n’aient tourné autour de l’usine, faisant craindre un coup de main du type SAS pour saisir les condensateurs de l’usine, d’une valeur de 650000 Livres.
Il y a eu un certain nombre d’occupations d’usines depuis, tout comme l’avait craint la bourgeoisie. La plus importante a été celle d’une filiale de Massey Ferguson à Coventry, deux fois en deux semaines, jusqu’à ce que l’ordre d’évacuation soit donné. Le rythme de la lutte de classes, dans la fraction du prolétariat qui travaille, s’est accéléré depuis l’été 1981. Les puéricultrices, le personnel hospitalier, les techniciens de théâtre menacent de faire grève ensemble pour la première fois. Espérons que ce sont les prémices d’un printemps du prolétariat, et d’un été, d’un automne et d’un hiver, parce que quelque chose de grand est en train de se frayer un chemin sous la banquise de l’accumulation capitaliste.
Même si au moment où ces lignes sont publiées (1982), il y a eu un important renversement de situation, la classe ouvrière s’est en gros repliée depuis 1979 dans la passivité, la peur et la survie.
Il y a dix ans, tout s’arrêtait pour le thé
La situation dans l’ensemble est beaucoup plus dure qu’au début des années 1970. On doit insérer dans cette perspective les épisodes de la lutte de classes. En 1972, dix ouvriers de Coventry se mirent en grève sans sourciller pour la simple raison qu’ils avaient demandé, et qu’on leur avait refusé, de plus grandes tasses de thé. Ils semblaient parfaitement insouciants, alors qu’en fait à cette époque beaucoup de luttes étaient menées avec férocité.
La signification de tels détails était déterminée moins par la logique du capital que par la résistance opiniâtre et contagieuse des travailleurs. (L’idée fit son chemin et d’autres boîtes se mirent en grève sur ce point.) Dix ans plus tard, la situation a bien changé. La grève pour la pause thé à British Leyland en décembre 1981 fut un baroud d’honneur dans un contexte défavorable pour des travailleurs, mis à genoux par une direction décidée à leur extorquer le maximum de productivité. Cela ne veut pas dire qu’entre-temps les travailleurs sont devenus des objets passifs face à la contre-attaque du capital. Cela veut dire que l’enthousiasme s’est progressivement perdu pour faire place à une guerre de positions acharnée dans laquelle chaque pouce de terrain est âprement combattu.
Pour commémorer la longévité de la bourgeoisie, l’Etat britannique fétichise certains détails immémoriaux. Et cela davantage que dans aucun autre pays industriel. Lorsque ces totems du passé sont désacralisés par la lutte de classes ou abandonnés, la gravité de la crise éclate au grand jour. En 1979, pendant l’Hiver du mécontentement, l’impensable est arrivé: les hallebardiers de la Tour de Londres déposèrent leurs piques et se mirent en grève. Et au début 1982, la ration de rhum traditionnelle de la Navy fut retirée, par suite des restrictions budgétaires.
Ce n’est que très occasionnellement que les travailleurs donnent libre cours à une folie de destruction comparable à celle des émeutes. En décembre 1980, des travailleurs de British Leyland à Longbridge se déchaînèrent soudainement, détruisant les voitures sur les chaînes de montage, et assiégèrent le bâtiment de la direction, surnommé localement le Kremlin. La même chose arriva à John Knott, Secrétaire d’Etat au Commerce, quand il visita les docks de Portsmouth à la fin de l’été 1981 : il a failli être lapidé à mort. Ce n’étaient pas des huées et des œufs pourris, mais la forme que prendront les choses à l’avenir.
Que les travailleurs perdent ainsi leur « calme », c’est le revers de la gestion de la crise. Les patrons ne se satisfont plus d’un lock-out qui menace de liquider leurs affaires une fois pour toutes. Mais est-ce une liquidation, un risque calculé, ou bien pensent-t-ils réellement affaires, ou plutôt pas d’affaires du tout ? Pendant les grèves des chemins de fer de l’ASLEF (syndicat des chemins de fer), la direction menaça carrément d’enlever les rails des lignes de chemins de fer et de les recouvrir de macadam et de ciment. En partageant leurs voitures, les gens parvenaient à aller bosser, et la direction des chemins de fer affirmait qu’elle pouvait ainsi infliger un rude coup aux travailleurs, qui avaient bien trop confiance en eux-mêmes. Mais les conducteurs de train relevèrent le défi, et la direction de British Rail se déroba. Dans les autres cas de chantage semblable, la détermination des patrons n’a pas été testée. Sir Michael Edwardes aurait-il bradé British Leyland si les travailleurs n’avaient pas suivi ses ordres ? Chaque semaine, environ 10000 tonnes de matériel sont vendues à l’étranger. Pour une partie, comme les métiers à tisser Courtauld, c’est l’outillage le plus moderne qu’on puisse trouver. L’impression dominante est celle d’une liquidation après un sinistre, pour retirer ses billes, mais peut-être est-ce la seule façon de faire passer la pilule de la reprivatisation de l’industrie britannique. Il ne faut pas oublier que 40 % de la production des cinquante plus grosses firmes anglaises se fait maintenant à l’étranger.
Etant donnée cette situation, il est important que les travailleurs qui se battent contre les multinationales ne se laissent pas enfermer dans des limites nationalistes. Si la lutte veut atteindre une plus grande clarté, alors les usines doivent rendre hommage à l’absence de nationalisme des émeutiers. De même que si la tâche du prolétariat est de combattre la décomposition de la vie sociale dans le capitalisme, l’enjeu doit être à la hauteur, créant dès le début un nouveau monde non négociable, au -delà du vieux monde.
En ce moment, le conflit le plus dur à vivre est celui qui existe entre les travailleurs eux-mêmes, c’est-à-dire au sein du prolétariat. Cette situation quasi unique doit être replacée dans son contexte.
Des meetings de grève tels que ceux récemment de Ford ou de British Leyland se sont terminés dans la rage et l’amertume. Les suffrages, lors des votes, étaient presque toujours divisés en 50 %-50 %. Dans de telles situations, quelques gestes de dépit peuvent vite mal tourner. Un poing brandi à l’adresse du copain d’atelier, devenu adversaire, est une provoque à la baste.
Cette férocité des affrontements au sein même de la classe ouvrière est l’expression de la confusion entre des tendances conflictuelles, et pas simplement les derniers soubresauts d’un syndicalisme moribond, forcé comme un rat dans ses derniers retranchements, ce que prétendent les Tories. Par exemple, les dernières attaques contre des délégués d’atelier à Dagemham (Ford) ont dû causer un malaise dans les milieux gouvernementaux, car elles furent menées par des ouvriers qui en avaient marre que les délégués leur recommandent d’accepter les salaires de Ford.
Les Tories sont victimes de leur propre propagande. Ils ont présenté les syndicats comme les méchants de l’histoire, responsables de « l’anarchie dans les ateliers ». Aux dernières élections, ça avait payé, et quand, pour prendre juste un exemple, Derrick « Red Robbo » Robinson, le chef des shop stewards du PC, s’était fait vider de British Leyland en novembre 1981 sans même une échauffourée, les Tories en firent une date importante et la victoire de la « nouvelle tendance au réalisme » chez les ouvriers.
La direction de British Leyland a estimé – on se demande bien comment – que Robbo était responsable de deux cents millions de Livres perdues par manque de production. Elle a oublié de mentionner que Robbo avait probablement sauvé la compagnie quand, pendant le dernier gouvernement travailliste, il avait franchement désavoué les grèves à British Leyland (en particulier la grève de l’atelier d’outillage).
En raison des positions contradictoires que Robbo a adopté au fil des ans, son renvoi a dû faire flipper tous les hommes politiques un peu moins bornés que les Tories. Même le Daily Mail, ce canard grossièrement réac, a dû reconnaître que les délégués syndicaux de base se sont montrés « d’utiles paratonnerres pour désamorcer les conflits dans l’atelier, avant qu’ils ne deviennent complètement incontrôlables ». Qui plus est, les patrons « se sont tournés de plus en plus vers les délégués d’ateliers pour communiquer avec leur force de travail » parce que « les permanents syndicaux à plein temps étaient tout simplement incapables de faire face à la situation » (4 novembre 1981). Malgré tout cela, les Tories se sont empressés de réduire au minimum le pouvoir des chefs syndicaux en confisquant les prérogatives des permanents et des shop stewards et en les confiant aux syndiqués de base.
Les Tories, aveuglés par l’idéologie, n’ont pas compris que la tranquillité dans les ateliers ces deux dernières années est due, en plus du fort taux de chômage, à un mélange complexe de passivité et de radicalisme, dont la composante principale est le dégoût unanime à l’encontre des syndicats.
L’hostilité envers le capitalisme et les syndicats doit encore trouver une cohérence et une maturité. En particulier, elle doit se dissocier complètement de la vague actuelle d’agressivité capitaliste envers le syndicalisme dans certains pays. Après l’Hiver du mécontentement, quand la communauté d’intérêts entre les affaires, l’Etat, le secteur nationalisé et les syndicats s’effondra, les Tories se sont empressés d’exploiter mesquinement la situation en rejetant la responsabilité sur les syndicats.
Cependant bien des travailleurs qui furent au cœur des luttes qui ont balayé la Grande-Bretagne entre 1970 et 1974 perçoivent les choses différemment. Ils ont soudainement réalisé, après 1975, que l’appareil syndical et les délégués d’ateliers avaient joué un rôle majeur dans le sabotage de la lutte de classe, au moment de la duperie du Contrat social. Ce fut la démoralisation complète, certains démissionnèrent à la fois de leurs postes de délégués d’ateliers et de leur fonctions de représentants syndicaux; d’autres s’inscrirent sans enthousiasme à des cours de poterie, d’autres se mirent à picoler et vécurent une vie mécanique, vide. Mais, en règle générale, la désillusion prétendue conservatrice envers l’appareil syndical ne put, même en partie, s’identifier à une politique conservatrice. Les mêmes phénomènes eurent lieu au niveau des quartiers, mais pas au même moment.
C’est sur cette toile de fond qu’on doit apprécier la violence mentionnée ci-dessus. La colère mal dirigée peut être néfaste, on se fait des ennemis superflus et on provoque un durcissement d’attitude chez des alliés potentiels. Mais la violence qui a éclaté récemment au cours des assemblées de grévistes peut être un début d’apprentissage de l’action directe,qui, en rejetant les intermédiaires et les médiations, englobera toute la société, au lieu de s’arrêter aux portes des usines.
Ces explosions de rage peu contrôlables sont un bon baromètre de l’urgence de la situation. Elles sont une réponse inévitable à l’atmosphère écrasante, étouffante créée par la crise, qui ne laisse d’autre choix aux travailleurs que se soumettre, ou se diriger d’eux-mêmes, à pas de géants, vers une confrontation décisive. Assoiffés d’options alternatives, les syndicats n’ont pas le coffre pour de telles fins de parties.
L’affaiblissement et le discrédit jeté sur l’appareil de représentation syndical ont suscité peu de désaveux chez les travailleurs. Cela a induit les Tories et une grosse partie du patronat. britannique en erreur : ils se sont crus en sécurité et ils ont été incapables de créer quelque chose ressemblant à l’organisme de contrôle du prolétariat, soumis éternellement au gouvernement et aux exigences du patronat. Leur stratégie dépend essentiellement de la capacité à entretenir les frictions entre les travailleurs et les chômeurs, et de la peur du chômage lui-même. Mais si une percée a lieu, ces cinglés de Tories et le reste de l’asile capitaliste pourraient bien payer un prix terrible pour avoir osé aider les travailleurs à se guérir de l’idée que les syndicats représen tent leurs intérêts.
Cependant, pour toutes ces raisons, le Décret sur l’Emploi de Tebbit (Secrétaire d’Etat à l’Emploi) n’est pas aussi bête qu’il y paraît. Contrairement à la loi sur les Relations Sociales de 1969/1974 (2), il propose de rendre les syndicats responsables des actions entreprises par les syndicalistes de base, à moins que la direction syndicale ne les aient désavouées. Les syndicats ne le feront pas, à cause du très sérieux risque d’actions sauvages. Quand aux syndicats mis à l’amende, la première loi Heath a montré que les travailleurs s’en foutaient. Peu importe, une nouvelle version de cette loi finira par être appliquée.
Le nouveau visage des syndicats
Comme dans la plupart des autres pays, le fort taux de chômage a provoqué un déclin de la participation syndicale. Cela donne une bonne excuse à des leaders syndicaux comme Alan Fisher, du NUPE, quand il s’agit d’expliquer la faible influence des syndicats sur la politique du gouvernement. Après avoir frappé avec frénésie à la porte du 10, Downing Street (la résidence du Premier ministre) en 1972/1973, Heath, le chef du gouvernement Tory de l’époque, avait fini par les inviter à des consultations. C’est qu’il avait, le pauvre, foutrement besoin d’eux !
Mais Thatcher, pour sa part, est bien décidée à ne pas jouer la concertation, même si c’était la dernière carte. Elle a certes la tête plus dure qu’Heath, mais c’est surtout la docilité inhabituelle de la classe ouvrière qui a réussi à différer le jour de l’expiation, où une Thatcher domptée aurait pu avoir à mendier l’aide des syndicats.
Les syndicats font de la faiblesse une vertu. En vérité, ils sont encore très forts, mais ne veulent pas exercer leur pouvoir autrement que par des moyens légaux et parlementaires. Ils ont extrêmement peur de pousser leurs troupes à exécuter le programme franchement capitaliste du TUC, le Programme pour le redressement économique, et préfèrent attendre qu’un gouvernement travailliste le fasse. Le TUC sait très bien que la classe ouvrière qui s’est jadis révoltée ne se laissera pas arrêter par la politique d’alternative du TUC pour sauver le capitalisme. Mais si elle se révolte, ces trous-du-cul vont encore essayer de diriger un mouvement essentiellement sans dirigeant pour détourner de ses vrais buts une énergie autonome.
Les bureaucrates syndicaux ont encore bien en mémoire le début des années 1970, et l’Hiver du mécontentement (1978/1979). Entre ces deux vagues, un universalisme « éthique » servit d’antidote à la lutte de classes (la « police morale » du TUC de 1976 à 1978) et remplaça ce que la bourgeoisie appelle « intérêt général » sur le continent. On a encouragé divers groupes d’intérêts à ne pas se montrer égoïstes, mais à penser aux autres. Ces laborieuses tentatives de trouver des garde-fous, qui en appellent davantage aux sentiments de bien et de mal qu’à des calculs embrouillés comme sur le continent, furent l’œuvre du gouvernement travailliste et du chef d’état-major du TUC, ce dernier ayant joué un rôle de grand timonier.
Puis vint l’Hiver du mécontentement. La corde raide sur laquelle manœuvrait le TUC cassa. La notion morale de service public, qui incluait les ambulanciers et même les fossoyeurs, ne fut d’aucune efficacité contre la grève de masse. Les divers syndicats furent incapables de désavouer les grévistes, par peur des conséquences, et tout en sachant que le Labour perdrait les élections.
Ensuite, sous Thatcher, il se passa une chose étrange. Les syndicats adoptèrent la politique de négociations et de mendicité qui venait d’échouer. A court terme, ça voulait dire se soumettre à Thatcher, mais à long terme, c’était se préserver eux-mêmes contre les intérêts réels de leurs membres, en prévision du jour où on les appellerait pour faire appliquer un nouveau contrat social. En apprenant ainsi à ramper, ils s’exercent pour le jour où ils auront à faire ramper les travailleurs.
Cet humanisme moral qui convient si bien au TUC correspond à une forte intégration dans l’Etat, entravée momentanément seulement par Thatcher et ses boys. Cela vient aussi de l’importance accrue des cols blancs dans la composition du TUC, et du déclin de l’influence des ouvriers dans la centrale.
Succédant aux révoltes des années 1970, révoltes principalement ouvrières, l’embauche des cols blancs par le TUC, y compris l’embauche de tout petits employés de bureau, a conféré un nouveau look au TUC. Les principaux syndicats impliqués (le GMWU, l’ASTMS, le syndicat des fonctionnaires) se mirent à prendre en compte les vues traditionnellement plus « compréhensives » des cols blancs, qui éclipsèrent ainsi le « régionalisme borné » des ouvriers.
Hegel, dans sa théorie de l’Etat, plaça de nombreux espoirs dans les petits bureaucrates, croyant que tout citoyen pourrait devenir un fonctionnaire : tant que ça durerait, la relation entre l’Etat et la société était sûre. C’est ainsi pour lui que l’Idée Absolue devait s’incarner dans l’Etat. Il y a un nombre infiniment supérieur de petits fonctionnaires aujourd’hui par rapport à l’époque d’Hegel – et la mécanisation ainsi que l’ennui quotidien ont sapé leur ancien statut. Mais on les contraint encore à se montrer « intelligents », progressistes, afin de prouver aux autres que le travail est encore une activité passionnante. Ils sont à la fois le marteau et l’enclume. Le mouvement syndical a profité de la schizophrénie des fonctionnaires et des prétentions culturelles qui s’y attachent, pour élargir sa marge de manœuvre.
Auparavant, il avait été dans l’intérêt des syndicats, et du patronat, de favoriser un sentiment de fierté réactionnaire chez les ouvriers en particulier. Le mythe héroïque de « l’ouvrier », qui assignait des pouvoirs surnaturels au travail, a fait coïncider l’identité du travailleur et du capitaliste autour de mots d’ordre rituels tels que « Le pain anglais dépend du fil du Lancashire ». C’était une perspective trop commerciale, trop austère et trop grossière pour pouvoir affronter les nouvelles préoccupations qui gagnaient le mouvement syndical (musique, racisme, mouvement des femmes, chômage, etc.) : elle est inadéquate à sa nouvelle qualité de « second parlement ».
« Jamais nous ne travaillerons,ô flots de feux ! » (Rimbaud) Les stages de formation bidon
Le TUC n’a pas, comme dans les années 1930, tourné le dos aux chômeurs. Il a ouvert, par exemple, des centres pour les sans-travail, et organisé des marches. Le NUPE (le syndicat national des employés municipaux) a fait des efforts pour recruter des jeunes chômeurs sortant des stages YOP organisés par le gouvernement (Youth Opportunities Programs, c’est-à-dire Programmes d’action pour les jeunes). ces voies de garage où l’espoir est entretenu pour être mieux éteint. A l’époque des émeutes, les syndicats, dans le Nord-Est et le Nord-Ouest, appelaient les jeunes à faire des grèves bidons, tandis que ceux qui jouaient avec le feu trouvaient la lumière.
Par l’intermédiaire des collèges d’enseignement post-scolaires, beaucoup de très jeunes chômeurs fréquentèrent les YOP, censés leur apprendre à s’intégrer. Les cours représentent une rupture nette avec l’école et montrent son échec à inculquer l’amour du travail. Dans une interview au journal du NATFHE (Association nationale des enseignants de l’enseignement post-scolaire) de juin-juillet 1980, Frank Ward, proviseur au collège de la marine et des techniques de South Shields, a dit : « Nous essayons de créer une ambiance qui ne soit pas scolaire, tout en conservant quelques-unes des contraintes que l’on trouve normalement dans le travail. »
La rapide extension des stages YOP fournit l’exemple le plus éclatant de l’irruption des principes behavioristes, que les propriétaires réels du capital apprécient tant, dans l’enseignement en Grande-Bretagne. Elle s’est faite discrètement (sans références à Eysenck et à Skinner), parce que les discussions pour ou contre ces stages relèvent du monde lointain de l’Université, réservé aux « surdoués ». Les collèges d’enseignement post-scolaires, pour leur part, se contentent d’obéir aux caprices des patrons.
Les fondements de cette philosophie, qui passe dans les collèges pour un réalisme indépassable, se résument en quelques mots : « Les chefs ont toujours raison. » Même ainsi, l’apprentissage du lèche-cul est pratiqué avec une subtilité qui masque l’autoritarisme grossier qui règne sur les lieux de travail.
Le programme d’études change constamment et chaque groupe de jeunes choisit ses propres sujets en plus du programme ; les méthodes d’enseignement ne sont pas « traditionnelles » ; les professeurs disent qu’ils n’utilisent jamais le mot « enseigner » ! Les étudiants sont encouragés à se critiquer, des enregistrements vidéo se moquent des entrevues pour trouver du travail. Les ateliers d’aptitude à la communication, pourvus de matériel vidéo, contiennent le nec plus ultra d’un matériel de détection, par lequel le boss tout-puissant peut contrôler la conduite de ses futurs employés, en s’assurant leur soumission précoce.
Au collège de South Shields, le personnel enseignant qui s’occupe de la réintégration, partie des plans YOP, vient d’horizons divers, travailleurs sociaux, orienteurs professionnels, animateurs. Contrairement aux collèges ·du Sud-Est, l’origine sociale des enseignants est beaucoup plus ouvrière. Fiers d’avoir dégotté un travail d’enseignant dans un collège d’enseignement post-scolaire, les profs, surtout dans le Nord, considèrent un lecteur régulier du Times comme une divinité ambulante. Mais cette proximité avec leurs élèves, fondée sur un sentiment d’infériorité identique, a ses limites : sortis également des queues de chômage, payés comme chefs de groupe dans les stages YOP, ils deviennent des figures-clés de l’opération gouvernementale de réduction des salaires. Parce qu’ils comprennent assez bien la vie du chômeur, ils sont utilisés pour enfoncer dans les crânes des jeunes les intentions du gouvernement. « Les chefs de groupe ont été recrutés sur les listes du chômage, et cela a donné des hommes et des femmes qui comprennent les jeunes et sympathisent avec eux, et qui peuvent leur parler dans leur propre langue. » (Op. cit.)
Les chômeurs qualifiés
Le chômage, particulièrement en Grande-Bretagne, frappe inégalement des gens qui pouvaient penser que « ça ne leur arriverait jamais, à eux ». Les administrateurs judiciaires font des heures sup, un grand nombre de PME font faillite, ce qui fait chômer des ouvriers qualifiés, et le nombre de diplômés à la recherche d’un hypothétique emploi augmente sans cesse. Le chômage apparaît ainsi comme le plus radical des niveleurs. Pour contrer cette tendance, la MSC (Manpower Services Commission, c’est-à-dire la Délégation à la main-d’oeuvre) essaie de son mieux d’enfoncer une brèche entre la masse de chômeurs non qualifiés ou semi qualifiés et les chômeurs qualifiés. Désormais, pour certains, le piège du chômage est prudemment évité, retardant pour un temps le choc de la prolétarisation.
Aux gens qualifiés qui échouent à trouver un travail fixe dans leur branche particulière, on propose de changer d’orientation. Des contrats temporaires sont proposés en nombre croissant, qui impliquent d’une manière ou d’une autre la surveillance des jeunes chômeurs, surtout dans le domaine du spectacle, des sports, de l’archéologie, etc.
Etre chômeur est une condition impérative pour obtenir l’un de ces boulots. Le chômeur qualifié ne peut résister qu’un certain temps à ces sollicitations ; s’il refuse trop longtemps, il sera happé sans cérémonie par le processus de déqualification. Cette expérience douloureuse, mais nécessaire, se passe généralement dans le bureau de la Sécurité sociale locale, portes fermées, en présence d’un fonctionnaire chargé du contrôle des chômeurs. Une fois cette histoire réglée, les chômeurs qualifiés peuvent s’attendre à être continuellement en butte aux tracasseries de l’Etat, qui n’en a rien à foutre de leurs prétentions à un traitement particulier.
La MSC compte sur les chômeurs qualifiés pour montrer la voie aux autres sans-emploi. En 1980, fut publiée une brochure du Conseil national pour le service volontaire, commanditée par la MSC. Cette brochure, intitulée Travail et Société, semblait être un éloge de l’oisiveté, mais un second coup d’œil montrait que c’était totalement faux. Le rapport dit qu’on aurait dû depuis longtemps bannir la flétrissure associée au chômage, mais le chômage chronique n’est pas une excuse pour ne pas partager « la façon de voir de Beveridge sur le mal inhérent à l’oisiveté involontaire ».
La distinction qu’établit le rapport entre chômage et privation de travail est en fait une manière déguisée de dire qu’il faut en baver pour mériter les allocations chômage. Dans cette perspective, ce n’est pas un hasard si le nom de Beveridge (l’architecte du Welfare State d’après-guerre) réapparaît. La pieuse distinction entre les pauvres méritants et les autres sert à condamner d’avance les chômeurs. En d’autres termes, pour bénéficier du statut de « ceux qui méritent leurs allocations », le chômeur doit être volontaire pour faire un travail non payé, comme le stipule expressément le rapport.
Le rapport ne veut pas simplement ravaler la façade du système des allocations chômage. Il entend remplacer le travail au noir des chômeurs par des « coopératives locales de production et de consommation, et d’autres activités municipales de travail et d’artisanat », pour pallier aux réductions de budget et de personnel dans les services sociaux. Le seul inconvénient, admet le rapport, c’est que « dans les centres-villes, la tradition de l’effort volontaire s’est perdue ». Il est possible que, sur ce point crucial, on compte sur les chômeurs qualifiés pour fournir aux autres un exemple à suivre.
Le rapport devint la base du programme de la MSC, mis en train en avril 1981 lorsque le nombre de chômeurs de longue durée atteignit le demi-million. Maintenant, sous Tebbit, le Programme tarde à faire appliquer le principe du travail social non payé, car ça a déclenché un beau tollé. Mais pourquoi toutes ces protestations ? Après tout, Tebbit suit le rapport à la lettre.
L’ancien travailleur qualifié peut changer si on y met le paquet. Il y est de toute façon poussé par l’Etat, au fur et à mesure de son temps de chômage. Dans ces conditions, le principe d’un travail d’utilité publique ne pourra être repoussé indéfiniment. Tant qu’on le maintient ainsi cantonné sur un terrain pourri, l’ex-qualifié est bien coincé, sans pouvoir ni rendre aucun coup, ni mettre en évidence et clarifier les pratiques pernicieuses du capital et de l’Etat.
L’ordre règne-t-il dans la vallée de la Tyne ?
Certaines des innovations les plus audacieuses des stages YOP virent le jour dans la vallée de la Tyne. Ce fut une des premières régions à introduire les Allocations de ving-et-une heures, permettant aux jeunes chômeurs de suivre vingt-et-une heures d’enseignement post-scolaire, sans perdre leur statut. Les arrivistes pionniers intéressés par l’expérimentation in vivo sur les cobayes sans travail ont été particulièrement attentifs à ces stages. Pour Jack Grassby, secrétaire de liaison du syndicat NATFHE (Nouvelle Association des Enseignants de l’Enseignement Post-Scolaire) au collège de South Shields, la région « a appris à utiliser le chômage d’une manière créative » !. Mais le représentant régional de la MSC pour les Programmes spéciaux exprima un avis plus désabusé et plus clair. Lorsqu’on lui demanda quelle utilité pouvait avoir l’extension du programme, quand tant de gamins finiront par retourner au chômage, il répondit qu’au moins ça empêchait la violence dans les rues.
Les stages YOP expérimentés dans la région de Consett et de la Tyne pendant l’été 1981 aidèrent à désamorcer une colère qui aurait pu être aussi forte qu’à Liverpool. L’extension des programmes YOP a dû avoir quelque impact, pour en arriver à réduire au minimum les émeutes dans la région. En fait, les programmes YOP, promus par ces forteresses apparemment imprenables du Labour Party, se révèlent être maintenant une expérience que le gouvernement Thatcher a appliqué au reste du pays, en réponse aux émeutes. Même les journaux ont reconnu franchement que les jeunes chômeurs qui venaient juste de quitter l’école « subiront maintenant une pression considérable» de la part des URO (fonctionnaires chargés de contrôler les chômeurs) pour les obliger à s’inscrire aux stages YOP ». On pourrait faire la même analyse en ce qui concerne la vallée de la Tyne qui, sous les auspices des autorités locales dominées par le Labour Party, a anticipé la tendance nationale d’au moins un an et demi.
La formation professionnelle dans les années 1980 :
l’apprenti sorcier
Le plan Tebbit est un autre exemple de centralisation boiteuse imposée à un gouvernement surpris par les émeutes de l’été. Quand on les examine avec du recul, les stratégies gouvernementales offrent un mélange schizophrénique de soumission aux principes libéraux, et de mesures hâtives qui accroissent la centralisation étatique. Quand Tebbit décida de fermer seize Bureaux de formation industrielle, il remettait plus solidement encore la responsabilité de la formation industrielle dans les mains de l’industrie privée. En même temps, il a créé l’espace nécessaire à la MSC pour assumer la direction de l’apprentissage, en garantissant en septembre 1983 un an de formation à tous les jeunes qui n’arrivent pas à trouver un boulot en sortant de l’école.
Ils ont calculé que ce plan deviendrait juste opérationnel pour la venue au pouvoir d’un futur gouvernement travailliste, ou d’une future coalition gouvernementale SDP/Tory. C’est une bonne nouvelle, car tous les partis vont avoir un sacré boulot pour convaincre la multitude de jeunes chômeurs sortis des écoles que les « abus » du travail sous-payé vont être terminés. Tant que les stages YOP étaient peu nombreux, la MSC, et surtout les petits syndicats, pouvaient mettre le holà à la prolifération de sociétés qui « avaient une politique suspecte d’embauche des jeunes » et qui utilisaient les apprentis comme une force de travail bon marché, à la place de travailleurs plus vieux, tout en réclamant des primes d’embauche à la MSC.
Ce contrôle étatique allait à l’encontre de la politique libérale du gouvernement, mais quand les stages se multiplièrent après l’été des émeutes, les syndicats abandonnèrent ouvertement leur responsabilité, tout en continuant à siéger au bureau de la MSC. Maintenant que les stages YOP vont être remplacés par un apprentissage général dérisoire, qui paraît bien parti pour poursuivre les « abus » des YOP, les syndicats vont se placer clairement en première ligne. « Abus », c’est le bel euphémisme choisi avec soin par la MSC et les syndicats pour cacher l’horrible vérité. Au cours des douze mois qui précédèrent juin 1980, cinq jeunes furent tués pendant leur apprentissage, vingt-cinq furent amputés d’un membre ou d’un doigt, et deux mille furent blessés au travail. La plupart d’entre eux n’eurent droit à aucune indemnité parce que, dans leur ignorance, ils n’avaient pas respecté les conditions de sécurité. Et pas un d’entre eux ne reçut un penny des assurances maladies.
Actuellement, le plan Tebbit comprend trois mois de formation, le reste du temps étant consacré à « l’expérience du travail » dans une entreprise. Même en tenant compte de la déqualification massive qui frappe toute l’industrie, ce n’est même pas un apprentissage bâclé à la va-vite, c’est, au mieux, un préapprentissage. (…) Le projet peut paraître vouloir faire baisser uniquement les salaires des apprentis, les plus élevés d’Europe, mais son but réel est de vouloir faire baisser le niveau général des salaires. Ce plan, comme la série de mesures prises par Thatcher contre le chômage, vient d’un gouvernement qui s’est engagé à rester en dehors des marchandages sur les salaires !
Parce que ces pseudo plans de formation concernent une masse de jeunes qui sortent de l’école, il semble que l’on peut s’attendre à quelques belles déclarations syndicales contre cette surexploitation. Espérons du moins que ce coup-ci, les travailleurs seront plus directement impliqués et réagiront. Ça ne sera pas facile, car l’afflux de jeunes sous-payés, qui font le boulot ou même veulent faire le boulot d’adultes beaucoup mieux payés, est une barrière à l’unité.
Seulement cette fois-ci, les syndicats, à cause de leur participation au MSC, ont été acculés à surveiller la bonne marche du projet gouvernemental. Pas de chance ! Sur le point de perdre leur monopole de l’embauche, ils se voient contraints d’apaiser les craintes qui hantent les travailleurs déjà en place, tout en préservant le mode de salaire qui divise adroitement les travailleurs des adolescents.
Une position peu enviable, qui exige trop de manigances, même pour les vieux tricheurs roués du TUC. Les syndicats doivent rêver avec nostalgie des bons vieux jours où au moindre signe de danger ils avaient la possibilité de rentrer dans leur coquille.
Le plan Tebbit, contrairement au précédent rapport Finniston sur l’industrie (3) ne fut pas conçu pour lutter contre la sous-qualification de la force de travail, qui débilite le capital britannique. En août 1981, l’Institut de la construction mécanique estimait que les ouvriers étaient de moins en moins qualifiés dans sa branche. A la même époque, 68000 emplois ne tenaient plus qu’à un fil dans la construction mécanique, grâce pour un temps aux subventions à court terme de l’Etat. Plutôt que de rectifier cette situation dans les intérêts d’une restructuration capitaliste, le plan Tebbit représente la continuation de ce bon vieux principe : « Le diable trouve du travail pour les oisifs. »
Quels sont les besoins du capital en matière de formation professionnelle ? La question ne fut jamais réellement posée. Personne ne fit réellement attention aux jeunes apprentis, émeutiers de Berlin et de Zurich. Tout le barouf fait au Parlement après les émeutes sur le manque de formation fut plus une complainte de l’organisation sociale impuissante à écarter les jeunes des rues qu’un coup de semonce tardif à la technologie capitaliste.
Pouvoir gris et syndicats jaunes
Si les jeunes doivent être virés des rues, les vieux doivent être encouragés à mourir.
Le nombre croissant de personnes âgées qui vivent de la retraite a également commencé à attirer l’attention du TUC. Il pourrait sembler que les syndicats mettent leur pouvoir au service des vieux pour les aider à arracher plus d’indemnités à l’Etat. Mais la vraie raison se trouve ailleurs. Dans les dernières années, les vieux ont commencé à se démener eux-mêmes, développant des projets informels d’entraide, qui pourraient facilement se transformer en des pratiques plus agressives, par exemple contre ces vieilles brutes du gaz et de l’électricité: ceux-ci peuvent condamner à mort les retraités en leur coupant les sources de chaleur. En demandant au gouvernement de plus grosses allocations, le TUC prévient des mouvements de cette sorte, qui pourraient facilement avoir des conséquences comme le refus de payer, et le Derby local ou le Joan Club croulant sous les imprimés de retraite.
Le TUC commence également à empiéter sur le terrain traditionnel des organisations bénévoles. Ses revendications commencent à sonner comme des appels à la charité qui préfèrent tourmenter les consciences plutôt que de menacer d’utiliser la force. En même temps des organisations plus récentes reposant sur le volontariat (Task Force, etc.) se réfèrent constamment aux « organisations de travailleurs » (sic). Dans un passé pas si lointain, la majorité des organisations bénévoles auraient préféré crever plutôt que d’utiliser de telles expressions.
Plus globalement, cette évolution du TUC est liée à l’augmentation de la partie improductive du prolétariat dont les salaires, les retraites, les allocations chômage s’échangent contre les impôts. La majorité de la classe « ouvrière » se trouve maintenant hors de l’industrie productive, et c’est pourquoi les syndicats ne peuvent continuer à la négliger. Laissé à lui-même, ce secteur est trop dangereux, comme le démontre l’exemple des émeutes.
Le blues d’après les émeutes
pression, pression, pression…
Finalement, que s’est-t-il passé pour les gamins après les journées de juillet ? Pas mal de gens ont remarqué un changement. On voit beaucoup d’adolescents marcher dans les rues, le regard sauvage, les sourcils froncés, achevant peut-être quelque mystérieuse besogne ou peut-être juste marmonnant entre leurs dents.
Bien sûr, ils étaient là avant, mais le bruit, la rage et les espoirs déçus en ont laissé beaucoup complètement claqués, du moins en apparence. Espérons que ce n’est pas pour longtemps. Les conditions sont trop mauvaises pour produire des arrivistes cyniques ou un nihilisme meurtrier, même temporairement. Quiconque a vécu 1968 et les dix années de reflux qui l’ont suivi sait comment cela peut conduire les plus sincères au désespoir ou au suicide.
Mais les signes sont bons. La brève expérience de solidarité a survécu à la défaite.
L’importance de tels événements est incalculable.
On ne peut pas les oublier comme ça. Deux très jeunes chômeurs, Sean et Raffy, se firent chopper à Widnes, sur les rives de la Mersey. Leur ex-proviseur les traita de hooligans à la télé; ils furent vengés par leurs ex-compagnons qui incendièrent en partie son école de merde.
Certains jeunes prennent individuellement sur eux d’en venger d’autres. Il y a quelque chose de pitoyable et. de douloureusement désolé dans ces incidents, qui, à d’autres égards, rappellent les représailles des anarchistes du XIXe siècle. Un jeune fut condamné à huit ans de détention par le bon plaisir de Sa Majesté, après avoir essayé de tirer sur elle, à blanc, pendant Trooping of the Colour. Quelques semaines plus tard, un autre jeune se fit alpaguer devant les portes de Buckingham Palace avec un pistolet à air comprimé chargé. Tous deux avaient amplement prévenu leur entourage de leurs intentions, et il s’est avéré difficile par la suite de démêler la part de conscience de classe et celle du désespoir individuel quand on eut connaissance de certains détails de leurs « dossiers médicaux ».
Notes
(1) Le NUM gallois peut apparaître dans cet exemple comme en avance sur les ouvriers. Mais les ouvriers en ont de plus en plus leur claque qu’on leur dicte ce qu’ils ont à faire. Dans l’usine Weetabix de Northland, cette année, les ouvriers étaient poussés à se mettre en grève par leur syndicat. Les ouvriers, en colère contre cette décision prise en haut lieu, appelèrent immédiatement à un meeting pour discuter entre eux si oui ou non ils devaient faire grève.
(2) La loi sur les Relations Sociales fut votée en février 1972, sous le gouvernement conservateur de Heath, mais elle avait été préparée par le précédent gouvernement travailliste, et les conservateurs reprirent quasi entièrement le projet de loi travailliste. En gros, cette loi était dirigée contre les grèves sauvages, endémiques depuis 1960, et surtout depuis 1968. Mais ce projet visait à renforcer aussi les syndicats, qui n’arrivaient plus à contrôler leurs troupes. La loi prévoyait que les syndicats devaient se faire enregistrer, et que tous les conflits devaient passer devant un Tribunal des Relations Sociales (NIRC), postulant ainsi clairement que les accords patrons-syndicats devaient avoir la même valeur que les contrats commerciaux, c’est-à-dire que la vente de la force de travail devait suivre les mêmes règles que la vente de toute marchandise. Grèves sauvages ou officielles devaient être limitées, une liste des « rapports sociaux condamnables » figurait dans le texte, avec les amendes que le Tribunal pouvait infliger. Cette loi ne fut pratiquement pas appliquée, grâce à la force du mouvement social (grève des mineurs début 1972) (NdT).
(3) Le rapport Finniston fut plus ou moins coulé par le gouvernement Thatcher parce qu’il était, entre autres, un démenti implicite à la règle que le travailleur britannique est paresseux jusqu’à la moelle et responsable par conséquent de la « crise du profit ». Finniston, qui avait à cœur les intérêts du capitalisme industriel, soulignait la nécessité de plus gros investissements industriels, ce qui aurait obligé le gouvernement et les banques à subventionner davantage l’industrie. Il prévoyait d’étendre la formation à la haute technologie et de réévaluer le statut des ingénieurs qui, comme en France, seraient classés dans la même catégorie que les cadres de direction. Cela montre bien que la Grande-Bretagne ne répond plus aux exigences du capitalisme industriel moderne et qu’il serait temps qu’elle le fasse parce qu’un « réel déclin économique frappe maintenant la Grande- Bretagne de plein fouet ». Bien que les arguments de Finniston soient ceux d’un technocrate intelligent, l’échec de la modernisation de la Grande-Bretagne sera indubitablement un facteur pour précipiter une crise révolutionnaire qui a déjà bien dépassé la perspective d’un capitalisme technocratique d’Etat.
Aux chiottes la théorie ?
L’absence de théorie en Grande-Bretagne est-elle vraiment inquiétante ? Aucun pays n’a été si proche de l’abîme sans que s’exprime un besoin de théorie. Et il n’est pas facile d’expliquer pourquoi cette absence retarderait un mouvement prolétarien qui est, à d’autres égards, si avancé. Pourtant, cette insatisfaction, ce sentiment que quelque chose cloche demeurent.
Comme les émeutiers italiens de 1977, les émeutiers anglais se sont vite débarrassés de la gauche, comme jamais. Mais contrairement aux Italiens, ils ont semblé incapables de dépasser une dénonciation rageuse mais étroite des pratiques de manipulation. Il n’y eut jamais aucun effort réel pour généraliser la lutte, mais presque tout le monde, particulièrement à Liverpool, était libre de s’y joindre spontanément. L’action remplaçait le slogan d’ « unité de classe ».
Dans l’ensemble, il n’y eut presque pas de bombages. Nulle part sur les façades noircies par la fumée on ne peut trouver de bombages approchant la clarté et l’actualité toujours présente des slogans du printemps italien : « Reprenons la vie », « Soyez assuré que je ne me suiciderai pas, Italie 77 », « Nous réaliserons la culture en la supprimant », etc. Il n’y eut pas beaucoup de tracts ni de brochures. La meilleure brochure parue en Grande- Bretagne fut Un second coup de trompette contre le cauchemar capitaliste. En France, de telles émeutes auraient produit un déluge de tracts, sans compter les bombages quasi inévitables. Et en dépit d’une situation différente, la filiation directe avec Mai 68 y aurait été évidente pour la plupart des gens.
En Grande-Bretagne, les soulèvements qui secouent le pays ne regardent que furtivement par delà l’Océan et les frontières nationales. La rage, localisée, n’aspire jamais, même en paroles, à un véritable internationalisme. Pourtant, les luttes de classes en Grande-Bretagne attirent beaucoup l’attention ailleurs. La vague de grèves en Grande-Bretagne entre 1970 et 1974 fut commentée dans le monde entier, mais le prolétariat britannique resta indifférent à cet impact. En 1981, quelques jours après les émeutes de juillet, des panneaux furent fixés à l’arrière des camions à Berlin, proclamant « Manchester, Liverpool, Londres, Berlin », pendant que des bombages apparaissaient sur les murs en Espagne, réclamant un Toxteth et un Brixton là-bas. Et un des meilleurs tracts qui soient sortis sur l’explosion en Grande-Bretagne fut produit à New York sous le titre Des barbares pour le socialisme. C’est insultant de dire que le prolétariat britannique ne voit pas plus loin que le bout de son nez, mais la qualité des analyses venant d’en dehors de la Grande- Bretagne ne cesse d’augmenter, faisant honte à la plupart des efforts faits ici pour se saisir de la lutte de classes dans ce pays.
Une image gênante, peut-être exagérée, surgit parfois à l’esprit. La Grande-Bretagne a été complètement chamboulée. Les jeunes, les vieux, les Noirs et les Blancs, les travailleurs et les chômeurs se sont engagés dans les émeutes sans que même un timide appel à leur extension internationale ait émergé du fracas fait par les jeunes Anglais de toute « race ».
Le repli des Anglais sur leur île est cependant très différent de l’isolationnisme américain. Historiquement, tous deux ont été bien aise de la Pax Britannica et de la Pax Americana, qui leur permettaient de laisser le reste du monde aller au diable si besoin était. Mais en Grande-Bretagne, ça s’est enraciné aussi bien au centre-gauche qu’à l’extrême droite (le député Dennis Skinner, de la gauche du Labour Party, se vante de ne pas avoir de passeport à l’ère des voyages de masse). Et ce n’est pas dans un sens particulièrement extrême, comme en Amérique, où certains mouvements craignent plus Washington ou New York que le monde extérieur. Les immigrés, amadoués par la façon dont on s’intéresse à leur condition, sont sans doute vulnérables à l’influence de l’aile gauche des petits Englanders.
Autrefois, il était entendu dans ce pays que Dieu était un Anglais, mais pas la moindre goutte de cet orgueil n’a atteint les prolétaires qui vivent en Grande-Bretagne et osent tenter une recherche théorique sur la lutte de classes en Grande-Bretagne ou ailleurs. Le manque manifeste de confiance en eux, même dans ce domaine, se transforme facilement en une paralysie totale, née d’un sentiment d’infériorité. C’est dommage, mais avant de stigmatiser cette lâcheté, nous devons comprendre ses origines.
Une partie du problème provient d’idées fausses, mais populaires, qui confondent automatiquement la théorie avec les intellectuels appointés. Parce que ces derniers ont une position sociale supérieure même aux hommes d’affaires dans l’échelle des valeurs pseudo bourgeoises en Grande-Bretagne, ceux qui essaient de théoriser tendent à être mis dans le même panier qu’ « eux ». « Eux » a une signification précise en Grande- Bretagne. Il s’agit de l’arrogance et du cynisme sans bornes. Alors, pour se protéger d’une telle suffisance, on se réfugie dans l’exagération inverse. Le problème est que toute théorisation est par conséquent suspecte. Cette réaction bornée n’a pas encore sérieusement handicapé le prolétariat. Mais elle pourrait bien entraver le mouvement dans le futur. Il est urgent de considérer la théorie comme autre chose que de l’esbroufe : cela pourrait bien sauver des vies et empêcher un désastre.
A l’heure actuelle, on risque l’exclusion de la part de ses propres potes quand on fait un pas au-delà d’un territoire bien délimité, fait d’observations coupantes comme le rasoir, mais partielles, de bons mots provocants et de blagues quotidiennes. La moindre tentative de théorisation révolutionnaire provoque au mieux des moqueries gentilles, le silence embarrassé et au pire – bien que cela soit plus rare – des sarcasmes haineux. En Grande-Bretagne, le ghetto à la fois figé et dynamique de la classe en elle-même oscille d’un moment à l’autre entre une confiance exagérée en soi et un complexe d’infériorité. Equilibre précaire… Mais, pour l’instant, on ne sort pas de là : en comparaison de la France, de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie, la Grande-Bretagne est sous-développée en ce qui concerne la théorie, quoi qu’elle reste sur le plan pratique extrêmement riche. Il est vrai aussi qu’ici et là en Grande-Bretagne des travailleurs deviennent de; théoriciens, et d’excellents théoriciens. Espérons que cette tendance va s’accentuer jusqu’à ce que la théorie en actes devienne une force irrésistible.
Les périodes de lutte de classes les plus agitées laissent toujours du temps pour la réflexion, mais il est loin d’être immédiatement évident que des leçons aient été tirées en Grande-Bretagne. Elles doivent l’être, sinon la lutte de classes pourrait bien s’écarter de son but. Il n’y a pas la moindre exemple de création théorique vraiment collective qui puisse supporter la comparaison avec les statuts de l’Assemblée des dockers de Barcelone durant leur grève de 1980-1981. Et parce que c’était une assemblée, des gens de l’extérieur, y compris des étrangers, avaient le droit d’entrer et de parler (il y eut récemment des assemblées de travailleurs et de chômeurs en Espagne). Ce qui en émergea finalement, ce fut un tract révolutionnaire, qui subordonnait les délimitations des différentes branches (la base du trade-unionisme) aux réalités plus vastes de classe. En Grande-Bretagne, les seuls exemples comparables furent les occupations de l’usine Plessey au Sud-Ouest de l’Ecosse, et celle de l’usine Fisher Bendix à Liverpool en 1972. Suivant l’exemple de Plessey, les travailleurs de Fisher Bendix créèrent une assemblée ouverte (« Notre lutte est votre lutte »), où les femmes, les enfants, les frères, sœurs, tantes, oncles, chiens, chats et amants pouvaient entrer et s’exprimer. Mais c’est resté aussi une sorte d’affaire familiale de Liverpool, et il est douteux que des étrangers répandant des opinions et du matos révolutionnaire aient été si bien accueillis que ça. Encore que Liverpool ait périodiquement défié toute prévision.
Quand on compare les émeutes de Grande-Bretagne avec celle de Berlin, les mêmes défauts apparaissent, dans un mouvement de même nature, dont le centre réside au-dehors de la production. Dans Emeute de Berlin mentionnée ci-dessus, des camions munis de haut-parleurs récitant les noms et les autres intérêts commerciaux des spéculateurs immobiliers (y compris, incidemment, les syndicats allemands) encourageaient les manifestants à s’attaquer aux appartements rupins. Ces apparts furent systématiquement lapidés. En Grande-Bretagne, cette clarté fit défaut. Les émeutes en Grande-Bretagne furent certainement plus exclusivement prolétaires que celles de Berlin, et bien plus implacables. Mais après avoir fait la part des choses, une allergie à toute théorie semble boucher l’horizon.
On ne le répétera jamais assez : la Grande-Bretagne et le reste du monde anglophone ont désespérément besoin de tenter une entreprise de publications radicales. Surtout en Grande-Bretagne, quand on sait combien le pays est proche d’une gigantesque explosion, ou d’une catastrophe si les choses tournent mal.
Si les travailleurs ne réagissent pas d’une manière révolutionnaire dans un proche futur, il pourrait y avoir une psychose de mort à chaque coin de rue. Si de nouveaux progrès dans la lutte de classe ne se font pas continuellement, le raz de marée des émeutes pourrait être endigué, et commencer à déferler dans l’autre sens. Et si ça se passait, ça ne serait pas la peine que les travailleurs dénoncent la bourgeoisie: il faudrait blâmer tout autant leur propre tolérance passive pour la circulation des marchandises et l’Etat. Il n’y a pas de vérités éternelles qui rendent le succès de la révolution certain à l’avance. Il faut lutter à chaque étape pour une vie quotidienne affranchie du ·capitalisme. Un manque de clarté pourrait signifier « la ruine conjointe des classes en lutte » (Marx). Et cela voudrait dire aujourd’hui que des milliards de gens feraient leur soumission pour longtemps.
« Nous assistons au réarmement spectaculaire de notre grand ennemi, l’Etat. Ce que font les classes qui dirigent le monde, quand elles veulent donner un semblant de solidité à la décomposition de leurs fondements. »
(Affiche sur les libertaires espagnols emprisonnés, 1981)
Aucun replâtrage – et il y en a eu peu – ne peut dissimuler que l’Etat en Grande- Bretagne se prépare à long terme à des insurrections. Il y a eu récemment deux changements fâcheux liés au pouvoir croissant du secteur paramilitaire. Le premier consiste à offrir aux jeunes travailleurs des villes la chance de participer à des expériences de l’armée. Le second, c’est une renaissance de la milice (appelée maintenant Home Service Force, Forces Intérieures en Service), pour garder des installations clés telles que les télécommunications, les transformateurs électriques, les pipe-lines de pétrole, etc., contre « les saboteurs russes en cas de guerre ». En bref, l’Etat utilise la menace d’une troisième guerre mondiale déclenchée par les superpuissances pour réprimer quelque insurrection interne. L’armée précise qu’elle ne cherche pas vraiment des adolescents (elle ne peut sans aucun doute leur faire confiance). Elle préfère prendre d’anciens militaires ou flics. Les fonctionnaires de la Défense soulignent qu’il n’est pas question d’appeler la nouvelle milice à des tâches de répression des troubles de l’ordre public, mais ce serait le comble de la stupidité de penser qu’ils s’en priveront.
De tous côtés, on a commencé, inégalement, à tirer des leçons des émeutes. L’Etat prépare sa défense bien avant un assaut qui pourrait être révolutionnaire. Le prolétariat doit en prendre bonne note et prévoir quelques problèmes à l’avance. A cet égard, la Pologne a été un terrain d’expérimentation et un clair avertissement que le système ne se laisse pas harceler indéfiniment sans réagir. Les opérateurs du téléphone en Pologne, furent pris au dépourvu par le coup d’Etat : c’est ainsi que les communications téléphoniques furent facilement coupées par les militaires. Est-ce que les opérateurs téléphoniques anglais ont pensé quelles pourraient être les conséquences si les communications téléphoniques étaient aux mains d’assassins armés ? Incapables du moindre contact avec l’extérieur, ils seront en butte aux plus effrayantes intimidations de « leurs » gardes armés.
Enfin, les vacances des jeunes chômeurs avec l’armée, longuement promotionnées, marquent un moment crucial dans l’action de l’armée envers les jeunes chômeurs. Jamais depuis les Boys Scouts, l’armée n’avait décidé d’exercer une influence en dehors de ses fonctions. Les volontaires ne s’entraînent pas avec des armes, pour le moment du moins, mais seront soumis à la discipline militaire et devront probablement approuver une prise du pouvoir de l’armée, si ça arrive. Il est trop tôt pour dire quelle sorte de jeunes peuvent être attirés par cette offre à bas prix, mais elle pourrait bien rencontrer un écho dans certains courants sous-culturels encore réprimés ou balbutiants de jeunes partisans de l’autorité.
« Les Malouines aux pingouins, la victoire aux moutons »
(Slogan anti-guerre)
Pendant l’hiver exceptionnellement rude de 1886, des ouvriers du bâtiment en chômage et d’autres se révoltèrent dans le centre de Londres. Engels a condamné les combats de chômeurs « la première escarmouche de la Révolution ». Ils étaient, selon Engels, l’œuvre de canailles désespérées « à la frontière de la classe ouvrière et du lumpenprolétariat, prêtes à rigoler et à déclencher des émeutes sauvages à propos de rien ». Dérivant dans l’East End, ces chômeurs au nombre de 20000 chantèrent un ou deux refrains de Rule Britania.
Cet autre « hymne national » né de la mer a été entendu à nouveau quand la flotte fit route vers les Falklands/ Malvines, ou plutôt les Penguin Islands. Dans un bus à Londres, on pouvait lire ce graffiti : « Skinheads, combattez pour votre pays, allez aux Falklands ! » et le nombre des candidats au recrutement dans le Bureau naval de High Holborn augmenta en flèche. Quand on lui demanda à un programme radio si le recrutement incluait les jeunes chômeurs qui venaient de quitter l’école, un délégué répondit : « Nous ne sommes pas un bureau de placement pour chômeurs. »
Cette réponse glacée marque les limites d’un nationalisme exacerbé, que l’Etat ne s’est pas privé d’utiliser, faisant appel au restant de souvenirs de l’Empire et à l’héritage anti-fasciste né de la Seconde Guerre mondiale. A côté d’autres souvenirs arrachés du plus profond de l’histoire, Maggie Thatcher à la veille du départ du corps expéditionnaire Mark 1, cita la reine Victoria : « L’échec est impossible. »
Derrière une façade anachronique d’anti-fascisme vertueux et d’impérialisme territorial, le but caché de cette guerre est de désorienter le prolétariat. Jamais à aucune époque la flotte n’a servi aussi explicitement à empêcher le prolétariat de mettre les voiles à son propre bateau ivre. Derrière la démonstration de force inattendue du corps expéditionnaire, il y a la peur des émeutes, des grèves et d’une jeunesse en rupture dont il faut clouer l’agressivité au mât du hooliganisme patriotique, avec la bénédiction officielle. L’acharnement des médias avec leur opération bas-fonds a étouffé toute info (jusqu’en juin) sur trois jours de grosses émeutes qui eurent lieu à Liverpool et n’a que partiellement réussi à faire le silence sur l’agitation dans les services de santé. Les mineurs en grève avaient déjà reçu le soutien des infirmiers, et la promesse d’une aide supplémentaire des travailleurs de l’acier. Une grève nationale des dockers était pratiquement annoncée, et une agitation massive menaçait dans les chemins de fer. Sauf en ce qui concerne les hôpitaux, les grévistes ne se battaient pas pour de meilleurs salaires, mais sur des questions de solidarité de classe, de chômage, de détérioration des conditions de vie. (…)
Avec la guerre de l’Atlantique Sud, brusquement, les différences raciales, régionales, nationales, prirent de l’importance. Les succès militaires ont fasciné plus d’un skin. Un an avant, ils brûlaient de piller les banlieues riches. Maintenant, ils cassent la gueule à de jeunes Noirs qui affirment qu’ils se foutent des Penguin Islands. Des prolétaires irlandais qui, ces dernières années, n’ont jamais fait grand foin de leur identité irlandaise, baissèrent la voix, pour que personne ne les suspecte d’anti-patriotisme, et les habitants du Nord devinrent suspects de « socialisme » aux yeux du Sud « loyaliste ». Cette vieille politique de merde de diviser pour régner a réapparu, mais elle n’a pas grande consistance.
Le gouvernement britannique a présenté la guerre dans l’Atlantique Sud comme une guerre juste. C’est la clé du baratin anti-fasciste, des références au débarquement du Jour le plus long, à la Pologne en 1939. Mais le véritable impact de cette propagande se fera sentir en Amérique Latine, pas en Grande-Bretagne. D’un seul coup, Thatcher a remis en cause l’axe Etats-Unis Argentine. Comme l’a déclaré l’ancien Secrétaire d’Etat américain, William Rogers : « Nous risquons l’érosion, si ce n’est le démantèlement, de tout le système interaméricain. » Thatcher en tous cas n’a aucunement conscience qu’elle pourrait bien fomenter la révolution en Amérique Latine. Auparavant, les corps expéditionnaires britanniques étaient utilisés outre-mer pour mater les rébellions populaires, maintenant, c’est l’inverse : le succès des militaires britanniques avive les flammes d’une révolution sociale à l’étranger.
Le gouvernement n’avait, dans cette guerre, aucune vision stratégique. L’affaire de l’Atlantique Sud n’est qu’un coup de dés provincial. En Grande-Bretagne, elle a semblé une guerre spectaculaire, une conquête facile pour en imposer au prolétariat et restaurer la confiance dans l’Etat Nation britannique, qui avait fait vraiment trop de bides ces derniers temps. La perle fut l’assaut réussi contre les pingouins de l’île de Géorgie du Sud et le message ridicule envoyé par le commandant de la Flotte à la Reine. La seule concession à l’anti-fascisme, mis à part le baratin, fut la capture et l’emprisonnement du capitaine Alfredo Astiz, le tortionnaire argentin bien connu. A tout bien considérer, il y a des limites à la manipulation de l’héritage anti-fasciste en Grande-Bretagne. D’ailleurs, l’Etat semble en être conscient et n’en rajoute pas. Il manque une tradition de résistance armée, style guérilla, à un régime fasciste intérieur, qui se prêterait à une manipulation des services secrets par des actes terroristes. Il n’est donc pas possible d’imiter le modèle italien de la stratégie de la tension, quoique l’Etat britannique ne répugne pas à utiliser le terrorisme quand ça lui chante. L’Etat doit sans cesse improviser, incapable qu’il est de trouver la bonne formule pour contenir l’ennemi. Les îles Penguin furent un bon créneau, mais l’intérêt décline avec la victoire, et l’attention du public se retire de l’Atlantique Sud pour se concentrer de nouveau sur la guerre sociale.
Il faut un battage permanent pour maintenir le souvenir de ces journées. La menace, réelle ou imaginaire, d’une nouvelle invasion et de bombardements va entraîner le cantonnement des troupes dans les îles pour un bon bout de temps. Il est probable qu’une flotte de petits et gros bateaux restera prête à intervenir dans l’Atlantique Sud. Les coupes dans le budget de la Navy seront momentanément reportées, et la liquidation des docks de Chatham et Portsmouth (où se produisirent des émeutes en 1981), qui devait conduire à la suppression de 40000 emplois, différée. Un tiers du personnel de la Navy, avant le conflit, devait être dégraissé, mille soldats professionnels devaient être virés. No future, sauf à s’engager dans le rock’n roll.
En tout cas, la Marine devrait subir le choc des coupes budgétaires. Le haut commandement de la Marine, menacé, joue sa survie dans cette Armada nostalgique. La reconstruction des bateaux perdus, le ravitaillement d’une flotte à 8000 miles de la Grande-Bretagne et l’énorme coût de la guerre (environ deux milliards de Livres) seront payés par des impôts supplémentaires, et une prochaine réduction du salaire social, l’argent disponible pour la Sécurité sociale étant dévoré par l’armée. Cela peut finalement exacerber encore davantage la crise sociale, ce qui montre à quel point cette entreprise est délirante. Dans un passé pas si lointain, le chauvinisme et la diplomatie de la canonnière ont été payés par une augmentation du budget de l’Etat, et des réformes, l’inverse de ce qui se passe en ce moment.
Le processus subversif est allé trop loin et des phrases creuses comme « La paix dans l’honneur » seront insuffisantes à repousser durablement le début d’une unité révolutionnaire et d’une totalité à laquelle le prolétariat britannique n’a jamais goûté auparavant.
Les émeutes de l’été 1981 furent un avant-goût du futur, pour nous. Un jour, tôt ou tard, ça va craquer en Grande-Bretagne. La plupart des gens dans les pubs, les rues, les supermarchés ou au travail acquiescent de la tête. Les vieilles recettes rassurantes et pépères, telles que « ça ne peut pas se passer ici », ont finalement disparu. Que ce soit pour toujours.
Wolfie Smith Speed
Tucker et June (1982)
[1] En fait, s’était la prémière partie d’un poème par William Blake (1757 – 1827), publié en 1794.
[2] Un groupe qui existe depuis le début de XXe siécle, qui a la conception d’une société sans argent etc. Mais qui ne soutien aucun mouvement pratique et demande seulement que les gens votent pour (et lisent) eux.
[3] Une scission du Partie Communiste, qu’a soutenu l’invasion de l’Afghanistan par les chars d’URSS en 1980.
[4] Le livre de Vance Packard des années 60.
[5] Harold Macmillan était le premier ministre de Grande Bretagne, 1957 – 1963.
[6] “Copycat” en anglais – un mot pejoratif et un peu infantile que les enfants s’appellent les uns les autres; le média a utilisé ce mot dans une façon condescendante et méprisante, pour dénigrér les emeutes qui n’ont pas de la raison evidente, comme à Brixton et à Liverpool.
[7] Pas une vraie ville- une petite ville fictive.
[8] Ministre de l’Intérieur avec un nom pareil – Whitelaw est “loidesblancs” en anglais.
[9] Début 1972, les mineurs se mirent en grève pour une augmentation de salaires de, en moyenne, 23%, dans des circonstances très défavorables : grève déclenchée par le NUM, hiver doux, énormes réserves de charbon. Mais, spontanément et contre la volonté du NUM, ils organisèrent des piquets volants aux portes des dépôts de charbon et des centrales électriques, qui durent stopper les unes après les autres. Pas mal d’autres usines furent obligées également d’arrêter la production, un mois et demi après le déclenchement de l’action : 1200000 ouvriers furent mis en chômage technique. Dans la plupart des usines, on ne travaillait que trois jours par semaine. Finalement le gouvernement Heath dut céder.
Fin 1973, alors que la Grande-Bretagne connut un peu partout une succession de grèves sauvages, les mineurs se remettent en grève et, trés rapidement, le courant électrique commençait manquer, ce qui était suspect. Le gouvernement Heath prit pétexte de la gravit・ de la situation pour introduire la Semaine de Trois Jours de travail. Plus d’un million d’ouvriers se trouvaient en chômage technique. Heath espèrait ainsi dresser les autres travailleurs contre les mineurs. Mais ce fut encore le gouvernement qui perdit la bataille.
[10] Une chanson normalement associé avec pacifisme ou avec le mouvement de droits civils des noirs aux Etats Unis.
[11] Une parodie d’un chanson gay de l’époque – “chantez si vous êtes heureux d’être gay!”
[12] Un politique conservateur qui est devenu célébre pour son démagogie raciste en 1968.
[13] ‘The only race is the rat race’. Jeu de mots sur le double sens du mot “race” en anglais (‘race’ et ‘course’). “Rat Race” – la course de rat – est une expression très commune qui désignait la lutte furieusement concurrente entre tous les gens pour survivre ou pour maintenir leur position dans la société.
[14] Southall est un quartier de Londres ou il y avait une grande affrontement entre asiatiques (la plupart Indiens et Pakistanis) et fascistes blancs qui ont venu de l’extèrieur du quartier.
[15] Emissions télés de l’époque.
[16] C’est à dire, une idée de l’époque des gauchistes et activistes de conquerir et reformer le vieux Labour Party avec une politique bien plus gauchiste – incluyant feminisme, libération des gays, anti-racisme, anti-nucléaire, etc.
[17] Socialist Workers Party – Partie de Travailleurs Socialistes, la plus grande et connue des parties trotskistes.
[18] “Functionaries” est plus pejorative en anglais que “fonctionnaires”
[19] “Grub street” – ‘larves de la rue’ – est une expression utilisé depuis la fin du 19ième siécle pour signifier des journalistes qui écrient n’importe quoi pour l’argent.
[20] GLC – Greater London Council – azdministration de Londres de l’époque.
[21] SDP – une partie centriste, la plupart duquelle a scissioné du Labour Party après l’élection du Thatcher parce que Labour est devenu, dans leur vision, trop gauchiste.
[22] C’était le premier squat des jeunes (pas des familles) et ils ont occupé une grand manoir vide au centre de Londres en face du jardin de la reine et à coté du Hilton Hôtel. Il venait de l’initiative de Phil Cohen.
[23] “Mugging” – traduit ici par les mots “à main armée” necessite pas des armes – quelque fois, pendant cette époque, au moins, c’était un vol à l’arrache, utilisant la force, mais pas nécessairement les couteaux etc.
[24] En Grande Bretagne, quand on parle de “inner city areas” on toujours pense des quartiers pauvres et décompos, comme les banlieux en France. Mais en Grande Bretagne les banleiux sont, géneralement, pour les riches. Les quartiers “inner city” sont à l’intérieur des grandes villes.
[25] “Skin Complex” , le sous-titre originale, est un jeu de mots – une expression pour dire que les gens ont mal de peau -“skins” (ça veut dire “skinheads”) est – dans son sens litèral – “peaux”.
[26] Par certains côtés, les destructions effectuées par des jeunes Blancs sont plus souvent « sans but », alors que les Noirs sélectionnaient le plus souvent leurs objectifs (cf. plus loin le compte rendu de la bataille de Liverpool). Par exemple après la semaine d’émeutes, dans la grande bataille mod de Keswick, un théâtre itinérant fut à nouveau incendié, et en août 1981 la station ferroviaire de Brighton fut attaquée à coups de cocktails Molotov par des jeunes Blancs. (note dans l’original)
[27] Il est tout à fait possible que les atrocités de l’attentat du pub à Birmingham en 1974 n’aient pas été commises par l’IRA. Les six hommes condamnés ont toujours protesté de leur innocence et expliqué que des aveux leur avaient été extorqués. L’IRA n’a jamais revendiqué l’attentat, ce qui est inhabituel. Les preuves utilisées pour condamner deux des hommes se sont effondrées; un test a révélé la présence de nitrates de fer et d’ammonium sur leurs mains, composants chimiques laissés par la gélignite ou le tabac ! (les deux hommes étaient fumeurs.) Comme pour la bombe de la Piazza Fontana déclenchée par les Services Secrets italiens et concluant l’automne chaud de 1969 en Italie, il est très probable que les bombes du pub de Birmingham aient été déposées par la main de l’État. Dans quel but ? Pour désorienter le prolétariat de Birmingham ? Pendant la maintenant célèbre grève des mineurs, des métallos de la grande ceinture industrielle de Birmingham se sont joints aux mineurs et sont allés « piquetter » à la centrale électrique de Saltey. Ils ont infligé ensemble une défaite mémorable au gouvernement britannique. Les bombes ne purent cependant en rien refroidir la lutte de classes, mais elles remplirent l’objectif immédiat de la Special Branch : préparer l’opinion publique à l’adoption de la Loi Anti-terroriste qui fut mise en œuvre aussitôt après l’attentat. Dans le futur, cette loi pourrait être utilisée plus à fond qu’aujourd’hui pour emprisonner les éléments subversifs.
Et que dire d’épisodes postérieurs de la lutte de classes ? Si la bombe posée au terminal pétrolier et méthanier de Canvey Island pendant l’Hiver du Mécontentement n’avait pas fort heureusement été désamorcée à temps un globe de feu se serait propagé à travers tout Canvey Island, laissant peut-être des milliers de morts. Elle aurait en même temps torpillé une vague de grèves à laquelle participait le personnel auxiliaire des hôpitaux. On a dit que la bombe avait été posée par l’IRA, mais un doute subsiste, comme un mal de dents tenace. Une simple supposition? L’opinion pro-républicaine en Irlande (par exemple dans le Irish Times), bien que pas vraiment pour les grèves (l’Irlande était alors sur le point elle-même d’être submergée par une grande vague de grèves), prenait cependant un certain plaisir à voir patauger le gouvernement britannique. L’IRA respecte le courant républicain modéré et préfère tant que c’est possible ne pas se l’aliéner inutilement. Il est donc hautement improbable que la bombe de Canvey Island ait été l’œuvre de l’IRA. (note dans le texte original)
[28] Réfèrence d’un film avec James Cagney “Les Anges avec des sales visages”.
[29] Quelques machines Space Invaders étaient utilisés comme petites barricades à travers une rue en Brixton pendant l’émeute en avril. – Ce note de bas de page n’est pas dans le texte originale.
[30] Ministre de l’education de l’époque, et le politique le plus poche de Thatcher depuis les années 1970.
[31] Premier ministre travailliste 1964 – 1970 et 1974 – 76.
[32] Une determinisme que on voit maintenant était trop optimiste .
[33] Cf.Looking back at Bristol (regard en arrière sur Bristol – NdT) : décrivant le quartier central de Saint-Paul, la scène de l’émeute de 1980 y est le sujet de la première interview publiée d’une femme relogée depuis dans la cité de Hartcliffe, à six kilomètres du centre. (note en texte originale).
[34] Littéralement, Les tasses du Couronnement et les pots à confiture
[35] En effet, l’hiver de 1978 – 79, sous le gouvernement travailliste du Jim Callaghan.
[36] Sous le gouvernement Tory du Edward Heath.
[37] Une groupe de socialistes anti-Leninistes influencés par Socialisme ou Barbarie.
[38] Equivalent de la Mairie de Londres.
[39] Ca-veut-dire, le City de Lon dres, centre du capitale financière de Grande Bretagne.
[40] Les patrons d’usines de coton de Bradford, qui ont été autrefois la cible des moqueries de T.S. Eliot, donnent en gage par douzaines leurs hauts-de-forme en soie dans les boutiques d’Oxfam, à mesure que les filatures ferment les unes après les autres. Au lieu de rendre leur capital plus productif ou d’aller à l’étranger dans les années 1950 et 1960, ils préférèrent compter sur l’exploitation d’une main d’œuvre principalement asiatique, docile et bon marché, et d’un équipement vieux de dizaines d’années. Confrontée aux émeutes de 1981, où les jeunes asiatiques, qui comptent pour plus d’un tiers des lycéens, se révoltèrent, la chambre de commerce de Bradford, à bout de souffle, continuera mollement ses opérations de sauvetage du centre ville. (Note dans le texte original)
[41] Une banque.
[42] Une femme très connu, une des fondateurs du ‘Festival of Light’., une groupe moraliste et Chrétien, pour toute les choses archaiques et anti-sexuelles.
[43] Dans l’original c’est “private members bill” – ça veux dire, une acte du parlement proposé par un député comme individuel, pas comme une membre d’une partie.
[44] Litéralement « meilleur scintillement », mais peut-être nommer après Gary Glitter.
[45] « Retourne, retourne d’où tu viens… », chanson des Beatles.
[46] « Tu ne sais pas quelle chance tu as – De retour en URSS », autre chanson des Beatles (NdT).
[47] Depuis que nous avons écrit ce chapitre, la Commission des lois a proposé des amendements à la loi anti-émeutes. Les trois nouveaux chefs d’inculpation, participation à une émeute, bagarre et association illégale peuvent être liés si cela est nécessaire aux juges pour condamner les détenus. Par exemple, si trois personnes sont intimement convaincues de la nécessité de résister avec détermination à une injustice et qu’elles essaient d’en convaincre d’autres, elles peuvent prendre cinq ans de taule. Ce n’est pas aussi arbitraire que l’originale loi anti-émeutes, mais ça s’en rapproche.
[48] Il y avait une tentative de bloquer la rue hors du prison avec un bus, mais je pense l’idée d’attaquer le prison a rester qu’une idée sans pratique. NdeT.
[49] Les jugements des juges dans les procés du passé. NdeT.








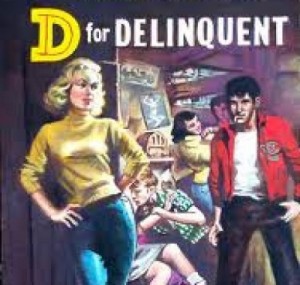
Leave a Reply