Ecrit par André Dréan a l’occasion de la sortie de la revue « Sic »
août 2012
“La pensée ne cessera pas plus que la sensation.
Mais le pouvoir des pensées et des idées, la domination
des doctrines, la souveraineté de l’esprit,
bref, la hiérarchie durera aussi longtemps qu’il y
aura des doctrinaires : théologiens, philosophes,
hommes d’Etat, philistins, maîtres d’école, pères
de famille (…). Aussi longtemps qu’ils auront la
parole.”
Max Stirner
Je viens de prendre connaissance des remarques de Claude
Guillon sur la communisation, disponibles sur le Web, et je partage
l’esprit de sa démarche. En effet, depuis quelques années, nous assistons à la
constitution du milieu du même nom qui, pour l’essentiel, recycle et vulgarise
les thèmes favoris de la revue Théorie communiste. Sic, la nouvelle publication
éditée en plusieurs langues, destinée à prendre le relais de Meeting,
est aujourd’hui le principal vecteur du recyclage et de la vulgarisation en
question et rencontre quelques succès, en France et à l’étranger, y compris,
à l’occasion, au sein de tendances libertaires.
Concernant les articles de la publication, je ne rentre pas dans
les détails et je cherche plutôt à dégager la perspective générale qui pose
problème et qui transparaît en filigrane entre les lignes, sans nier les particularités
des positions des rédacteurs et encore moins celles de toutes
les personnes qui en partagent, à des degrés divers, les conceptions. Il me
semble nécessaire d’intervenir ainsi pour éviter les polémiques oiseuses,
sans faire silence sur ce qui est important. Il y a, en particulier en France
à l’heure actuelle, des discussions sur le thème de la communisation qui
ne relèvent pas que d’effets de mode, parfois sur fond de réunions et de
séances d’étude du Livre I du Capital, l’oeuvre du maître présentée comme
majeure et presque indépassable dans le domaine de la critique du capital
par les aficionados de Sic. Evidemment, à condition d’accepter sans sourciller
les présupposés scientistes de Marx, résumés sans mystère dans les
préfaces et les postfaces du Capital, il est facile d’être impressionné par la
rigueur du discours dès les premiers chapitres. Lesquels donnent l’impression
de procurer enfin le fil d’Ariane indispensable pour sortir du labyrinthe
dans lequel nous errons aujourd’hui. D’autant que le seul passé que
les gestionnaires du temps effacent, jour après jour, des mémoires, c’est celui
qui leur rappelle trop des périodes où leur pouvoir fut ébranlé, voire mis
en péril. En ce sens, il n’est pas ridicule à chercher à connaître des doctrines
présentées, à tord ou à raison, comme utiles pour affiner notre compréhension du présent et pour combattre le monde de la domination. Mais dans l’engouement relatif pour Sic, il y a plus que de la curiosité et la recherche de repères. Sans chercher des explications faciles, je pense qu’il y a aussi des causes presque psychologiques à cela. Ainsi, aux milieux activistes qui commencent à entrevoir les limites de leur agitation et qui sont fatiguésde tourner dans leur cage d’écureuil, la revue procure le kit de survie qui donne des apparences de cohérence et d’approche globale à leur propre activité. Elle est sortie pour répondre à de tels besoins. De plus, le côté pédagogique d’articles phares comme Qu’est-ce que la communisation ? renmoins indigeste l’absorption de la préparation, alors qu’il faut de bonnes doses d’héroïsme, voire de masochisme, pour supporter la logomachie et le verbiage de Théorie communiste. Bien entendu, les amateurs de Sic et
d’autres membres des cercles de dégustation du Capital supportent mal la
critique car le milieu communisateur, comme tous les autres milieux à prétention
révolutionnaire, est marqué par la quête d’identité et d’autovalorisation
de groupe. A notre époque où l’organisation en réseaux informels
tend à supplanter celle en parti formel, l’esprit de parti antédiluvien est plus
difficile à cerner. Mais il explique bien des crispations envers des individus
qui préfèrent la recherche aventureuse et dangereuse du « gai savoir » aux
tentatives balisées de recyclage des doctrines embaumées.
Pour éviter les fausses polémiques, je tiens d’entrée de jeu à préciser
ceci : je ne reproche pas aux animateurs de Sic de reposer les problèmes
relatifs à la transformation subversive de la société du capital, dans
des conditions qui ne sont pas identiques à celles qui présidèrent à la venue
au monde de la société bourgeoise, grosso modo à l’époque de la sortie du
Manifeste communiste. Par plus que de tenter de comprendre la période de
l’histoire que nous subissons, marquée, sous nos latitudes, par le recul de
l’Etat providence, la dislocation de la communauté de classe prolétarienne,
etc. Je leur reproche au contraire de ne pas le faire en profondeur et de
reprendre à leur compte, pour justifier leur prétention à jouer le rôle de
novateurs dans la critique, l’une des affirmations les plus autoritaires du
Manifeste, à savoir : « Les conceptions théoriques des communistes (…)
ne sont que l’expression générale des conditions réelles de la lutte de classe
existante, du mouvement historique qui s’opère sous nos yeux. » En d’autres
termes, toutes les interprétations critiques qui n’entrent pas dans le cadre
objectiviste ainsi défini sont considérées, en dernière analyse, comme des
représentations partielles sans valeur globale, voire comme des lubies subjectivistes.
Il est certain que des conceptions générales peuvent devenir des
carcans lorsque les individus qui les ont exprimées sous forme de théorie
ne tiennent pas compte des évolutions et des modifications, parfois profondes,
que connaît la société du capital. Et lorsque qu’ils font preuve de
cécité face aux avancées réelles, en particulier pratiques, portées par les
oppositions, et plus encore par les insurrections qui tendent à la remettre
en cause. Les minorités révolutionnaires furent parfois surprises, désorientées,
voire hostiles aux révolutions qu’elles appelaient de leurs voeux
lorsque les damnés de la Terre, jusqu’alors assoupis dans leur majorité,
créaient des situations et empruntaient des chemins qui n’étaient pas prévus
au programme. Pourtant, il arrive que des projections, des aspirations,
etc., bref ce que l’on nomme des utopies, bien que marquées par l’époque au
cours de laquelle elles furent avancées, contiennent des idées que nous pouvons
reprendre et partager aujourd’hui, pour enrichir nos propres rêves.
Le dédain affiché par Marx pour les utopistes est pour le moins ambigu
car, au-delà de la nécessaire prise de distance envers leurs plans futuristes
plus ou moins fumeux, il propose de penser, non plus avec des pieds ailés,
mais avec des semelles de plomb, au nom de la rupture avec l’idéologie
spéculative qui dominait encore le monde de la philosophie, bien plus que
celui de la science en formation issue des Lumières. Pourtant, la conception
marxiste de l’histoire reste marquée par l’hégélianisme. Pour l’essentiel,
les forces productives y jouent le rôle attribué par Hegel à la raison et
Marx y amalgame le réductionnisme à prétention universelle des sciences
de l’époque, plus tard appelé scientisme. C’est pourquoi il anticipe lui aussi
dans le Manifeste, mais à la façon des scientistes, lorsqu’il reprend à son
compte les utopies technocratiques aussi discutables que celles de Saint-
Simon : « Proclamation de l’harmonie sociale et transformation de l’Etat en
simple administration de la production. » En réalité, lorsque Marx envoie
en bloc l’utopisme dans la poubelle de l’histoire sous prétexte que « le développement
de l’antagonisme de classe qui va de pair avec celui de l’indus
trie » le rendrait obsolète, il pense en héritier de la conception progressiste
et évolutionniste de l’histoire des idées qui est celle des Lumières, reprise
et développée via la dialectique par Hegel. Ce qui l’amène, à la suite du philosophe
d’Iéna, à croire que la pensée, dans l’histoire, progresse du simple
au complexe, de l’apparence à l’essence, etc., pour finalement à aboutir aux
représentations les plus globales possibles et indépassables pour l’essentiel.
La boucle est bouclée. Jusqu’alors, il y avait de l’histoire dans les idées.
Désormais, il n’y en a plus. La pensée humaine culmine dans le système
qui, bientôt, sera appelé le marxisme. Bien plus tard, le maître a brocardé
des disciples bornés. D’où la boutade, reprise par les héritiers : « La seule
chose que je sais, c’est que je ne suis pas marxiste, moi. » Mais Marx fut,
quoi qu’il en dise, le premier marxiste. Sinon, il n’aurait même pas tenter
de postuler l’existence de lois universelles de l’évolution des sociétés, à
commercer par celle, aberrante, relative à la prétendue contradiction entre
les forces productives et les relations de production. Là, il n’imagina même
pas qu’il était en train d’extrapoler de façon abusive à partir de la situation
qui était celle des premiers pas de l’industrialisation du monde, en Europe.
Certes, Marx a formulé des critiques contre la société bourgeoise à laquelle
il était confronté. Par contre, l’idéologie du progrès propre aux Lumières
qu’il partage va permettre d’asseoir le monopole du marxisme en gestation
comme science incontestée de la révolution communiste. D’où la formulation
de programmes marxistes, dont le Manifeste est la première et la plus
emblématique manifestation.
En ce sens, le mépris pour l’utopisme qui transparaît dans Sic, associé
au refus du programmatisme, n’est que l’arbre qui cache la forêt. Le
programmatisme est l’une des conséquences, aujourd’hui indéfendables,
qui découle de la conception marxiste de l’histoire et de la révolution. Sans
plus. La dialectique de Hegel, reprise par Marx, repose sur la distinction
spéculative entre la forme et le contenu. Elle donne l’impression de tenir
compte du devenir des choses et des êtres alors qu’elle cherche à dégager
ce qui constituerait l’esprit du monde, lequel en animerait les diverses manifestations
profanes. D’où l’importance accordée par Marx à définir des
lois de l’évolution de la société, l’économie y prenant la place souveraine
attribuée par Hegel à l’esprit. Bien qu’il considère, au niveau de la forme,
les catégories qu’il analyse comme des données de l’histoire, susceptibles
d’apparaître, d’évoluer, de disparaître, etc. en fonction des époques, bref
comme des phénomènes passagers et conditionnés, il n’en fait pas moins,
au niveau du contenu, des substances inconditionnées et inhérentes à l’humain
en général. Il en va ainsi de la première d’entre elles, le travail, censé
constituer l’essence de l’activité et des relations humaines, alors qu’elle a
aussi sa généalogie, son histoire, etc. Dans l’oeuvre de Marx, comme le signale
Castoriadis dans Les carrefours du labyrinthe, le travail est ramené,
au-delà des dimensions concrètes d’activités créatrices d’objets à la catégorie
naturalisée de travail abstrait présenté comme « simple dépense de
force humaine », source présumée de la valeur. La revue accepte cet axiome
de base et ne remet pas en cause le rôle du maître comme métaphysicien,
en particulier comme métaphysicien du travail, donc de la valeur. Lorsque
l’un des rédacteurs, celui qui a rédigé Crise et communisation, fait montre
d’un déterminisme outrancier, que n’aurait pas renier Marx et qui outrepasse
celui accepté dans la revue, concernant les relations entre la crise
financière et les potentialités révolutionnaires qu’elle est censée stimuler,
il est rappelé à l’ordre. Pas plus. Car l’adaptation de la doctrine marxiste
aux conditions incontournables de l’époque n’est pas synonyme de remise
en cause des axiomes qui en constituent le coeur. Le champ de la critique
est donc extensible, mais pas question de scier la branche vermoulue sur
laquelle la revue est perchée et de provoquer la chute de l’édifice.
Le fait que la revue brode sur le thème développé par Marx
dans l’Idéologie allemande selon lequel « le communisme n’est pas un état,
mais le mouvement réel qui abolit l’état de choses actuel », donne l’impression
que les communisateurs n’évoluent plus dans l’univers des systèmes
verrouillés. C’est la principale raison pour laquelle la revue rencontre des
succès chez des activistes : l’apparence de fluidité qu’elle donne des doctrines
figées et le refus formel de l’invariance programmatique, en particulier
celle héritée de Bordiga, encore plus ou moins défendue par le site Trop
Loin. Pourtant, la formule de Marx ne préjuge pas du sens et de l’orientation
prise par ledit mouvement d’abolition, ni même de l’idée que les divers
partisans du communisme s’en font. Sans même parler des individus qui,
pour être partisans de la subversion du monde, ne sont pas, ou plus, communistes. Ce qui est mon cas. Ainsi, dans le même passage de l’Idéologallemande, Marx affirme, dans l’optique qu’il partage avec la plupart des communistes de l’époque, que « le développement des forces productives
est la condition préalable, indispensable car, sans lui, c’est la pénurie qui
deviendrait générale et, avec le besoin, c’est aussi la lutte pour le nécessaire
qui recommencerait… ». L’idée que la domination est concomitante
à la rareté et qu’elle ne peut être éradiquée que lorsque la société procure
l’abondance de biens apparaît déjà dans les utopies issues des Lumières.
Dans la version de Marx, c’est la classe des prolétaires industriels, celle née
à l’époque de la constitution de la société bourgeoise et de la révolution
industrielle, qui est capable de faire accéder l’humanité à l’abondance. Car
elle constitue à la fois la classe créatrice et négatrice du capital, du moins
tel que Marx l’imagine. Les rédacteurs de Sic peinent à remettre en cause
le schéma et c’est pourquoi ils épicent leur préparation en donnant quelque
tournure mouvementiste à ce qui reste, en grande partie, du doctrinarisme
marxiste qui n’avoue plus son nom, gardant l’essentiel et évacuant ce qui
est passé à la trappe de l’histoire : le rôle prométhéen attribué aux prolétaires
industriels. Mais référence à la doxa oblige, reste le terme flou de
prolétaires et même de classes en général, sans contenu précis, comme le
remarque Claude Guillon. Ce qui relève de l’ontologie et ne fait pas avancer
la critique du moindre pouce. Mais ce qui, par contre, recouvre sous le
même vocable des interprétations variables concernant les oppositions et
les combats qui, depuis des décennies, ont de moins en moins à voir avec
les luttes de classe des prolétaires d’antan. D’où, parfois, le dédain, voire
l’hostilité larvée de communisateurs envers des oppositions qui n’entrent
pas dans leur schéma préconçu, par exemple celles dirigées contre la technoscience
même lorsqu’elles critiquent l’écologie.
Le joli terme de communisation, rabâché à longueur de pages dans
la revue, date, à ma connaissance, des années 1970. Dans l’un des textes
emblématiques de l’époque Un monde sans argent, le communisme, édité
par Les amis de quatre millions de jeunes travailleurs, qui préfigurait les
positions de la revue Guerre sociale, de triste mémoire révisionniste, la notion
de communisation apparaît de façon récurrente, avec des allusions à
peine voilées à l’Idéologie allemande. Sans la moindre critique de la concep
tion réductionniste de l’histoire marxiste, déjà remise en cause depuis des
années jusque dans les colonnes de Socialisme ou Barbarie, pour ne parler
que des analyses effectuées en France. Aujourd’hui, la référence à la communisation
est moins rigide, car il faut bien tenir compte, bon gré, mal gré,
à des degrés divers, de l’évolution de la société et de l’Etat. Elle cache donc
des conceptions parfois divergentes sur des questions essentielles. Dans
Sic, la position de repli commune consiste à dire que l’idée de période de
transition, concomitante à l’Etat du même nom, est désormais, voire depuis
longtemps, contraire à celle de communisation. Celle-ci consisterait à
entamer sans attendre, au cours même de la période insurrectionnelle, la
destruction du capital et de l’Etat, via des séries de mesures prises par les
premiers concernés eux-mêmes, les prolétaires qui n’interviendraient plus
à titre de classe, mais plutôt comme archétype de la disparition de toutes
les classes. Ils ne devraient plus tenter de s’ériger en classe dominante, mais
entamer leur propre dissolution, sous peine de recréer des instances de représentation
qui finiraient, comme toujours, par exercer leur pouvoir sur
eux, donc à reformer l’Etat.
Les rédacteurs laissent entendre que leur critique constitue la
nouveauté du siècle. De tels propos prouvent surtout qu’ils surfent sur le
vide laissé par des décennies d’amnésie et de révision de l’histoire, organisées
par les idéologues de l’Etat. Donc qu’ils pratiquent la politique de
l’offre attractive sur le marché actuel de l’idéologie à prétention révolutionnaire.
Or, les anarchistes, en particulier les anarcho-communistes, comme
le souligne Claude Guillon, rejettent l’idée même de transition, contre les
communistes étatistes d’obédience marxiste, grosso modo depuis les lendemains
de la Commune de Paris, qui consomma l’explosion de la Première
Internationale ! Au-delà de la question particulière du parlementarisme,
l’essentiel de la rupture avec les marxistes porta là-dessus. Marx, d’ailleurs,
la présente ainsi dans Les prétendues scissions dans l’Internationale : « Tous
les socialistes entendent par anarchie ceci : le but du mouvement prolétaire,
l’abolition des classes atteintes, le pouvoir de l’Etat (…) disparaît et
les fonctions gouvernementales se transforment en simples fonctions administratives.
Les bakouniniens prennent la chose à rebours et proclament
l’anarchie comme moyen de briser la puissance concentrée entre les mains
de l’Etat. ». Marx endosse ici le rôle de chef de file de la tradition socialiste
issue de l’école de Saint-Simon, laquelle prétend supprimer l’Etat en résorbant
la politique dans l’économie, contre les libertaires qui, eux, entendent
entamer la destruction de l’Etat, au cours même de l’insurrection, sous
peine de laisser subsister ou de reconstituer la société bourgeoise. Il est vrai
que des anarchistes, hostiles au communisme autoritaire, reprirent en partie,
à la suite de Proudhon, les idées de Saint-Simon. En particulier Rocker
présente, dans Nationalisme et culture, Saint-Simon comme « l’individu
génial », « qui pensait avec perspicacité que l’humanité aller vers l’époque
où l’art de gouverner les hommes serait remplacé par celui d’administrer
les choses ». Position que représente l’une des limites de la critique anarchiste
traditionnelle de l’Etat, compris essentiellement comme appareil de
coercition placé au-dessus de la société, conception qui deviendra réductrice
avec la constitution de l’Etat social. Ceci dit, l’auteur de Qu’est-ce que
la communisation ? pousse le bouchon très loin en affirmant sans rire que
l’idée de période de transition fut commune à toutes les tendances issues
de la dissolution de l’Internationale, à partir des années 1870, à l’exception
de poignées de francs-tireurs. Même Trop Loin rappelle que des anarchocommunistes
comme Kropotkine, dans La conquête du pain, étaient hostiles
à la notion de transition, en particulier aux mesures du même nom
telles que les bons de travail, puisqu’elle impliquait le maintien du pouvoir
d’Etat nécessaire pour qu’elles soient réalisées. Contrairement à la vulgate
propagée dans les milieux communisateurs, les anarchistes étaient loin
d’être d’incorrigibles révoltés sans cervelle, même si c’est l’image qu’aiment
parfois donner d’eux-mêmes les insurrectionnalistes d’aujourd’hui.
Pour le reste, les affirmations selon lesquelles il faut dépasser le
monde de la marchandise, de la division du travail, de l’Etat, etc. sont tirées
de l’Idéologie allemande et insuffisantes depuis longtemps. Quant aux
raisons pour lesquelles la notion de transition est indéfendable, elles sont
peu claires et varient selon les individus. D’aucuns affirment que, à notre
époque, les forces productives sont assez développées pour que l’on puisse
« sauter » la période de transition, telle qu’elle est présentée par Marx dans
la Critique du programme de Gotha. Marx, qui découpait en deux phases
l’histoire de la société communiste, reprenait pour la première le slogan deSaint-Simon : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses oeuvres »,et réservait pour la seconde, celui de Cabet : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » En d’autres termes, le problème du seuil
de développement des forces productives, jamais résolu par Marx parce
que l’étalon de mesure destiné à le définir est introuvable, et qui conduisait
à formuler de programmes de transition, n’aurait plus de sens. Mais la
question des forces productives elles-mêmes, prétendue base indispensable
à la réalisation du communisme intégral, reste en suspend. Elle est occultée
par celle de la gratuité, dont la généralisation est présentée dans l’éditorial
de Sic comme « unification de l’activité humaine ». Or, dans l’optique
communiste, la gratuité fut et reste, en règle générale, le synonyme de la
satisfaction des besoins sans passer par la médiation du marché. Y compris
le marché du travail. Elle ne préjuge donc pas du sens donné aux activités
et aux relations que les êtres humains réalisent et tissent, à la fois entre eux
et avec le monde qu’ils n’ont pas créé, mais dans lequel ils évoluent et qu’ils
transforment.
Des anarcho-communistes en eurent l’intuition. Dans Le révolté
de Genève, Cafiero affirme, dès la fin des années 1870 que « la répartition
gratuite n’exclut pas le despotisme ». « On peut avoir l’égalité économique,
sans avoir la moindre liberté. Certaines communautés religieuses en sont
la preuve, puisque la plus complète égalité y existe en même temps que
le despotisme. L’égalité, car le chef s’habille du même drap et mange à la
même table que les autres ; il ne se distingue d’eux que par le pouvoir de
commander qu’il possède. Et les partisans de l’Etat populaire ? S’ils ne
rencontrent pas d’obstacles, je suis sûr qu’ils finiront par réaliser la parfaite
égalité, mais, en même temps aussi, le plus parfait despotisme, car, ne
l’oublions pas, le despotisme de l’Etat actuel augmenterait du despotisme
économique de tous les capitaux qui passeraient aux mains de l’Etat, et le
tout serait multiplié par toute la centralisation nécessaire à ce nouvel Etat.
Et c’est pour cela que nous, les anarchistes, amis de la liberté, nous nous
proposons de les combattre à outrance. » Dans l’histoire réelle, l’idée de
gratuité fut donc compatible avec le communisme de caserne. Désormais,
grâce à l’extension et à la modernisation des forces productives auxquelles
ne pouvait même pas rêver Marx, le capital en est arrivé à intégrer, en partie,
là où il est organisé en réseaux, l’idée de gratuité comme l’un des facteurs
de maintien de la domination. L’univers du logiciel libre en est l’exemple le
plus typique. De tels phénomènes prennent le contre-pied de la doxa sur
la valeur, ultime ligne de défense des rédacteurs. En tout cas, dans la mesure
où ils chargent la notion de gratuité de plus de sens qu’elle ne peut en
avoir, ils risquent de reconduire les conceptions héritées de Saint-Simon,
de Comte et enfin de Marx dont Bakounine, dans Dieu et l’Etat, entama
ainsi la critique : « Le gouvernement de la science et des hommes de science,
même positivistes, même disciples de l’école du communisme doctrinaire
allemand, ne peut être que ridicule, inhumain, oppressif et exploiteur »,
car, au nom de leurs abstractions mortes, ils auront toujours tendance à
traiter les individualités vivantes comme de la chair à expérimentation politique
et sociale. Avec les conséquences que les révolutions du passé ont
déjà connu : le maintien ou le retour intégral, au lendemain de la poussée
insurrectionnelle, de la domination du capital.
Le moins que je puisse dire, c’est que, au-delà de l’accord formel sur le
refus de la transition, les réponses divergent et révèlent le côté minimaliste
de la revue. Pour les uns, la communisation est synonyme de l’expropriation
des expropriateurs à la mode du Capital et la liquidation de l’Etat est
réduite à celle de l’institution de coercition du même nom. Avec, par voie
de conséquence, des positions, plus ou moins assumées selon les individus,
concernant la planification de la production et de la consommation.
En effet, dans la tradition marxiste, le travail, même réduit à la portion
congrue par l’automation et l’extension démesurée du machinisme, reste le
domaine de la nécessité compressible, mais incontournable, au-delà duquel
commence celui de la liberté, grosso modo celui des loisirs et d’activités plus
enrichissantes que le labeur, d’autant plus extensible que les forces productives
en pleine extension libèrent du temps. Même dans Les Fondements de
la critique de l’économie politique, recueil de cahiers d’étude antérieur au
Capital et moins rigide que lui, le même découpage du temps demeure. De
façon générale, la conception du temps propre au capital apparaît à Marx,
à la suite de la science de l’époque, comme la chose la plus naturelle du
monde, comme temps universel. Thèse d’ailleurs reprise telle quelle dans
l’article de la revue nommé Le moment actuel. Par suite, Marx est consé
quent lorsqu’il affirme, en 1868, dans La lettre à Kugelmann, « que la forme
sociale de la production sociale ne supprime pas la nécessité de la répartition
du travail social en proportions déterminées : c’est la façon dont elle
se manifeste qui peut seule être modifiée. Des lois naturelles ne peuvent
pas être supprimées de façon absolue. Ce qui peut être transformé, dans
des situations historiques, c’est la forme de leur application (…). La forme
sous laquelle la répartition proportionnelle du travail se réalise dans l’état
social où la connexité du travail apparaît sous la forme d’échange privée
de produits individuels du travail, c’est la valeur d’échange. » En d’autres
termes, lorsque l’on accepte l’idée que le travail est la substance naturelle
de la valeur, la liquidation de celle-ci est assimilée à la liquidation des
échanges sur le marché au bénéfice de la planification. Les relations inconscientes
et indirectes entre les travailleurs deviendraient alors des relations
conscientes et directes par la médiation du plan. Ils domineraient enfin
leurs activités et leurs relations au lieu d’être dominés par eux. Dans cette
optique, les êtres humains sont devenus des dieux, des démiurges, voire des
ingénieurs de l’histoire universelle, capables de maîtriser le monde pour le
modeler selon leurs visées, puisqu’ils constituent les seuls sujets, auxquels
font face de purs objets. Le communisme serait donc la garantie de la fin
de l’aliénation à travers leur capacité à déployer leur puissance illimitée et
à surmonter leur humaine finitude. Loin d’être dépassée, l’idéologie de la
réification est en réalité poussée à son comble et, là, le marxisme participe
à la formulation d’utopies scientistes, que le capital contemporain tente de
réaliser jusque dans leurs ultimes conséquences. En effet, aujourd’hui, les
administrateurs de la domination croient pouvoir anéantir toutes les déterminations
des humains, y compris les déterminations qu’ils ne créent
pas par leur propre activité, qui leur sont données, à condition de disposer
des instruments adéquats que leur offre la technoscience, en particulier la
technobiologie.
La revue hésite à aborder bille en tête de telles questions maudites,
car elles révèlent à quel point Marx n’avait pas rompu avec les présupposées
des économistes, de la notion de travail à celle de besoin, et à quel
point le communisme qu’il appelle de ses voeux ressemble à du capitalisme
idéalisé, débarrassé des formes de propriété bourgeoise, plus tard rendues
obsolètes par la domination du capital elle-même. Mais les rédacteurs n’ont
pas l’intention de rompre avec le Marx métaphysicien de la valeur travail,
mise à mal par la modernisation des forces productives, via la science et la
technologie, comme il en eut l’intuition, vite refoulée, dans les pages consacrées
au machinisme, dans Les Fondements. Reste donc à prétendre, dans
la veine du Livre 1 du Capital que les travailleurs associés, dans la mesure
où ils auront liquidé le marché, pourront sans instance de planification la
réaliser eux-mêmes pour satisfaire leurs besoins. Dans l’optique de Marx,
la liquidation des échanges spécifiques au monde du marché est d’ailleurs
assimilée à celle des échanges en général, en d’autres termes à l’organisation
de la production et de la consommation sans médiation et sans voile.
Or, le mythe du troc, prétendue préfiguration du marché dans le Capital
repris par Marx aux économistes, ne tient pas la route. Des sociétés « primitives
» intégraient des notions d’échange, à travers le symbolisme de la
kula par exemple, étrangères au monde du marché et, de façon générale,
à celui des besoins. Des médiations, l’humanité en connaît depuis longtemps,
à commencer par le langage, et elles ne sont pas toujours synonymes
de domination. Par contre, tant que les bases de l’économie ne sont pas
dépassées, à commencer la recherche de la satisfaction des besoins, la hiérarchie
chargée d’organiser la production et la consommation et de faire
respecter le plan est nécessaire. Pour ne pas être reconnue comme telle, elle
n’en est que plus puissante.
Nous savons que, dans le marxisme, et même dans nombre de tendances
anarchistes, l’abolition du capital était réduite à l’expropriation
des expropriateurs, l’industrie n’était pas touchée pour l’essentiel, sinon
en termes de propriété, et de suppression de branches peu présentables,
comme l’industrie de guerre. Elle devait même encore être plus développée,
au lendemain de l’insurrection, pour accéder à l’abondance et dépasser
la rareté, bref pour couvrir tous les besoins sans trop peiner au travail,
voire pas du tout. Je passe sur la question, annexe ici, de l’opposition entre
le centralisme et la décentralisation, et de l’autogestion de l’économie communisée.
Par exemple, Cafiero, qui tenta de résumer Le Capital, excluait
l’idée de période de transition et de mesures de transition, telles que les
bons de travail, car il avait compris qu’elle impliquait le maintien de l’Etat
et de l’obligation de travail. Mais son approche restait industrialiste dans
la mesure où il soutenait que, au lendemain de l’insurrection, les conditions
pour accéder à l’abondance seraient pour l’essentiel réalisées, ou, au
moins, en cours de réalisation. Dans l’article du Révolté déjà cité, il affirme :
« Mais on nous demande : le communisme est-il applicable ? Aurions-nous
assez de produits pour laisser à chacun le droit d’en prendre à sa volonté,
sans réclamer des individus plus de travail qu’ils ne voudront en donner ?
Nous répondons : Oui. Certainement, on pourra appliquer ce principe :
“De chacun et à chacun suivant sa volonté”, parce que, dans la société future,
la production sera si abondante qu’il n’y aura nul besoin de limiter la
consommation, ni de réclamer des hommes plus d’ouvrage qu’ils ne pourront
ou ne voudront en donner. » Même Dejacques, dans L’Humanisphère,
demeure sur le même terrain lorsqu’il avance : « Pourquoi les hommes se
battraient-ils pour s’arracher la consommation quand la production, par les
forces mécaniques, fournit au-delà de leurs besoins ? » Pourtant, son utopie
est marquée par les thèses de Fourrier relative au libre jeu des passions et
à l’absence de contrats entre individus qui risquent de les brider, et par le
rejet des conceptions de Saint-Simon, reprises en partie par Proudhon qu’il
n’hésita pas à critiquer. Ce qui reste d’actualité.
Il n’est donc pas question ici de faire de la polémique facile et rétrospective.
Même l’un des plus radicaux adversaires de la société bourgeoise,
comme Dejacques, ne pouvait pas prévoir ce que générerait l’industrialisation
du monde, alors balbutiante, en termes de désastres et de bornes
supplémentaires posées à la réalisation de la liberté humaine et d’activités
dignes de ce nom. A l’époque, les ouvriers croupissaient dans le besoin, ils
étaient encore attachés par mille liens aux campagnes et concentrés depuis
peu dans les cloaques des villes et dans les bagnes industriels où ils créaient
par leurs propres mains la richesse bourgeoise. L’Etat ne les reconnaissait
pas, sinon à titre de classe dangereuse, porteuse d’orages. L’idée que le
machinisme, à condition qu’ils le mettent à leur service et anéantissent la
propriété, puisse faciliter leur libération était bien tentante. Mais, depuis
lors, beaucoup d’eau polluée a coulé et c’est la domination du capital qui a
réalisé, de la seule façon possible, les conceptions héritées du communisme
d’antan. En particulier, elle a réalisé l’idée de la « transformation du gou
vernement des hommes en administration des choses » sous la forme de
l’administration des hommes comme des choses, via la technoscience et la
généralisation de la marchandisation du monde, permettant de créer et de
satisfaire les besoins de la société du capital, à première vue illimités, bien
que les limites de celle-ci apparaissent lors des crises et des catastrophes.
Dans la revue, de telles questions sont, pour l’essentiel, occultées.
Par suite, contrairement aux prétentions affichées, le problème du contenu
de la communisation, pas comme substance immuable, mais comme tension
à la fois individuelle et collective pour tenter de subvertir le monde
de la domination, est laissé en suspend. Mais la communisation ne peut
qu’être posée ainsi, à première vue comme forme sans contenu précis, pour
la bonne et unique raison qu’elle a été ressortie du local des archives pour
tenter de rassembler, jusqu’au sein même de la rédaction, des personnes et
des groupes que bien de choses séparent. Des partisans de Sic contournent
la difficulté en affirmant que la moindre tentative de préciser plus les choses
auxquelles ils aspirent conduira à retomber dans l’ornière du programmatisme.
Personne ne leur demande de tirer des plans sur la comète et je suis
bien persuadé que la subversion du monde que j’appelle de mes voeux, dans
ses objectifs comme dans ses moyens, dépassera ce que peuvent imaginer,
dans leurs rêves, quelques poignées de présumés révolutionnaires en quête
de révolution.
Par contre, la moindre des choses, c’est de tenir compte de l’ensemble
des critiques, théoriques et pratiques, faites aux antiquités doctrinaires,
en particulier le marxisme, balayées par le cours même de l’histoire
contemporaine, en y incluant celle des révolutions ou des tentatives
révolutionnaires des dernières décennies. Or, dans le meilleur des cas,
l’article de tête parle de « la multiplicité des mesures de communisation
prises en tous lieux et par toutes sortes de gens », « qui, quand elles seront
une réponse adéquate à une situation donnée, se généraliseront d’ellesmêmes
». Ce qui paraît plus acceptable que les mesures de transition de
Marx. Pourtant, le schéma repose sur les mêmes bases. D’abord, il ne tient
pas compte des ravages dûs à l’industrialisation et des modifications catastrophiques
qu’elle engendre dans nos corps et nos esprits, sans même parler du reste. L’exemple désormais connu du nucléaire qui modifie en
profondeur notre relation à l’espace et au temps, qui transforme des régions
entières du monde en poubelles pour des millénaires, qui génère des
mutations et des maladies dégénératives héréditaires chez les êtres, en particulier
humains, etc. montre que la transformation subversive du monde
est confrontée à des problèmes énormes, inconnus il y a encore quelques
décennies. Problèmes impossibles à évacuer à moins de croire que la liberté
humaine soit envisageable dans le monde ravagé auquel seront confrontés
des insurgés et qu’ils ne pourront pas faire disparaître par la magie
de « mesures de communisation », à Fukushima et ailleurs. Ensuite, des
« mesures » qui « d’elles-mêmes » deviennent « générales » rappellent fâcheusement,
dans leur conception, celles préconisées dans Le Manifeste,
qui « bien qu’insoutenables et insuffisantes » étaient susceptibles de « se
dépasser d’elles-mêmes dans le cours du mouvement » dans la mesure où
elles étaient « indispensables pour bouleverser le mode de production ».
L’histoire a prouvé, dès la prise du pouvoir par le parti bolchevik, quelle
était la signification effective de tels sophismes dialectiques, censés dépasser
la domination pour mieux la reconduire, de façon momentanée, bien
entendu ! Enfin, là où il y a encore des mesures à prendre en fonction de
situations données, sans plus, il y encore coercition à exercer pour qu’elles
soient réalisées, ce que Fourrier et d’autres utopistes inclassables comme
Morris avaient entrevu. Les rédacteurs de la revue peuvent toujours dire
qu’il n’y aura pas d’institutions de coercition, nous restons malgré tout
dans le monde de la contrainte, où le libre jeu des passions et des rêves
n’aura pas sa place. Ou alors il sera relégué à quelque place annexe, toléré
peut-être, mais dans quelle mesure et pour combien de temps ? Ce qui est
d’ailleurs arrivé au lendemain de la prise du pouvoir par les bolcheviks,
lorsque leur dictature était en gestation. Mais, ensuite, faudra-t-il inculquer
à de tels rêveurs quelque dose de réalisme pour les ramener dans le bon
chemin de la communisation ? Les traiter d’adeptes du subjectivisme en
cas de refus, les isoler, les bannir, voire les contraindre ?
En réalité, la revue reste bien marquée, au nom de la nécessité
de tenir des conditions objectives, par l’objectivisme, qui pousse à définir
des objectifs et à utiliser des moyens rejetant sur les bords de l’autoroute de la communisation les côtés subjectifs de l’humain. « Soyons réalistes, exigeons l’impossible ! » Le slogan provocateur de Mai 68 peut paraître aujourd’huinaïf et irréaliste. Mais il n’en reste pas moins qu’il était dirigé contre le possibilisme de l’époque et qu’il exprimait le désir de sortir des sentiers battus, connus, trop connus, pour prendre le large vers l’inconnu. Je n’oppose pas au besoin le désir, comme valeur suprême de l’élan subversif,
car je sais que nos désirs sont aussi marqués par l’époque et que la
domination a appris depuis longtemps à en jouer pour mieux les émousser.
Mais la liberté humaine est réalisée par des individus dont les élans subjectifs
parfois convergent, parfois divergent, mais qui ne sont pas toujours
partageables, voire pas toujours acceptables par tous. Ce qu’il est essentiel
de reconnaître, sans nier que leurs affinités et leurs aspirations communes
les poussent à vivre ensemble en société, à définir ensemble des objectifs, à
les réaliser, à les corriger, à les abandonner, etc., car la vie humaine est aussi
faite d’expérimentations limitées, aux conséquences parfois désastreuses,
voire meurtrières. L’oublier, refouler les contradictions, voire croire qu’il
est possible de les surmonter par l’intermédiaire de quelque plan général,
même lorsque la formulation n’en est pas réservée à des planificateurs patentés,
c’est reconduire l’univers de la coercition. Pas franchi par l’auteur du
Pas suspendu de la communisation qui devrait s’intituler Le pas suspendu
de la bolchévisation. Sans s’attirer les foudres du reste de l’équipe, il préconise
de « transformer » les « couches moyennes », auxquelles il assimile
jusqu’aux paysans déclassés du « tiers monde », en « prolétaires » en leur
« imposant » des « mesures communisatrices ». Façon obligation générale
du travail et collectivisation forcée, sans doute ! Nous voilà revenus, en
contrebande, au rôle de guide de l’ensemble des damnés de la Terre attribué
aux prolétaires industriels et donc à la contrainte qu’ils doivent exercer
sur eux, pour leur propre bien, sans doute ! Ce que l’on appelle la dictature
du prolétariat. La dictature, dans l’article, ne dispose pas, en principe du
moins, d’organes spécialisés de coercition, de bras armé à la mode de la
Tcheka bolchevique de sinistre mémoire. Tous les prolétaires l’exercent en
leur propre nom, ce qui constitue le même genre de progrès, par rapport au
maintien des tribunaux, que la justice populaire prônée par les maoïstes,
dans les années 1970 ! La « continuité dans le changement » ou « tout changer
pour que rien ne change » comme disait « Le Guépard ».
Pour toute correspondance
écrire à André Dréan :
nuee93@free.fr
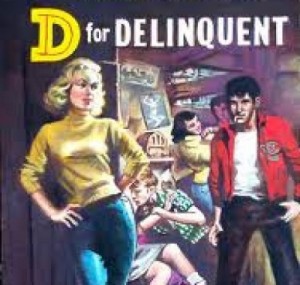

Leave a Reply